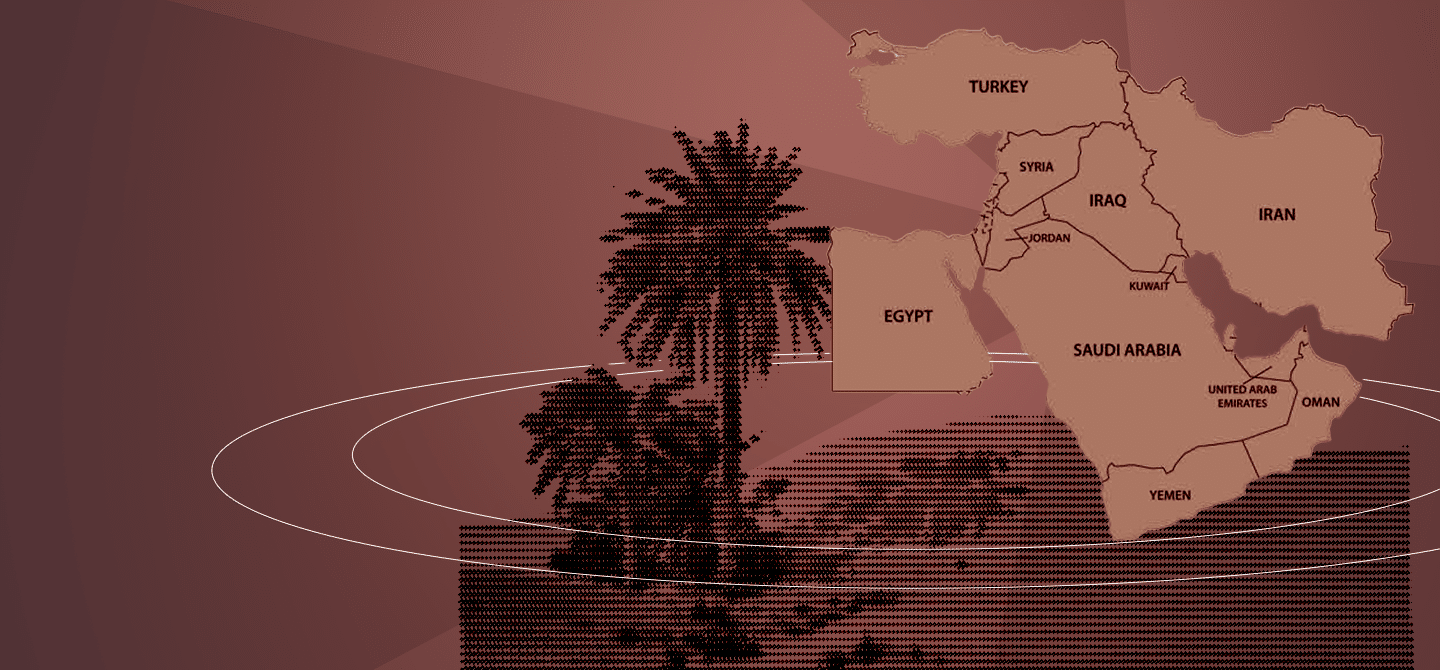Depuis son arrivée au pouvoir en 2013, Abdel Fattah al-Sissi a été reconduit trois fois à la tête de l’Égypte et devrait, sauf surprise, rester en fonction jusqu’en 2029. Que peut-on retenir de cette décennie au pouvoir ?
Sarah Ben Nefissa. Le Président al-Sissi a fabriqué un autoritarisme politique d’une grande intensité, autrement plus sécuritaire que celui de son prédécesseur, Hosni Moubarak (Président de la République arabe d’Égypte de 1981 à 2011) renversé après les soulèvements de 2011. Sous al-Sissi, les acquis démocratiques obtenus par le peuple ont largement été effacés. À présent, le régime politique repose sur la place centrale de la présidence, sur la marginalisation du gouvernement et du Parlement, et surtout, sur l’implication croissante de l’armée dans la vie politique et économique, érigée comme la gardienne de la Constitution et de la démocratie.
Selon la vision d’al-Sissi, c’est le laxisme et la permissivité du régime de Moubarak qui seraient responsables de la révolution de 2011, et par ricochet, des troubles politiques et économiques qui ont suivi. Basée sur cette lecture de l’histoire, une série de mesures restrictives ont abouti à l’instauration d’un capitalisme d’État1, dominé par l’appareil militaire.
Un pouvoir sans contrepoids ?
L’ensemble des partis politiques, avec les Frères musulmans en première ligne, ont été affaiblis. Contre toute attente, le Président n’a pas comblé ce vide politique en créant un parti structuré autour de sa personne, comme il est d’usage sous les régimes autoritaires. Seules des formations politiques loyalistes – créé en 2013 par les agences de sécurité – existent et manipulent régulièrement la sélection des candidats se présentant aux élections. Le Parlement, quant à lui, ne peut s’ériger en contre-pouvoir, les députés sont réduits à approuver sans distinction les décrets présidentiels et les projets de lois.
Cette mise au pas dépasse la sphère politique. Le régime a développé une phobie, celle de voir la symbolique place Tahrir investie par une nouvelle mobilisation populaire. Toutes les mesures sont prises pour éloigner ce spectre : les associations sont sévèrement contrôlées, les ONG sont empêchées d’exercer, aucune autorisation de manifester n’a été accordée, la répression est la réponse quasi-automatique de l’État, et le paysage médiatique – qui avait connu une libéralisation sous l’impact de la privatisation du secteur à partir de l’année 2005 – voit le retour en force du contrôle étatique.
Enfin, du côté de la justice, une importante réforme constitutionnelle en 2019 a réduit l’indépendance du pouvoir judiciaire, juges et magistrats – domination présidentielle sur les organes judiciaires. Au total, plus de 1 000 prisons auraient été construites depuis le début de ses mandats.
Comment mesurer l’adhésion des Égyptiens ?
Qu’il s’agisse des élections présidentielles ou des élections législatives, il est impossible de se fier aux résultats électoraux officiels pour comprendre l’adhésion au gouvernement en place. L’ensemble du processus est contrôlé en amont : il est presque impossible pour un candidat indépendant de se présenter aux élections. Les dernières en date ayant offert un semblant de transparence étaient en 2014. Dix ans plus tard, les candidats présentés sont choisis par al-Sissi. Le dernier candidat libre aux présidentielles de 2023, Ahmed Tantawi – ancien député – n’a pas pu se présenter et a été condamné à un an de prison pour des irrégularités relevées par les services sécuritaires.
Le Président aurait pris un virage néolibéral modifiant les équilibres économiques et sociaux en place jusqu’à présent. Quelles en sont les traces ?
Sur le plan économique, la décennie al-Sissi a profondément marqué la société. La nouvelle architecture érigée a remis en cause le « pacte social autoritaire », historiquement en vigueur dans de nombreux régimes politiques de la région. L’accord tacite repose sur l’échange de la liberté contre une sécurité alimentaire, sociale et physique. Loin de ce pacte, le Président a construit un capitalisme d’État, usant d’outils tels que les politiques d’austérité néolibérales, la tarification des biens et des services publics, tout en favorisant la concentration des richesses. L’objectif premier était la création d’une nouvelle couche sociale et économique dominante, qui dépendrait de sa personne et qui serait articulée autour de l’Armée.
Des projets grandioses, mais des effets controversés ?
Al-Sissi s’illustre aussi par ses rêves de grandeur, tous accompagnés de superlatifs. Il imagine les travaux pharaoniques pour l’agrandissement du canal de Suez, la construction d’une nouvelle capitale à la périphérie du Caire, un opéra majestueux, la plus grande église d’Afrique, la plus grande mosquée d’Égypte, et bien d’autres. La réalité n’est pas aussi reluisante. Ces mégaprojets sont un échec total, ils ont été menés dans une grande opacité par des entreprises militaires. Ils sont en partie responsables de la faillite économique de l’État.
Entre une forte croissance démographique et les effets du réchauffement climatique, de nombreux défis agricoles et hydriques s’imposent à l’Égypte. Comment l’État entend-il répondre ?
Le barrage de la Renaissance voulu par l’Éthiopie sur le Nil Bleu, en amont du barrage égyptien d’Assouan construit sous Nasser, cristallise depuis plusieurs années les tensions et les craintes. L’inquiétude majeure étant la réduction du débit du fleuve et l’aggravation des épisodes de sécheresse.
En dehors de ce différend avec Addis-Abeba, la réduction du gaspillage de l’eau est au centre des enjeux nationaux. Plusieurs mesures sont proposées, comme celle de revêtir les canaux d’irrigation du Nil ou de mettre en place des systèmes de ration d’eau (alternance de 3 jours, avec eau/ 3 jours sans eau). Une autre mesure, vivement critiquée, consistait à limiter – voire interdire – les cultures gourmandes en eau, comme le riz. Or, cette céréale est la source nutritionnelle principale pour des millions d’agriculteurs dans le pays2. L’augmentation de la superficie des terrains agricoles par la création de nouvelles zones cultivables dans le désertafait l’objet de plusieurs mégaprojets, principalement le projet Avenir de l’Égypte dans le Nouveau Delta3. Dans ce cas également, les mégaprojets imaginés ne font pas l’unanimité.
Sous le poids de la répression politique et de l’érosion du contexte socio-économique, une vague de contestation significative pourrait-elle émerger ces prochaines années ?
Le régime est aujourd’hui très fragile. Le minimum est proposé pour les services sociaux et seuls les services de renseignement écoutent le peuple. Par ailleurs, aucune idéologie capable de créer l’adhésion massive des Égyptiens n’est proposée, le pouvoir porte un regard globalement méprisant sur sa population.
Al-Sissi a pu, dans une certaine mesure, redorer son image dernièrement avec ses positions sur les dossiers régionaux. Il s’est opposé à la décision de Donald Trump, lorsque ce dernier souhaitait le transfert des Gazaouis dans le Sinaï. Mais récemment et discrètement, la parole a commencé à se libérer, en témoignent les mouvements sociaux des habitants des centres-villes contre la libéralisation les loyers, en mai 2025. Des mouvements pour la protection des avocats, les grèves des ouvriers dans le secteur privé, l’élection d’un candidat autonome à la tête du syndicat des journalistes peuvent être perçus comme des signes. Autant de signaux faibles qui sont à surveiller.