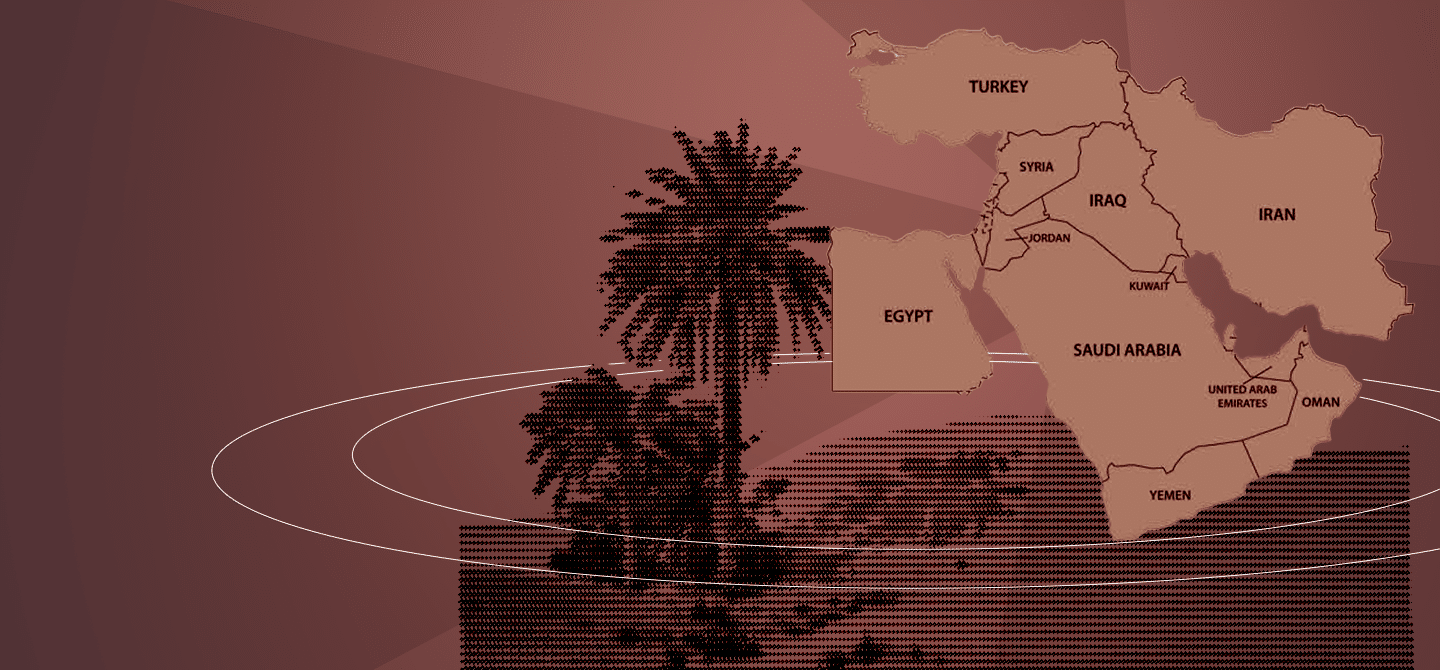Après deux ans de vacance du pouvoir, en janvier 2025 le Liban a de nouveau un président, Joseph Aoun. Peu après, Nawaf Salam, ancien président de la Cour internationale de justice, est désigné chef du gouvernement. Ces deux nominations marquent-elles la fin d’un blocage politique ?
Aurélie Daher. Effectivement, le siège présidentiel était inoccupé depuis novembre 2022, depuis la fin du mandat d’un autre Aoun, Michel de son prénom. Le président de la République au Liban n’est pas élu au suffrage universel, mais par le Parlement. En pratique, les députés formalisent à travers leurs votes les choix arrêtés en dehors de l’Hémicycle, par une oligarchie multiconfessionnelle et de diverses obédiences idéologiques. Or, cette oligarchie a été incapable de s’entendre sur un candidat. Le gouvernement souffrait depuis deux ans d’un statut d’expéditeur des affaires courantes, non autorisé à prendre de nouvelles décisions, dans une série de contextes où l’exécutif aurait pourtant eu besoin de disposer d’une marge de manœuvre véritable.
L’élection de Joseph Aoun à la tête de l’État et la nomination de Nawaf Salam à celle du gouvernement ont permis de remettre l’action institutionnelle sur les rails. Cette double nomination a suscité dans beaucoup de milieux de grands espoirs. Les plus optimistes ont transféré sur les deux hommes une série d’attentes ambitieuses. Parmi elles, un assainissement des institutions économiques du pays, à commencer par celui du système bancaire, tenu responsable de la crise effroyable qui a frappé le pays en 2019. La fin de l’influence d’une certaine classe politique et la délégitimation de la mission armée du Hezbollah font également partie des espérances projetées sur la nouvelle équipe.
Depuis cette remise en route politique, des victoires ont-elles été remportées ?
Quelques premières batailles, au potentiel réellement impactant, ont été remportées, notamment au niveau de la réforme du secteur bancaire. Pour autant, le Liban reste tragiquement dépendant des aides extérieures pour réussir son rétablissement, et le retard à la matérialisation de soutiens significatifs à ce niveau reste, à la fin du printemps 2025, très pénalisant.
La reconstruction des parties du Liban affectées par la guerre israélienne de l’automne 2024 n’a pas encore démarré. Le contexte régional n’aide pas, puisque le pays vit toujours sous la menace de l’armée israélienne, qui entrave systématiquement toute initiative de réhabilitation des zones sinistrées. Par son action diplomatique, Tel-Aviv s’appuie sur le duo américano-saoudien – sous la tutelle duquel est placé Beyrouth depuis la signature du cessez-le-feu de novembre dernier – pour bloquer les initiatives de soutien en provenance de gouvernements « non agréés ». À titre d’exemple, l’Iran et l’Irak se sont officiellement avancés pour prendre à leur charge les frais de la reconstruction. Mais Israël comme l’Arabie saoudite interdisent au gouvernement libanais d’accepter ces propositions, soucieux de priver les deux grands pays chiites de la région – et le Hezbollah par extension – de dividendes de popularité auprès des Libanais.
Les épisodes de violence orchestrés par Israël ont également pour effet de nuire à l’économie libanaise en frappant de plein fouet le tourisme (source de rentrées fondamentale) ainsi que les investissements intérieurs comme extérieurs.
Un parlementaire chiite déclarait en avril 2025 que « personne ne devrait sous-estimer la puissance et la base populaire de la résistance et du Hezbollah, celui-ci étant toujours le plus grand parti au niveau populaire dans ce pays1 ». Qu’en est-il réellement ?
C’est un des angles morts des récits optimistes. Une grande partie des ultra-enthousiastes de la « nouvelle ère » présidée par le duo Aoun-Salam font abstraction de données sociologiques bien réelles – que ce soit par méconnaissance du terrain ou par déni. Leurs lectures oublient que la représentation institutionnelle des composantes de la vie politique n’est pas fidèle aux poids de chacune au sein de la société. Nous sommes en système « consociatif », les sièges au Parlement sont alloués aux communautés selon des quotas arrêtés en 1990, date à laquelle leur redéfinition avait été critiquée, à l’époque déjà, comme périmée.
Trente-cinq ans plus tard, la communauté chiite, dont la taille n’a cessé de croître depuis la création du Liban en 1920, représente désormais plus de la moitié de la société. Pourtant, elle doit se contenter de 27 sièges sur un total de 128, soit 20 % du législatif. À titre comparatif, les chrétiens (toutes dénominations et idéologies confondues) y siègent à 50 % pour une part estimée au mieux à un tiers de la population totale.
Ce qui explique le commentaire du Hezbollah, qui souhaite rappeler que le premier parti du pays n’est pas celui qui a le plus de députés, mais celui qui bénéficie du soutien d’une plus grande partie de la population. Or, le fait est que, malgré les destructions et tragédies humaines qui ont ciblé avant tout et essentiellement les chiites, la majorité de ceux-ci – sans compter une part non insignifiante des autres communautés –, accorde toujours sa confiance au parti, plus particulièrement dans un contexte où Israël continue de frapper le Liban à sa guise, sans que l’armée libanaise ne puisse y faire quoi que ce soit.
Au mois de février dernier, la présence massive de personnes (aux alentours d’un million et demi) aux funérailles de l’ancien secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, assassiné en septembre 2024, ainsi que les élections municipales du printemps 2025, dans le cadre desquelles le Hezbollah a engrangé d’excellents résultats, sont des illustrations explicites de ce maintien de la popularité du parti.
La représentante des Nations unies pour le Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, estimait en février 2025 qu’un nouveau chapitre plus radieux s’ouvrait pour le pays. Des indicateurs sont-ils effectivement encourageants malgré un contexte régional incertain ?
C’est le souhait de tous les Libanais, pour autant, tous les indicateurs ne vont pas dans ce sens. Israël, pour commencer, dispose d’une liberté totale dans ses attaques contre le territoire libanais, contre sa population, contre ses infrastructures. Le prétexte de prévenir une remise en selle du Hezbollah est fallacieux, l’armée israélienne cible tout autant des civils, des bâtiments et des centres économiques. Cela entrave lourdement un vrai rétablissement du pays.
Dans la même veine, la tutelle américano-saoudienne est une contradiction de fait avec l’objectif annoncé d’un rétablissement de la souveraineté des Libanais dans la gestion de leurs affaires internes, ce qui atteint le gouvernement dans sa crédibilité. Le refus de ce dernier, par ailleurs, de contrôler l’expression publique, aujourd’hui surinvestie par une extrême-droite portée par les anciens des Forces libanaises (FL), milice chrétienne la plus violente de l’histoire de la guerre civile (1975–1990), participe à la crispation des relations intercommunautaires. En effet, les FL, qui interprètent la situation actuelle comme un « retour de leur heure de gloire », déversent énergiquement dans plusieurs médias (L’Orient-Le Jour, MTV…) un racisme anti-chiite décomplexé, parfois ouvertement violent, qui sabote les efforts à portée transconfessionnelle et nationale.
Les inquiétudes communautaires sont également alimentées par la question des réfugiés, dont la gestion fait du surplace depuis des années. Aujourd’hui, on évalue le nombre de réfugiés dans le pays à un ratio de 1 (réfugié) pour 2,5 (Libanais). En particulier, cohabitent aujourd’hui sur le territoire au moins un million, voire un million et demi de Syriens. Plus de trois cent mille pro-Assad sont arrivés depuis décembre 2024, après la chute du régime, ce qui a aggravé une crise humanitaire déjà aigüe. Et cela, sans que les anti-Assad, présents depuis le début des années 2010, n’aient significativement rejoint leur pays. Certaines parties au Liban, chiites et chrétiennes, voient en ces derniers de potentiels sympathisants des groupes wahhabites violents affiliés au régime syrien de Chareh, notamment ceux qui se sont rendus responsables des massacres dans le nord-ouest de la Syrie au mois de mars. Ce qui provoque une ambiance de suspicion généralisée.
Un optimisme à nuancer
La communauté internationale n’a pour le moment présenté aucun plan efficace pour aider le Liban à gérer ce surnombre de réfugiés, qui lui pose à la fois de grands défis économiques et sociaux, mais aussi politiques et sécuritaires. La situation au Liban est loin d’être rose, et le chemin vers un « nouveau chapitre radieux » est encore bien long et bien sinueux.