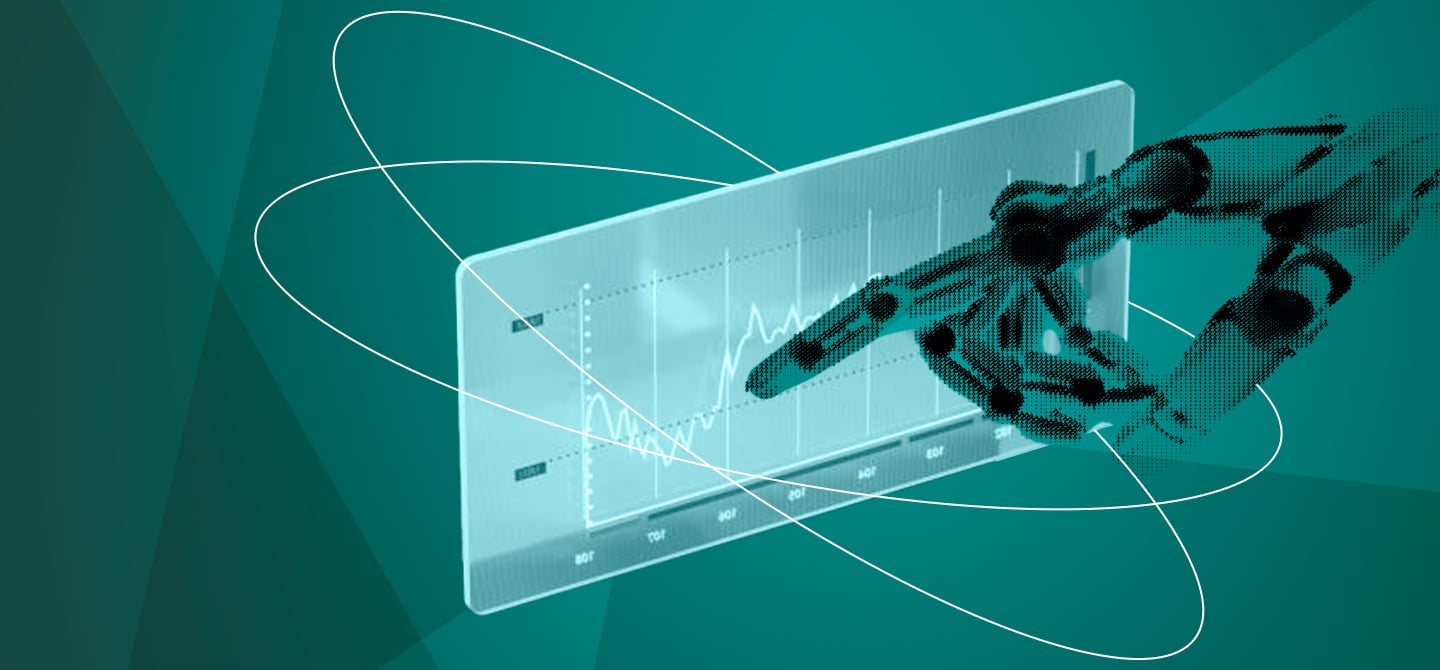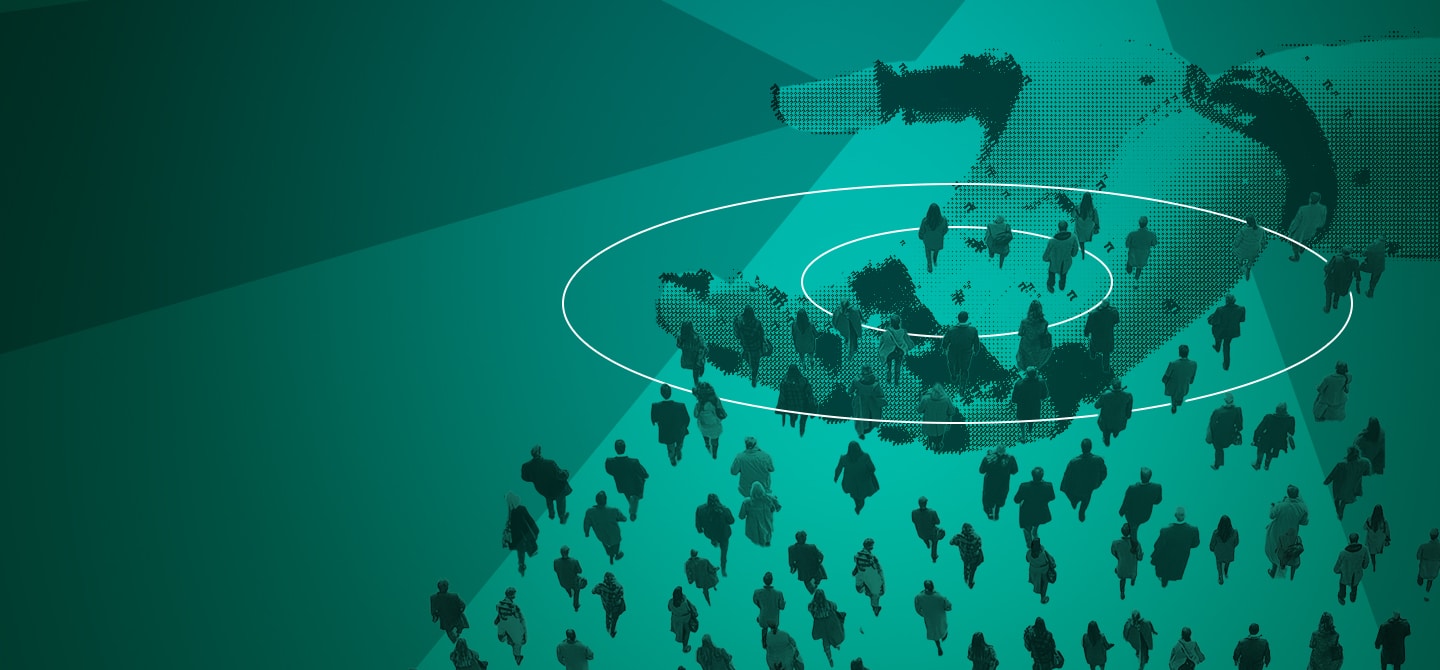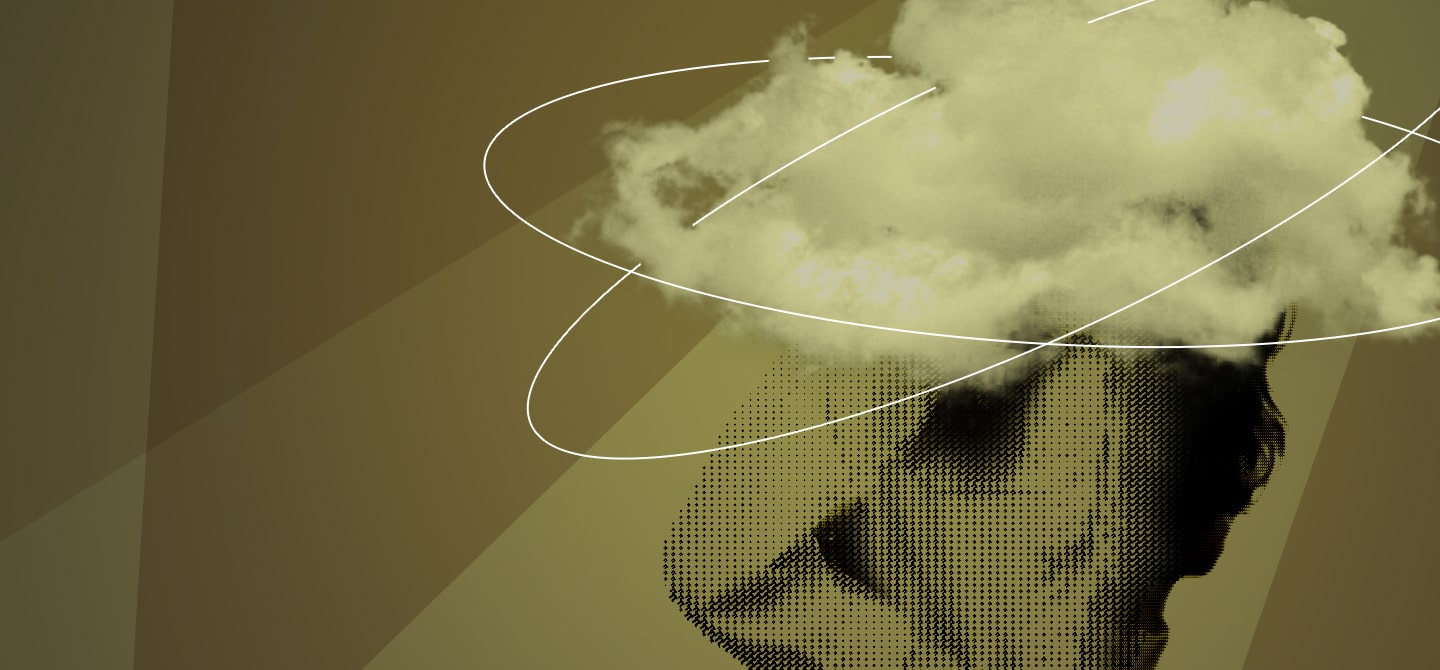IA et droit d’auteur : le vrai, le faux et l’incertain
- Un droit d’auteur s’applique sur une œuvre quelconque dès lors que celle-ci est issue d’un esprit humain et fait preuve d’originalité.
- Les productions scientifiques présentant uniquement des résultats factuels, sans aucune démarche singulière ou organisation particulière, peuvent être non protégeables par les droits d'auteur.
- L’ignorance de l’utilisation d’œuvres normalement protégées, pouvant être sollicitées lors de la génération de contenus par l’IA, est un problème récurrent afin de savoir s’il existe une contrefaçon ou pas.
- Une IA n'est pas considérée comme un « auteur », mais elle peut être utilisée comme un outil pour conduire à la création d’œuvres originales.
- Cependant, les concepteurs d’IA et les entités qui les exploitent pourraient revendiquer des avantages sur les contenus générés et exiger d’être titulaires de droits.
L’intelligence artificielle générative permet des gains de temps considérables, et transforme les habitudes dans l’art, l’écriture ou encore la recherche. Pourtant, de nombreuses questions relatives au statut des contenus générés par l’IA demeurent sans réponses précises. Déjà le 27 décembre 2023, le New York Times avait saisi le tribunal fédéral américain, accusant OpenAI et Microsoft d’utiliser des millions de leurs articles pour entraîner leurs modèles d’IA1. De son côté, Amazon fait face à une invasion massive de livres générés par l’IA avec des centaines d’ouvrages créés par ChatGPT recensés, allant des guides de voyage aux livres pour enfants. Face à cette déferlante, l’entreprise a modifié ses règles en obligeant les auteurs à signaler si leur ouvrage a été généré par une IA et en limitant ses services à trois publications par jour et par auteur.
Face à une technologie encore peu régulée, de nombreuses interrogations se font jour. Les modèles d’IA sont-ils en droit d’utiliser des données protégées par le droit d’auteur pour générer des contenus ? L’IA peut-elle devenir auteur d’une œuvre ? Qui détient les droits du contenu généré par l’IA : l’utilisateur ou le concepteur du logiciel ? Camille Jalicot, maître de conférences en droit privé à l’université de Bordeaux, répond à nos questions sur l’IA et le droit d’auteur en démêlant le vrai, le faux et l’incertain.
#1 N’importe quelle œuvre, des romans au théâtre, en passant par les articles scientifiques, peut être protégée par le droit d’auteur
VRAI
Camille Jalicot. Articles, romans, dessins ou autres productions en tout genre, le code de la propriété intellectuelle ne fait pas de distinctions selon le type d’œuvre. La protection offerte par le droit d’auteur s’applique pour toutes les œuvres de l’esprit, quelles qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. En principe, n’importe quelle œuvre peut être protégée par le droit d’auteur. Il importe cependant que l’œuvre réponde à une condition pour être protégeable : il faut qu’elle soit originale.
La réponse doit cependant être nuancée d’un point de vue pratique. Si certaines œuvres se prêtent facilement à une protection par le droit d’auteur, cela n’est pas nécessairement toujours le cas. C’est l’une des difficultés notamment rencontrées par les chercheurs qui écrivent des articles scientifiques : s’ils se contentent de présenter des résultats factuels sans les organiser de manière originale, une juridiction pourrait considérer que leur production n’est pas une œuvre de l’esprit protégeable.
Il existe d’ailleurs des affaires où des chercheurs ont voulu protéger leurs travaux, mais où les juridictions ont considéré que ces derniers ne pouvaient pas faire l’objet d’une protection, faute d’originalité. En revanche, si une démarche plus singulière est adoptée, une part de leur personnalité pourrait être retrouvée dans leurs productions, et ces dernières pourraient donc être protégées par le droit d’auteur.
#2 L’IA peut fouiller dans des données sans l’accord des titulaires de leurs droits
PARTIELLEMENT VRAI
La fouille de données, ou « data mining » est la technique permettant notamment à l’IA d’analyser les données d’un tiers, disponibles sur Internet, afin d’entraîner des algorithmes. Au niveau européen, le règlement établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle procède à un renvoi aux règles prévues par la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique2. Par principe, les fouilles de textes et de données à des fins de recherche scientifique effectuées par des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel sont autorisées, dès lors que l’accès aux données est licite3.
De la même manière, les fouilles de données peuvent également être le fait d’entités privées, agissant à des fins commerciales, à l’image des concepteurs d’IA. Or, par principe, ces fouilles sont également autorisées dès lors que ces entités y accèdent de manière licite. Les titulaires de droits peuvent cependant limiter ou interdire cette pratique, mais doivent, dans ce cas-là, exprimer leur refus [N.D.L.R. : c’est le mécanisme « d’opt out »].
En un sens, le régime juridique traditionnel s’inverse. Là où, en droit d’auteur, l’on considère que toute exploitation non autorisée d’une œuvre est interdite, la directive introduit une exception : par principe, les fouilles de données qui n’ont pas été interdites par les ayants droit de l’œuvre sont autorisées.
#3 L’IA peut générer des contenus qui ne respectent pas le droit d’auteur
VRAI
Un enjeu de taille est de savoir si l’IA peut générer des contenus qui ne respectent pas le droit d’auteur. Lorsque l’utilisateur pose une question innocente à ChatGPT, est-il possible que le contenu produit par le modèle copie une œuvre préalablement existante ? Étant entraînées sur des données parfois protégées par le droit d’auteur, les IA peuvent générer des contenus très proches d’œuvres existantes, au point de relever de la contrefaçon. Ainsi, Disney et NBCUniversal ont récemment intenté une action en justice contre Midjourney4 qui génère des images s’inspirant très largement de photographies, comme celles de Dark Vador ou des Minions, pourtant protégées par le droit d’auteur.
De même, si l’on génère grâce à une IA un article scientifique, le risque que le contenu généré soit semblable à d’autres articles au point de constituer une contrefaçon n’est pas inexistant. Ceci est dommageable pour les utilisateurs : les IA ne donnent pas les sources des éléments qu’elles génèrent. On ignore ce qui est protégé ou non par le droit d’auteur dans le contenu brut généré par l’IA, et donc comment utiliser ces données, ce qui pourrait donner lieu à des contentieux.
#4 Une œuvre produite à l’aide d’une IA peut être considérée comme une « œuvre de l’esprit »
INCERTAIN
Au-delà de la question de la fouille, se pose également la question de la nature juridique du contenu généré par l’IA, pour savoir s’il peut être protégé par le droit de la propriété intellectuelle. En droit d’auteur, la protection de l’œuvre naît du seul fait de sa création. Si vous écrivez un roman, peignez un tableau ou rédigez un article, vous bénéficiez de droits d’auteur dès lors que l’œuvre est originale, même si elle est inachevée. Comme il n’y a ni protection préalable, ni démarche à effectuer en amont, la protection de l’œuvre reste cependant hypothétique tant qu’un juge ne statue pas sur cette originalité dans le cadre d’un contentieux.
FAUX
Cependant, le contenu produit par l’IA n’est a priori pas une œuvre de l’esprit pour une raison simple : pour qu’il y ait une œuvre originale, celle-ci doit être produite par un humain. Or, l’IA n’est ni une personne humaine, ni une entité juridique. Une IA ne peut donc pas être un « auteur ». On peut déjà exclure la protection d’un contenu brut généré par les IA dans la conception française du droit d’auteur.
VRAI
Rappelons toutefois que le contenu généré par l’IA peut faire l’objet d’une recherche préalable spécifique par l’utilisateur. Selon le prompt rédigé, l’IA peut être utilisée comme un outil par un artiste ou un chercheur, à la manière de Photoshop ou de Word. Elle peut donc parfaitement conduire à la création d’œuvres de l’esprit originales. Résultat : on ne peut donc pas exclure toute protection d’une œuvre générée par l’IA si l’on arrive à percevoir un effort créatif de la part de l’auteur.
#5 L’IA peut être titulaire des droits d’une production d’une œuvre de l’esprit
INCERTAIN
Là encore, l’IA ne peut pas être titulaire de droits. En revanche, les concepteurs d’IA, ou du moins les entités qui les exploitent, pourraient revendiquer des droits sur les contenus générés. Ces derniers pourraient invoquer leur participation à la création de l’œuvre et exiger être titulaires de droits. En l’état, il n’est pas certain que cette revendication aboutisse, mais le cas échéant, la question sera de savoir « qui sera titulaire de quoi » et « selon quel modèle ». Parlera-t-on alors d’une copropriété entre l’utilisateur et le concepteur de la technologie ? Ou l’un des deux seulement sera-t-il propriétaire ?
Ce sujet est nouveau, nous n’avons donc pour le moment pas de réponse certaine à ce propos. Cela s’explique notamment par le temps juridique qui est plus lent que celui des innovations, notamment en matière d’IA où les développements sont très rapides. Cela n’empêche cependant pas le législateur de s’intéresser à ces questions, et des réponses devraient donc être apportées dans le futur. Une évolution à surveiller de près.