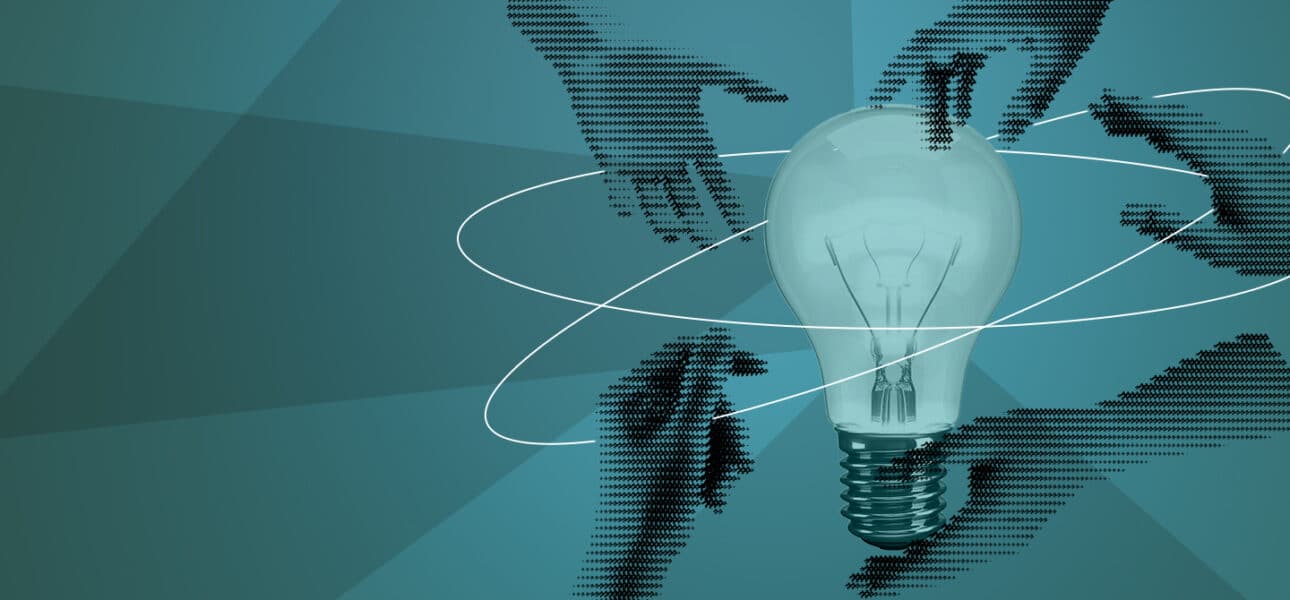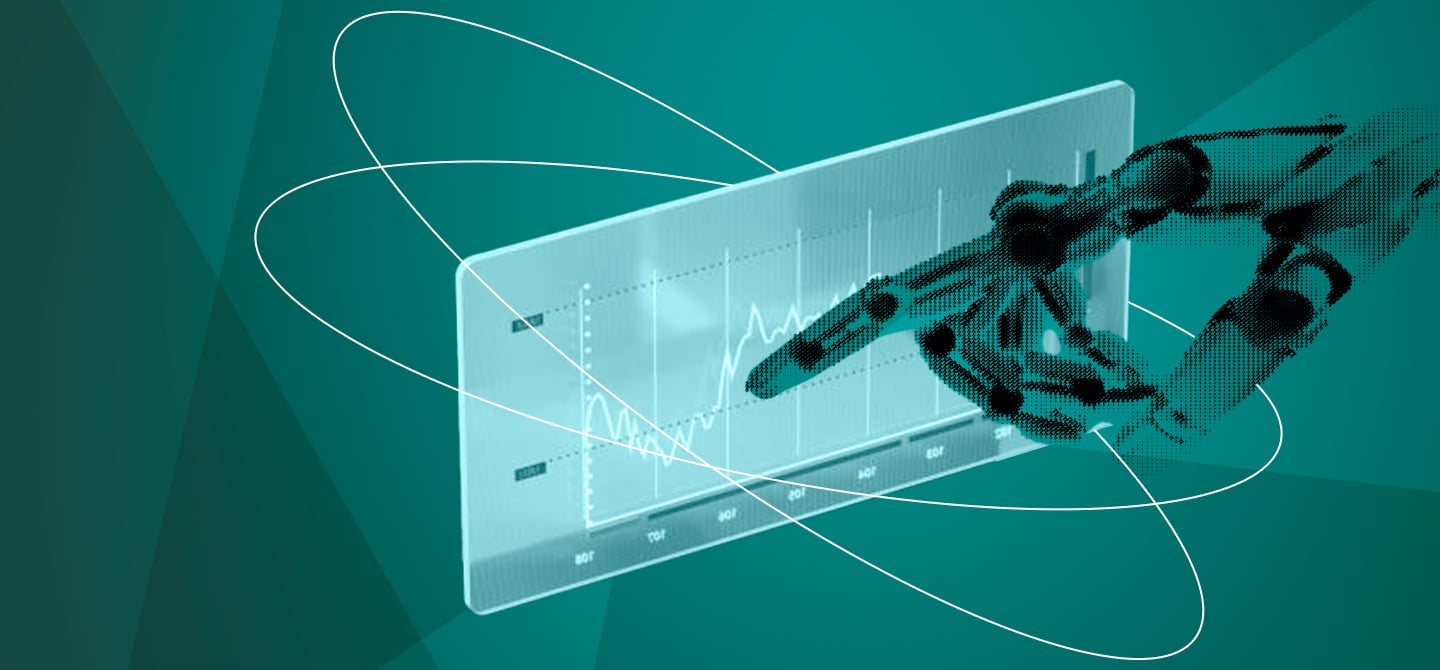Les avancées en biomédecine et en technologie se développent à une vitesse vertigineuse. Des thérapies par anticorps basées sur l’IA de Regeneron, qui permettent d’identifier des futurs médicaments prometteurs en quelques semaines, aux thérapies géniques CRISPR, qui réécrivent littéralement le code génétique, les innovations radicales ne se contentent pas d’améliorer les solutions existantes, elles redéfinissent le champ des possibles. Chacune d’entre elles représente un changement fondamental, créant ainsi des marchés nouveaux et rendant obsolètes les approches précédentes.
Pourtant, pour une avancée majeure, d’innombrables idées supposées révolutionnaires ne voient jamais le jour, enfouies au sein d’organisations qui sapent involontairement leur propre potentiel. Tandis que certaines entreprises, comme Michelin, fonctionnent en innovation ouverte grâce à des centaines de partenariats de R&D adossés à l’expertise de l’entreprise, d’autres, comme Microsoft, entreprennent des transformations culturelles spectaculaires, passant du « je-sais-tout » au « j’apprends tout », de nombreuses organisations ont encore du mal à faire grandir des idées et des innovations de rupture. Qu’est-ce qui distingue les innovateurs révolutionnaires des améliorateurs progressifs ?
La réponse ne réside pas seulement dans les budgets de R&D ou dans le génie des scientifiques, mais dans quelque chose de plus subtil et pourtant plus puissant : les réseaux sociaux qui relient les personnes au sein des organisations. La théorie des réseaux, qui étudie les relations et les connexions, révèle que la manière dont les personnes collaborent détermine fondamentalement si une organisation produit des idées révolutionnaires ou se contente d’améliorations modestes.
Deux études approfondies menées auprès d’entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques américaines ont analysé plus de 19 000 brevets déposés par 93 grandes entreprises entre 2001 et 2013. Cet ensemble de données substantiel a permis aux chercheurs de retracer les liens sociaux derrière chaque innovation, de cartographier les collaborations et d’identifier les schémas de réseau qui ont précédé les innovations révolutionnaires et les innovations incrémentales. Leurs conclusions remettent en question les idées reçues sur les moteurs de l’innovation et offrent des perspectives surprenantes sur le rôle de la collaboration dans la créativité, car la recherche a mis en évidence un paradoxe fascinant : les relations étroites qui favorisent l’innovation incrémentale peuvent en réalité freiner les percées radicales. Cette conclusion contre-intuitive a des implications profondes sur la façon dont nous concevons la constitution des équipes et la collaboration.
Trouver l’équilibre parfait
Les équipes soudées et interconnectées, fondées sur la confiance et une communication fréquente, excellent dans le perfectionnement des idées existantes et la mise en œuvre efficace d’améliorations. Ces groupes très soudés partagent leurs connaissances tacites de manière transparente, coordonnent des efforts complexes avec un minimum de friction et peuvent rapidement itérer sur des concepts éprouvés. Par exemple pour l’entreprise américaine Apple, les équipes chargées de développer les caractéristiques physiques ainsi que celles s’occupant des aspects logiciels travaillent en étroite coordination pour apporter des améliorations à chaque génération d’iPhone, comme de meilleurs appareils photo, des processeurs plus rapides ou encore des designs raffinés qui s’appuient sur des bases établies.

Cependant, ces mêmes réseaux ont tendance à maintenir des modes de pensée établis et à résister aux idées qui remettent en question les normes existantes ou menacent les formules de réussite actuelles. Les membres du groupe développent des modèles mentaux communs et des perspectives similaires, créant ce que les chercheurs appellent un « verrouillage cognitif ». Lorsque tout le monde pense de la même manière, les idées vraiment novatrices peuvent sembler étrangères ou risquées. Prenons l’exemple des ingénieurs de Kodak, qui ont développé le premier appareil photo numérique en 1975, mais qui ont vu leur invention rejetée par la direction comme étant simplement « mignonne ». C’est un exemple classique de la façon dont une pensée bien ancrée au sein de réseaux très soudés peut empêcher les organisations de voir le potentiel révolutionnaire d’une innovation.
Les données confirment cela avec une précision mathématique frappante : les analyses de régression montrent que des liens plus forts et des réseaux plus denses réduisent considérablement l’innovation radicale, avec des coefficients de ‑2,29 et ‑1,77 respectivement. Concrètement, cela signifie que chaque augmentation de la densité du réseau réduit d’autant la probabilité de produire des innovations révolutionnaires.
Les innovations les plus radicales émergent d’endroits inattendus : les périphéries des réseaux organisationnels. Ces positions périphériques, moins connectées au cœur de l’organisation, mais plus ouvertes aux influences extérieures, s’avèrent nettement plus susceptibles de générer des idées disruptives. Sans la pression de se conformer à la pensée collective établie, les personnes situées à la périphérie de ces réseaux peuvent poursuivre des approches véritablement novatrices et remettre en question les hypothèses fondamentales.
Ce phénomène explique pourquoi certaines des innovations les plus révolutionnaires de l’histoire sont venues d’outsiders ou de personnes qui ont su dépasser les frontières. L’ordinateur personnel n’est pas né dans les laboratoires de recherche centraux d’IBM, mais dans le garage d’entrepreneurs situés à la périphérie du monde technologique. De même, de nombreuses percées biotechnologiques sont le fruit de collaborations entre le monde universitaire et l’industrie, où les chercheurs opèrent à l’intersection de différents domaines de connaissances.
Le mécanisme sous-jacent est intuitif lorsque l’on considère les flux d’informations. Les liens forts, bien que bénéfiques pour la confiance et la communication, relient souvent des personnes similaires qui partagent des informations redondantes et des points de vue similaires. Les liens faibles, malgré leurs défis relationnels tels que la confiance réduite et les malentendus potentiels, donnent accès à des informations nouvelles et non redondantes qui peuvent susciter des idées novatrices. Ces connexions agissent comme des ponts entre différents mondes de connaissances, rassemblant des idées qui ne se seraient jamais rencontrées au sein de réseaux denses et homogènes.
Ces idées offrent aux dirigeants technologiques une feuille de route pratique pour gérer l’innovation, suggérant que différents types d’innovation nécessitent des approches organisationnelles fondamentalement différentes :
Pour l’innovation incrémentale : favorisez les réseaux denses et collaboratifs avec des liens internes solides. Encouragez les interactions fréquentes en face-à-face, instaurez une confiance profonde entre les membres de l’équipe et créez des environnements où les connaissances existantes peuvent être systématiquement affinées et mises en œuvre efficacement. Établissez des canaux de communication clairs, des processus de révision réguliers et des indicateurs de réussite communs. Cette approche fonctionne particulièrement bien pour l’amélioration des produits, l’optimisation des processus et l’amélioration des performances.
Pour l’innovation radicale : cultiver délibérément la diversité des réseaux et les écarts structurels. Éviter les groupes trop soudés qui renforcent la pensée conventionnelle. Créer plutôt des « trous structurels » (écarts stratégiques dans les réseaux sociaux qui obligent différents groupes à se connecter et à partager de nouvelles perspectives). Encourager les collaborations entre les services, les secteurs d’activité et même les concurrents. Soutenez les employés qui jouent le rôle de « courtiers en connaissances », en mettant en relation des groupes auparavant sans lien entre eux et en traduisant les idées d’un domaine à l’autre.
Il est essentiel de comprendre que les organisations ont besoin que ces deux approches fonctionnent simultanément. Si les liens lâches permettent d’accéder à des idées novatrices et à des perspectives plus disruptives, les équipes ont néanmoins besoin de liens suffisamment solides pour évaluer, développer et mettre en œuvre efficacement de nouveaux concepts. Cela signifie qu’il faut soutenir activement les collaborations interdépartementales, les partenariats externes, les congés sabbatiques dans différents secteurs et l’embauche de personnes extérieures au secteur qui apportent des points de vue nouveaux.
Concrètement, cela peut impliquer la création de « centres d’innovation » dédiés dans différentes régions géographiques ou différents secteurs, la mise en place de programmes de rotation formels permettant de déplacer les personnes d’un service à l’autre, ou l’organisation de « tournois d’innovation » réunissant des équipes diverses pour relever des défis spécifiques.
Les organisations de premier plan doivent aller au-delà de la conception de réseaux pour surmonter les barrières culturelles. Cela implique d’encourager l’expérimentation, de tolérer l’ambiguïté et l’échec, et de récompenser la prise de risques calculés, autant d’éléments essentiels pour surmonter le conservatisme naturel des réseaux très soudés. En comprenant dynamique entre la cohésion et celle du courtage des réseaux, les dirigeants peuvent concevoir des structures organisationnelles qui favorisent à la fois une amélioration constante et des percées disruptives.
Cette recherche offre quelque chose de rare dans le domaine de la stratégie d’entreprise : une feuille de route claire et fondée sur des preuves pour relever l’un des plus grands défis du management. À une époque où des idées révolutionnaires peuvent transformer des secteurs entiers du jour au lendemain, comprendre les forces sociales qui sous-tendent l’innovation n’est pas seulement une question théorique, c’est une question de survie.
Pour aller plus loin
- Jia Zhang, Jian Wang, Jos Winnink, Simcha Jong (2024). Transformer des idées créatives en innovations réussies : effets différentiels de la structure des réseaux sur l’innovation radicale et incrémentale. Journal of Technology Transfer.
- Jia Zhang, Jian Wang, Jos Winnink, Simcha Jong (2025). Réseaux de collaboration et innovation radicale : les deux facettes de la force des liens et des trous structurels. Journal of Informetrics.