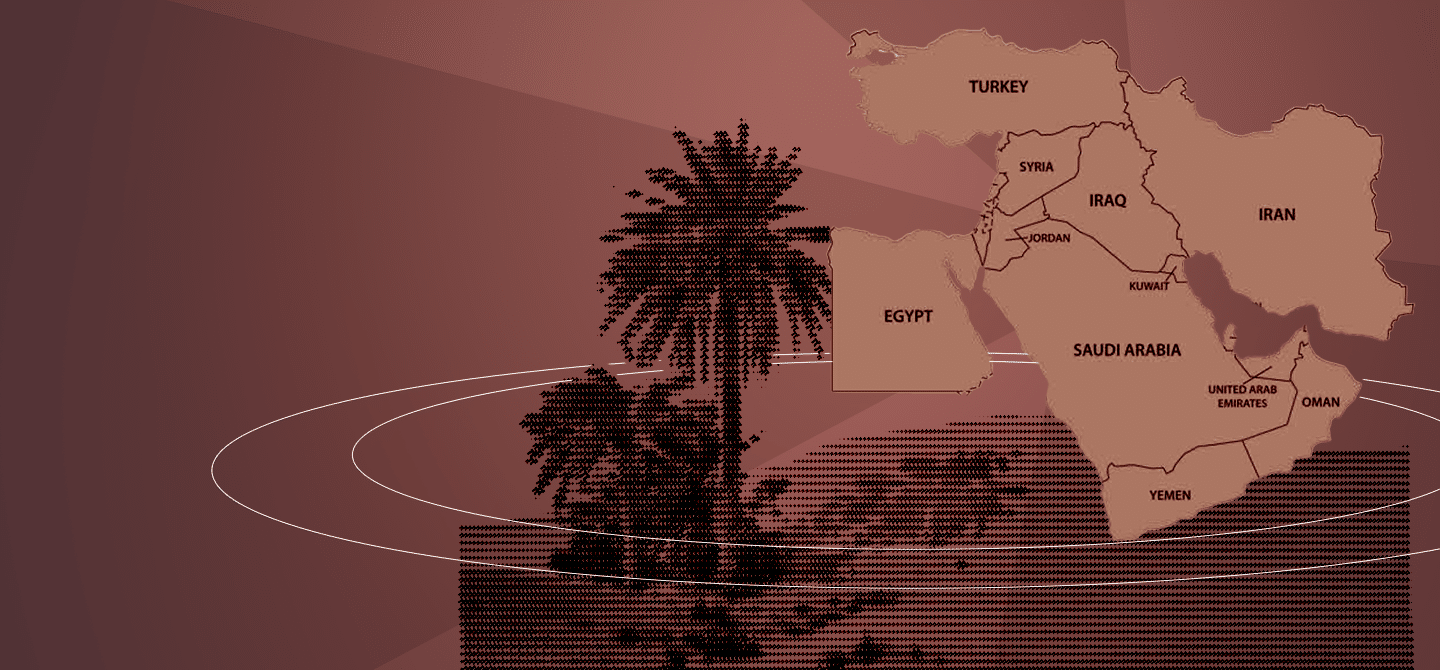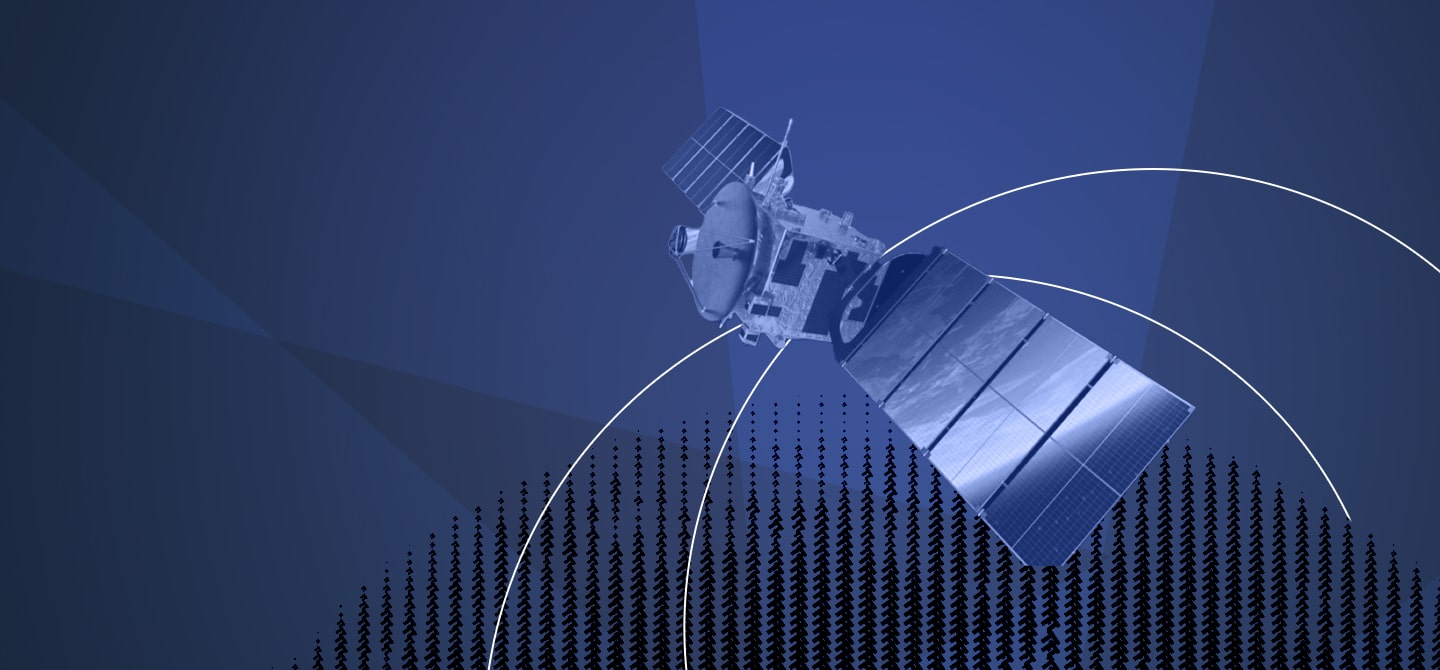La Jordanie, pays présenté comme un « îlot de stabilité » au Moyen-Orient, est dirigée depuis plus de 25 ans par le roi Abdallah II. Comment la monarchie hachémite règne-t-elle sur la vie politique du pays ?
Camille Abescat. La Constitution de 1952 définit la Jordanie comme une monarchie héréditaire et parlementaire. Au sein de ce système, la figure du roi est centrale : il détient le pouvoir exécutif, qu’il exerce par le biais du gouvernement dont il nomme et révoque les membres – généralement des technocrates sans affiliation partisane. Le pouvoir législatif est lui aussi encadré par le souverain, bien que théoriquement partagé avec le Parlement. Ce dernier est composé d’une chambre haute – le Sénat dont les membres sont nommés par le roi – et d’une chambre basse composée de députés. Le monarque conserve la possibilité de dissoudre le Parlement dès qu’il le souhaite.
Les pouvoirs royaux ont été renforcés depuis la réforme constitutionnelle de 2016. Désormais, les décrets de nomination émis par Abdallah II n’ont plus besoin d’être contre signés par le Premier ministre.
La réforme constitutionnelle de 2022 : une ouverture en trompe‑l’œil ?
Quelques mois avant le processus de réforme, en 2021, une vingtaine de personnes sont arrêtées par les services de sécurité, accusées d’avoir fomenté un coup d’État. Parmi les supposés coupables, le prince Hamzah bin Hussein, demi-frère du roi et figure appréciée de la population. Dans une vidéo relayée à la BBC, il niait la tentative de coup d’État et diffusait une parole très critique en dénonçant la corruption et la montée de la répression politique.
Dans ce contexte politico-médiatique, l’annonce de réformes formulées par un « Comité royal pour la modernisation du système politique » avait été perçue comme une tentative d’apaiser la colère sociale et une preuve que la monarchie avançait vers une démocratisation des institutions. Par exemple, la nouvelle loi électorale, promulguée en 2022, réserve désormais 41 sièges aux partis politiques, répondant ainsi à une demande formulée depuis longtemps par l’opposition. Néanmoins, toutes les mesures annoncées n’ont pas reçu le même accueil : la création du Conseil national de sécurité – organe composé de plusieurs ministres, du chef d’état-major et du chef des renseignements – a suscité de vives critiques. Pour nombre de Jordaniens, ce Conseil national de sécurité est une nouvelle façon de contourner les institutions existantes, comme le Parlement.
Les élections législatives tenues en septembre 2024 ont été marquées par la percée du Front d’action islamique (FAI), branche politique des Frères musulmans. Comment l’expliquer ?
Le Front d’action islamique a connu sa plus nette victoire depuis sa fondation. Les membres du parti semblaient eux-mêmes surpris à l’annonce d’un tel score : ils sont parvenus à obtenir 31 sièges, dont 8 détenus par des femmes. Par ailleurs, le succès est global, il ne se limite pas à quelques zones géographiques mais touche l’ensemble du pays. Ces résultats sont aussi cohérents avec ceux des élections étudiantes survenues quelques mois plus tôt : les listes affiliées à la confrérie des Frères musulmans sont notamment arrivées en tête à l’Université de Jordanie, basée à Amman. Le contexte régional, et en particulier l’impact de la guerre génocidaire menée par le gouvernement israélien à Gaza, a pu jouer en faveur du parti, perçu comme le principal défenseur de la cause palestinienne dans le pays.
Une faible participation électorale
Le taux de participation a dépassé de peu la barre des 30 %, légèrement au-dessus de celui obtenu en 2020. Pour un scrutin attendu et médiatisé, ce chiffre a pu surprendre à première vue, mais il reflète à la fois le désintérêt des citoyens – le Parlement étant perçu comme une institution sans pouvoir – et le mécontentement croissant face à la montée de la répression et la concentration accrue du pouvoir politique.
Quelques mois après ces élections, Amman décide d’interdire les activités des Frères musulmans. Pourquoi ?
Si la confrérie n’avait déjà plus d’existence juridique sur le sol jordanien depuis 2020, cette interdiction totale a eu lieu quelques jours après l’arrestation de plusieurs individus ayant déclaré être affiliés aux Frères musulmans, accusés d’être en détention d’armes et d’avoir projeté une attaque sur le sol jordanien. Outre cet évènement, la décision est un moyen d’endiguer la popularité montante des Frères musulmans et reflète la détérioration des relations entre le gouvernement et la confrérie. Celle-ci n’a cessé de dénoncer la poursuite de la collaboration diplomatique et économique entre l’État jordanien et Israël. Enfin, le jeu des alliances géopolitiques a certainement pesé sur le verdict. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, deux partenaires stratégiques de la Jordanie, considèrent les Frères musulmans comme une menace régionale.
L’équilibre économique jordanien peut-il résister face aux bouleversements régionaux ?
La crise régionale a mis à mal le secteur du tourisme, pilier de l’économie nationale puisqu’il emploie plusieurs dizaines de milliers de Jordaniens et représentait 18 % du PIB en 2023 (avant le 7 octobre). Les revenus d’hôtels ont chuté sur plusieurs mois, jusqu’à devenir largement inférieurs aux prévisions (-65 %). Pour limiter les conséquences en cascade, le gouvernement a cessé temporairement les prélèvements des cotisations sociales pour les entreprises les plus touchées.
C’est dans ce contexte économique fragile que l’arrivée au pouvoir du président Trump et la remise en question du soutien financier américain a créé de vives inquiétudes. Inquiétudes justifiées, car la Jordanie dépend massivement et structurellement de cette aide, c’est l’un des principaux pays receveurs dans la région. En avril 2025, le Roi aurait reçu des garanties, a priori solides, de la part de Donald Trump pour laisser intacte l’assistance militaire et le soutien budgétaire (environ un milliard et demi de dollars américains). La pérennité de l’aide américaine est toutefois moins évidente lorsqu’il s’agit du secteur de l’éducation et de la santé.
Le mythe de stabilité à nuancer
Le « mythe » d’un pays stable dans une région en proie aux conflits est en réalité un discours politique coconstruit par les autorités jordaniennes et les bailleurs de fonds internationaux, qui ont tout intérêt à présenter la monarchie comme un modèle politique, une oasis de stabilité, faisant ainsi d’elle l’allié idéal au Moyen-Orient. Or, ce narratif a invisibilisé les transformations qu’a traversé la scène politique et la société jordanienne. Les mobilisations contestataires font partie du quotidien de la Jordanie, tout comme les réponses apportées par les autorités qui oscillent toujours entre la répression et la réforme politique maîtrisée.