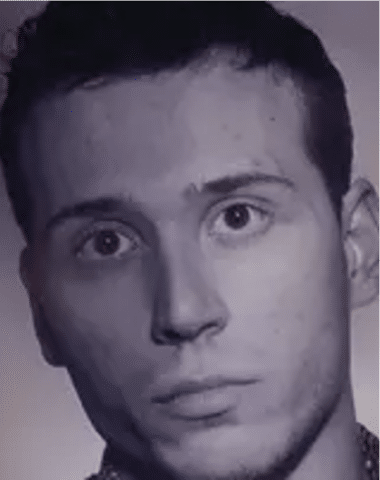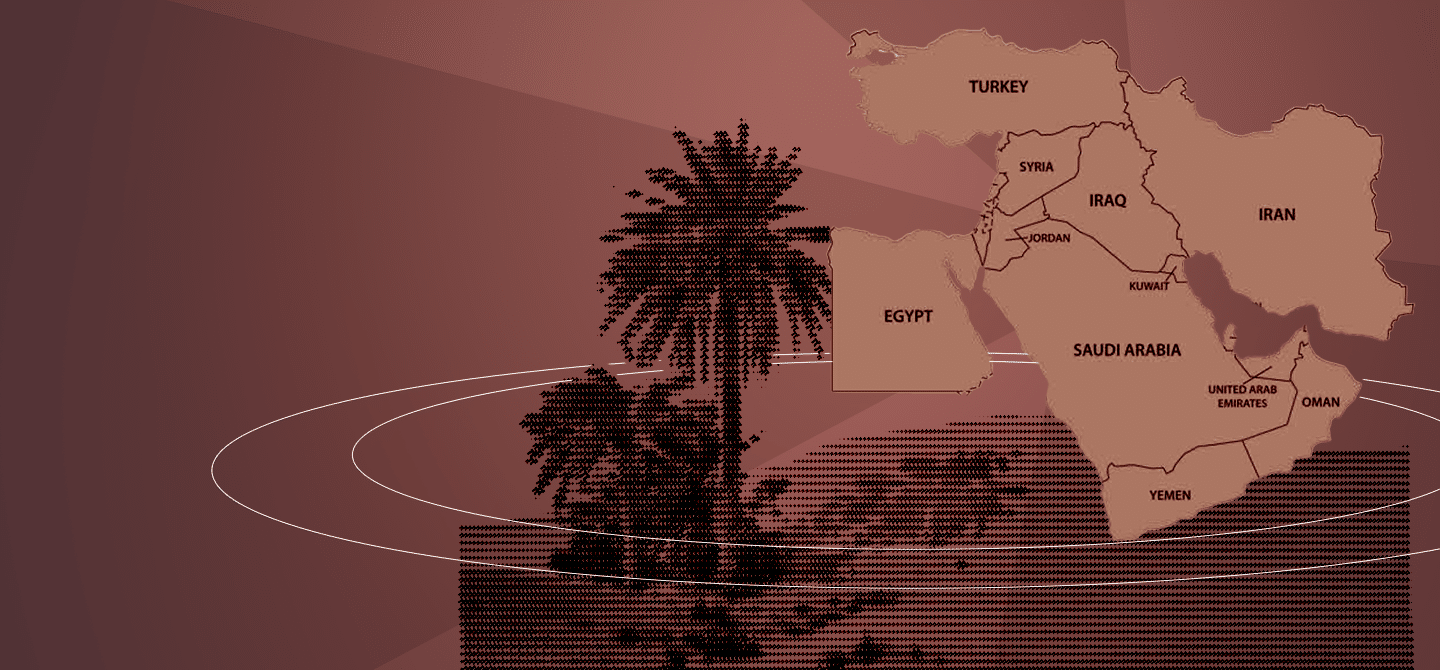Résilience cognitive face aux crises complexes : l’enjeu de la « gamification »
- La résilience cognitive correspond à la capacité à garder son sang-froid, à s’adapter et à prendre de meilleures décisions en situation de stress et de surcharge d’information.
- Les méthodes classiques d’entrainement à la résilience cognitive montrent leurs limites, il est nécessaire de moderniser ces outils pour mieux se préparer.
- Pour ce faire, la simulation et la ludification permettent des expériences plus dynamiques, interactives, et davantage proches des conditions de complexité actuelles des crises.
- La ludification offre un cadre qui stimule la complexité cognitive obligeant à prendre des décisions dans des environnements incertains.
- Cependant, le développement de ces technologies soulève des questions éthiques et déontologiques, comme la protection des données et une utilisation des données sans dérives manipulatrices ou de conditionnement.
Face à l’accélération des crises internationales de plus en plus complexes et incertaines, la question de la résilience cognitive est devenue centrale. Ce concept, qui désigne la capacité à garder son sang-froid, à s’adapter et à prendre les meilleures décisions en situation de stress, de surcharge d’informations ainsi que d’ambiguïté, est désormais un enjeu majeur pour les décideurs, militaires comme civils.
Malheureusement, les méthodes classiques d’entraînement reposant sur des procédures figées et des scénarios relativement prévisibles montrent leurs limites. Elles ne reflètent pas suffisamment la réalité mouvante, parfois chaotique, dans laquelle les acteurs doivent évoluer aujourd’hui. C’est là que la simulation et la ludification — aussi nommée gamification — entrent en jeu, en proposant des expériences plus dynamiques, interactives et surtout plus proches de la complexité réelle des crises1.
L’insuffisance des simulateurs traditionnels
La formation à la gestion de crise s’est appuyée sur des simulateurs conçus pour reproduire des situations plutôt linéaires, où les résultats sont relativement prévisibles. Cette approche est efficace quand il s’agit d’apprendre des procédures ou des réflexes, mais s’avère insuffisante pour préparer aux crises hybrides, cyber, ou aux conflits asymétriques où l’information est incomplète, brouillée voire contradictoire. Que faudrait-il faire si des attaques frappaient simultanément plusieurs infrastructures vitales comme les secteurs énergétiques2, les télécommunications3et le domaine informationnel4 ?

Dans ces conditions, la prise de décision devient un véritable défi cognitif, influencé par la charge mentale et les émotions, ainsi que par des biais parfois inconscients5. Ces aspects humains, essentiels, sont trop souvent absents des formations classiques, ce qui limite leur efficacité dans des situations imprévisibles6. Il est donc nécessaire de moderniser les outils à notre disposition pour mieux se préparer.
Les grandes puissances à la pointe des technologies cognitives
Pour répondre à ces défis, plusieurs pays ont développé des solutions innovantes. Aux États-Unis, par exemple, la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, un organisme de recherche et de développement de technologies militaires), mise sur des simulateurs immersifs qui intègrent des capteurs biométriques pour mesurer en temps réel la charge cognitive et l’état émotionnel des opérateurs. Cela permet d’ajuster automatiquement la difficulté des exercices et d’offrir un entraînement personnalisé7.
En Chine, l’approche est encore plus ambitieuse, avec le développement d’interfaces cerveau-machine visant à augmenter directement les capacités cognitives, comme la vigilance ou la mémoire, dans des environnements simulés très complexes8. En Europe, on observe une démarche plus interdisciplinaire, combinant intelligence artificielle, sciences cognitives et analyse sociale pour mieux modéliser la prise de décision humaine en crise9. Mais, l’intégration de ces recherches dans les systèmes de formation reste encore à généraliser.
Le développement de ces technologies soulève des questions éthiques et déontologiques, comme l’utilisation et la protection des données.
Néanmoins, le développement de ces technologies soulève des questions éthiques et déontologiques cruciales. Il est impératif de garantir la protection des données et de s’assurer que ces outils d’augmentation cognitive sont utilisés dans un cadre éthique strict, sans dérive manipulatrice ou conditionnante et, dans l’intérêt des citoyens, c’est-à-dire non exclusivement à des fins commerciales ou militaires10.
Ludification : plus qu’un simple outil ludique
La ludification est parfois perçue comme une manière de rendre l’apprentissage plus fun, mais son potentiel va bien au-delà. Quand elle est bien conçue, elle offre un cadre qui simule la complexité cognitive, obligeant les participants à prendre des décisions dans des environnements incertains, avec des conséquences qui peuvent être imprévisibles11. Ces serious games, notamment ceux qui proposent des scénarios à embranchements multiples, sont des terrains d’entraînement efficaces pour développer la capacité d’adaptation, la gestion du stress et la prise de décision sous pression12. Dans la formation aux crises cyber, par exemple, leur efficacité a été confirmée par plusieurs études13.

De plus, l’intégration de l’intelligence artificielle générative dans la conception de ces serious games ouvre la voie à des scénarios encore plus dynamiques, où l’IA peut générer des événements, des personnages ou des rebondissements en temps réel, rendant chaque session d’entraînement unique et exigeant une adaptabilité cognitive accrue14.
Les innovations françaises : un travail discret mais concret
Entre 2022 et 2024, la SRAT (System Risk Assessment and Technology) a mené plusieurs travaux qui illustrent parfaitement cette dynamique. Cette équipe a développé un simulateur basé sur le moteur Unity, recréant un centre de gestion de crise en zone conflictuelle où les décisions des utilisateurs influencent le déroulement, introduisant ainsi la notion d’incertitude et d’imprévisibilité. Couplé à une interface électroencéphalographie (EEG), ce simulateur mesure en temps réel la charge cognitive et les émotions des utilisateurs, offrant un retour précieux sur leurs mécanismes de décision. En parallèle, la SRAT a travaillé sur le projet C‑RAND, un benchmark des technologies émergentes en interfaces cyber-cognitives, en collaboration avec l’Armée de Terre. Ce travail a permis de sélectionner les solutions les plus adaptées pour les intégrer dans les systèmes d’entraînement et d’opérations15.
Un autre projet marquant est le développement d’un serious game numérique en HTML, utilisé à la fois pour la formation d’étudiants en Master et d’officiers de l’École Militaire Interarmes. Ce jeu met en scène une crise cyber aux ramifications multiples, obligeant à gérer la surcharge d’information et à prendre des décisions rapides et pertinentes. Les retours d’expérience montrent une amélioration notable des capacités d’adaptation et de gestion du stress16. Enfin, la SRAT a dispensé plus de 100 heures d’enseignement mêlant intelligence artificielle, sciences cognitives et stratégie au sein de l’Enseignement Militaire Supérieur Scientifique et Technique (EMSST), préparant ainsi les futurs cadres aux défis cognitifs des crises contemporaines.
La simulation et la ludification sont des outils stratégiques capables de transformer la formation et d’augmenter la résilience cognitive des décideurs.
Pour maximiser l’impact de ces outils sur la formation des apprenants, le rôle du débriefing et du retour d’expérience structuré est crucial. L’analyse post-simulation, où les données collectées (charge cognitive, émotions, décisions) sont utilisées pour un feedback personnalisé, permet aux participants de comprendre leurs biais et d’intégrer durablement les apprentissages.
Vers une souveraineté cognitive renforcée
Ces différentes approches montrent clairement que simulation et ludification ne sont pas de simples gadgets, mais des outils stratégiques capables de transformer la formation et d’augmenter la résilience cognitive des décideurs. Dans un monde où l’information est un levier de pouvoir et où la rapidité de décision peut faire la différence entre succès et échec, il devient essentiel de renforcer cette capacité d’adaptation et de prise de décision sous stress17. La souveraineté cognitive, au même titre que la souveraineté technologique, est désormais un enjeu de sécurité nationale.
Il est également important de considérer que la résilience cognitive n’est pas uniquement l’apanage des décideurs ; une approche ouverte à chaque citoyen permettrait de sensibiliser et préparer un public plus large aux défis cognitifs des crises contemporaines (désinformation, rumeurs, urgences). Dans le contexte actuel d’attaques hybrides visant à désinformer, à attiser les haines et à briser la cohésion nationale, l’éveil des esprits constitue un levier puissant de résistance à développer.
Mais il ne s’agit pas seulement de technologie. La résilience cognitive est un processus complexe qui demande une approche intégrée, mêlant technologie, compréhension humaine et pédagogie adaptée. Les travaux de la SRAT en France montrent la voie, avec une approche pragmatique, rigoureuse et proche des besoins réels des forces armées. L’enjeu est désormais d’assurer la diffusion et l’adoption à plus grande échelle de ces innovations, pour que la formation cognitive devienne une réalité opérationnelle et un atout dans la gestion des crises de demain.
La simulation et la ludification ouvrent des perspectives passionnantes pour relever le défi de la résilience cognitive. Plus que jamais, il faut penser ces outils comme des leviers indispensables pour préparer les décideurs aux réalités complexes et incertaines des crises modernes. La combinaison des progrès technologiques avec une approche centrée sur l’humain est la clé pour construire une véritable souveraineté cognitive, garante d’efficacité et de sécurité dans un monde en mutation rapide.