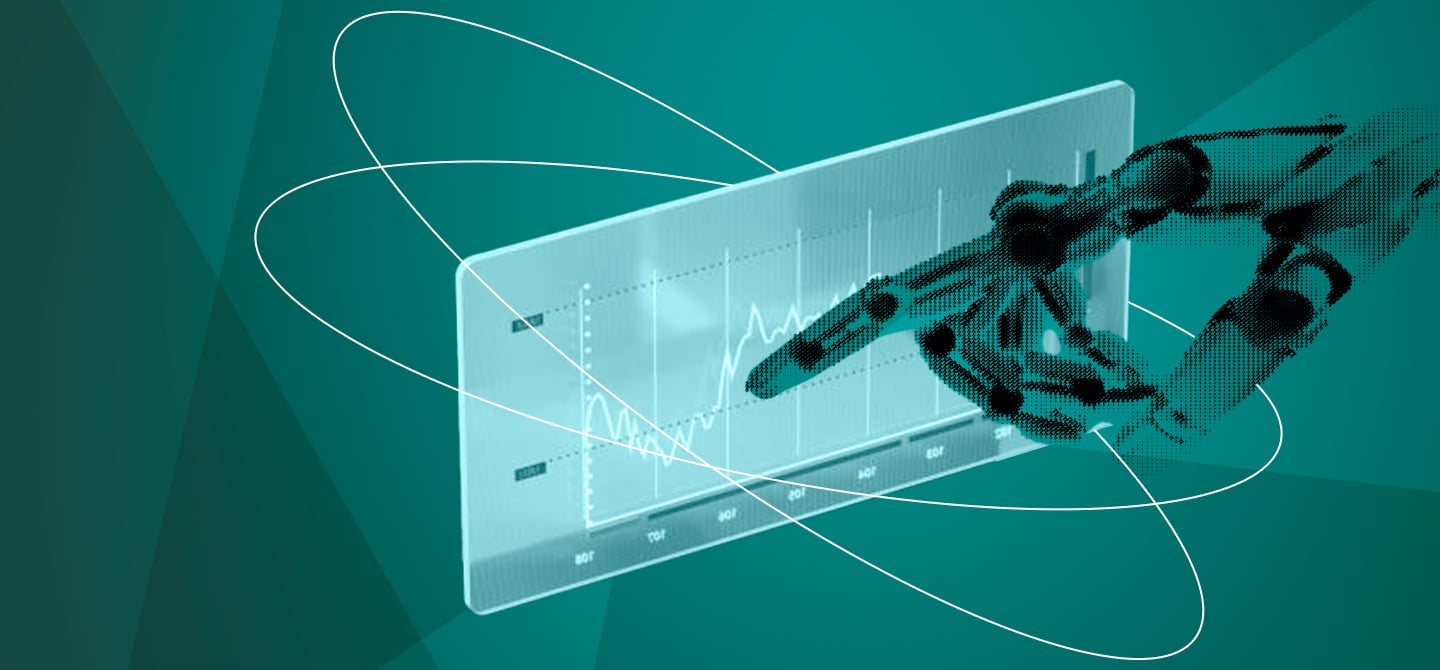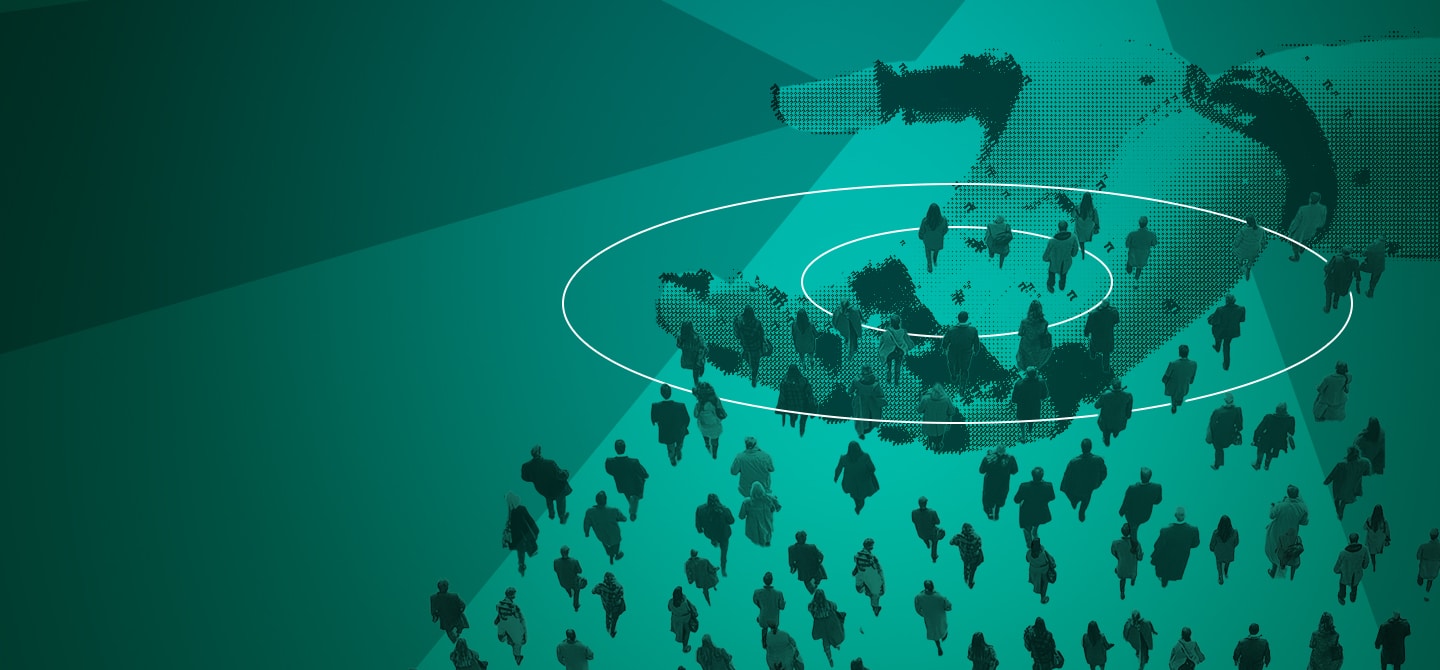La prise de conscience des risques d’une IA non réglementée ne s’est pas fait attendre. Que ce soit pour la discrimination systématique des candidatures féminines de l’outil de recrutement d’Amazon1, ou lorsque l’algorithme d’analyse faciale de HireVue a saboté les candidatures de personnes neurodivergentes2, dans les deux cas, les critiques sont devenues virales et justifiées. Aujourd’hui, l’Europe montre la voie en matière de législation sur l’IA touchant de nombreux secteurs sensibles. La loi européenne sur l’intelligence artificielle, l’IA Act, est le premier cadre réglementaire complet au monde. Il prétend éviter de tels échecs tout en transformant le déploiement de l’IA dans les entreprises, en particulier dans les secteurs à haut risque.
Prospérer dans le monde de l’IA
À elles seules, les entreprises françaises ont investi plus d’un milliard d’euros dans les technologies d’IA en 2023 et au total, 35 % des entreprises françaises déploient activement des systèmes d’IA, selon Business France3. La tendance est évidente : le déploiement de l’IA au niveau industriel est en augmentation. Si les obligations contraignantes de la loi sur l’IA sont entrées en vigueur ce mois4, le choix fondamental appartient aux entreprises. D’un côté, soit elles considèrent la conformité comme une charge réglementaire pesant sur les services juridiques, de l’autre, soit elles la transforment en une capacité distinctive qui les aide à prospérer dans le monde de l’IA.
« Les entreprises qui intègrent les exigences légales dans leurs principes de conception peuvent transformer la conformité en un avantage stratégique », explique Jean de Bodinat, fondateur de Rakam AI et enseignant à l’École polytechnique (IP Paris). La réglementation établit un système de classification basé sur les risques. Ces systèmes d’IA « à haut risque » dont les exigences sont les plus strictes, affectent la santé, la sécurité et les droits fondamentaux. Parmi tous les critères qui régissent ces systèmes de classification figurent : la gestion obligatoire des risques, la gouvernance des données, la documentation technique, la supervision humaine et les systèmes de gestion de la qualité. Dans quatre secteurs les systèmes d’IA « à haut risque » sont particulièrement concernés par la législation.
L’éducation : transparence de la notation par l’IA
Dans les salles de classe françaises et sur les plateformes d’apprentissage en ligne, les outils d’évaluation basés sur l’IA transforment non seulement l’éducation, mais sont également confrontés à un fardeau réglementaire important. Les systèmes d’IA éducatifs entrent dans la catégorie « à haut risque » en raison de leur influence directe sur les résultats scolaires. Par exemple, la plateforme e‑LATE5 de Lingueo, spécialisée dans les évaluations linguistiques personnalisées en utilisant la reconnaissance vocale et la notation automatisée. Leurs apprenants reçoivent des commentaires ciblés tandis que les enseignants gardent un œil sur le processus grâce à des tableaux de bord. Un système qui illustre comment les technologies éducatives peuvent répondre aux exigences de la loi sur l’IA tout en apportant une valeur ajoutée à l’enseignement.
Élèves et enseignants doivent comprendre comment les décisions automatisées sont prises.
« Le défi ne réside pas seulement dans la précision technique, mais aussi dans l’équité et la transparence », note Solène Gérardin, avocate et spécialiste de la loi sur l’IA qui conseille les entreprises en matière de conformité. « Les élèves et les enseignants doivent comprendre comment les décisions automatisées sont prises. » La plateforme répond à cette exigence en séparant la génération de contenu par l’IA des processus d’évaluation, en mettant en place des filtres de contenu robustes et en fournissant des interfaces claires pour la supervision des enseignants. Plus important encore, elle conserve des journaux d’utilisation complets à des fins d’auditabilité, une exigence qui est en train de devenir la norme dans le domaine des technologies éducatives.
Des exemples externes viennent renforcer cette approche. Des plateformes telles que Gradescope et Knewton adoptent des solutions d’IA explicables qui aident les élèves et les enseignants à comprendre les décisions de notation automatisées. Leurs succès démontrent que les exigences en matière de transparence peuvent réellement améliorer les résultats scolaires en instaurant la confiance entre les apprenants, les enseignants et les systèmes d’IA.
Éliminer les préjugés lors du recrutement
C’est peut-être dans le domaine du recrutement que l’impact de la loi sur l’IA est le plus visible, car ces systèmes automatisés d’évaluation des candidatures transforment et parfois faussent les pratiques d’embauche. Ces systèmes, qui filtrent les CV et classent les candidats à l’aide du traitement du langage naturel, constituent un exemple typique d’IA à haut risque au regard de la nouvelle réglementation. Les mises en garde sont bien documentées. Amazon a abandonné son outil de recrutement basé sur l’IA après avoir découvert qu’il pénalisait les CV contenant des mots tels que « femmes ». HireVue a été critiqué pour ses algorithmes d’analyse faciale qui désavantageaient les candidats neurodivergents. À l’avenir, pour éviter de telles discriminations, la loi sur l’IA exige la transparence dans les décisions d’embauche automatisées et accorde aux candidats le droit de contester les résultats basés sur l’IA.

D’ailleurs, l’opérateur Orange propose un modèle plus prometteur. Traitant plus de deux millions de candidatures par an à l’aide de systèmes d’IA développés avec Google Cloud, l’entreprise met en correspondance les candidats avec les descriptions de poste tout en signalant ces résultats pour validation humaine. En intégrant des algorithmes sensibles à l’équité et avec procédures d’audit complètes, l’entreprise a fait progresser sa diversité des genres dans les postes techniques. Cette approche montre comment des exigences réglementaires peuvent s’aligner sur des objectifs commerciaux, car les équipes diversifiées sont souvent plus performantes. De plus, cette pratique de recrutement transparente renforce la réputation de l’employeur6.
Mais la mise en œuvre technique implique des systèmes modulaires qui séparent les couches de prétraitement des données, de notation et de supervision. Cette architecture, guidée par des cadres tels que SMACTR (Système, Métadonnées, Auditabilité, Contexte, Traçabilité, Responsabilité), permet d’identifier et de corriger rapidement les problèmes de biais. Les principales stratégies de conformité comprennent l’utilisation d’ensembles de données représentatifs incluant au moins 20 % de groupes minoritaires, l’enregistrement et la justification de tous les résultats de classement, la possibilité pour les candidats de se désinscrire et la réalisation d’audits réguliers sur les biais. Plutôt que de restreindre les décisions d’embauche, ces exigences poussent les entreprises vers des pratiques de recrutement plus équitables et plus défendables7.
La sécurisation des données médicales sensibles
Dans le domaine de la santé, les enjeux réglementaires atteignent leur paroxysme, car les systèmes d’IA traitent des données médicales sensibles et influencent les décisions relatives aux soins des patients. L’exemple des systèmes de gestion pour les demandes de remboursement d’assurance maladie illustre bien ce défi, puisqu’ils relèvent à la fois de la classification à haut risque de la loi sur l’IA et des protections strictes des données médicales prévues par le RGPD8. L’agent de gestion des demandes de remboursement alimenté par l’IA de l’entreprise Lola Health montre comment les organismes de santé peuvent naviguer dans ce paysage réglementaire complexe. L’agent conversationnel fonctionne au sein de la plateforme numérique de Lola Health et assiste les membres et les professionnels de l’assurance pour les questions de couverture, les demandes de remboursement et les mises à jour de statut.
La conformité devient un cadre pour l’excellence opérationnelle plutôt qu’un fardeau bureaucratique.
L’architecture du système reflète une approche globale de la conformité. Elle permet la récupération en temps réel de données contractuelles personnalisées, tandis que l’authentification sécurisée protège les informations sensibles. Plus important encore, le système conserve des redirections vers des conseillers humains pour les demandes complexes, une exigence qui améliore réellement le service à la clientèle.
Cependant, le traitement de grands volumes de données de santé augmente les risques de violation, mais il crée également des opportunités pour un meilleur accompagnement des patients. L’agent fournit une assistance personnalisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et accélère le temps de résolution des dossiers. Indirectement, il réduit les coûts d’assistance tout en maintenant un niveau élevé de satisfaction des clients grâce à des conseils clairs et à la garantie de la confidentialité.
Les stratégies d’atténuation des risques comprennent une IA explicable pour la transparence des décisions, des mesures de protection de la vie privée solides avec un accès authentifié et un cryptage sécurisé, ainsi que des audits réguliers des conseils fournis par les chatbots, afin d’améliorer la qualité du service et de prévenir les biais. Ces mesures, imposées par la réglementation, améliorent à la fois les performances opérationnelles et la confiance des utilisateurs. Les examens périodiques requis pour la conformité réglementaire provoquent des avantages inattendus en améliorant les réponses du système et en maintenant des normes de service élevées. La conformité devient un cadre pour l’excellence opérationnelle plutôt qu’un fardeau bureaucratique.
En finance, une équité dans les décisions de crédit
Les systèmes d’évaluation pour obtenir un crédit influencent directement l’accessibilité des particuliers et illustrent la nécessité d’une réglementation dans la finance. Ces systèmes doivent répondre à des exigences en matière d’équité, de transparence et de responsabilité, tout en conservant leur viabilité commerciale. Les plateformes modernes d’évaluation du crédit utilisent l’apprentissage automatique pour analyser les données des demandeurs et prédire le risque de crédit, en tenant compte de variables telles que les revenus, les antécédents d’endettement, la situation professionnelle et les historiques de transactions. Le défi consiste à s’assurer que ces systèmes ne reproduisent ni n’amplifient les préjugés sociaux.

Les grandes banques françaises ont développé des approches de test d’équité à trois niveaux : un prétraitement pour équilibrer les données d’apprentissage, une surveillance en temps réel pour signaler les disparités démographiques dans les approbations, et un calibrage post-décisionnel pour corriger les biais résiduels tout en maintenant les performances prédictives. Les banques mettent également en place des procédures de recours pour les clients et procèdent régulièrement à des audits indépendants. Les recherches menées par Christophe Pérignon à HEC Paris ont contribué à l’élaboration de cadres statistiques désormais utilisés par les grandes banques pour identifier et atténuer la discrimination dans les modèles de crédit. Les banques qui utilisent ces systèmes équitables ont réduit les écarts d’approbation entre les groupes démographiques à moins de 3 %, tout en maintenant ou en améliorant la précision de la prédiction des risques.
Perspective juridique sur la conformité des IA
Solène Gérardin note qu’il est rarement facile de déterminer si un système d’IA présente un « risque élevé ». Elle estime que la meilleure décision à prendre face à cette ambiguïté est d’être proactif, en concevant dès le départ une IA conforme à la réglementation. Elle indique également que l’Union européenne prévoit de publier des lignes directrices détaillées, comprenant des exemples concrets de cas limites, d’ici début 2026. Une fois ces lignes directrices disponibles, la conformité sera exigée dans tous les secteurs.
Le Code de bonnes pratiques en matière d’IA à usage général (GP-AI) a été publié le mois dernier. Selon le site web officiel de la loi européenne sur l’IA, ces dispositions sont entrées en vigueur en août 20259. Il a été rédigé en collaboration avec près de 1 000 parties prenantes, sous la forme d’un document inclusif qui traduit les exigences générales de la loi en conseils pratiques et concrets sur des principes tels que la transparence, l’atténuation des risques systémiques et le respect des droits d’auteur, entre autres. Ce code a été élaboré afin de promouvoir les valeurs de confiance et de responsabilité au sein de l’écosystème européen de l’IA. Il recoupe également les objectifs ESG (gouvernance environnementale et sociale) et de durabilité, faisant de la conformité en matière d’IA plus qu’une simple obligation légale pour les entreprises. Il s’agit d’une stratégie définitive visant à renforcer la gouvernance et à assurer la compétitivité à long terme.
Les avantages stratégiques d’une conformité précoce
Ces études de cas révèlent une tendance commune : les organisations qui considèrent les obligations de la loi sur l’IA comme des principes de conception plutôt que comme des contraintes obtiennent un meilleur positionnement sur le marché et de meilleures performances opérationnelles. Une mise en conformité précoce offre des avantages concurrentiels qui vont bien au-delà du simple respect de la loi. La transparence des systèmes d’IA renforce la confiance des clients, en particulier dans les secteurs sensibles où les décisions ont un impact significatif sur la vie des individus. Les processus d’approvisionnement favorisent de plus en plus les fournisseurs conformes, créant ainsi des opportunités commerciales pour les organisations préparées. L’accès aux investisseurs soucieux des critères ESG s’améliore, car la conformité est synonyme de gouvernance solide.
Le champ d’application de la loi devrait s’étendre à de nouveaux secteurs, notamment les transports, l’énergie et l’administration publique. Alors que les normes techniques sont encore en cours d’élaboration et que les mécanismes d’application prennent forme, les organisations ont le choix : investir tôt dans une infrastructure de conformité ou se précipiter pour répondre aux exigences à l’approche des échéances. La loi européenne sur l’IA transforme la conformité d’une charge réglementaire en un atout stratégique. Pour les entreprises qui naviguent dans cette transition, le message est clair : l’avenir appartient à celles qui intègrent la conformité dans leur stratégie concurrentielle dès le départ.