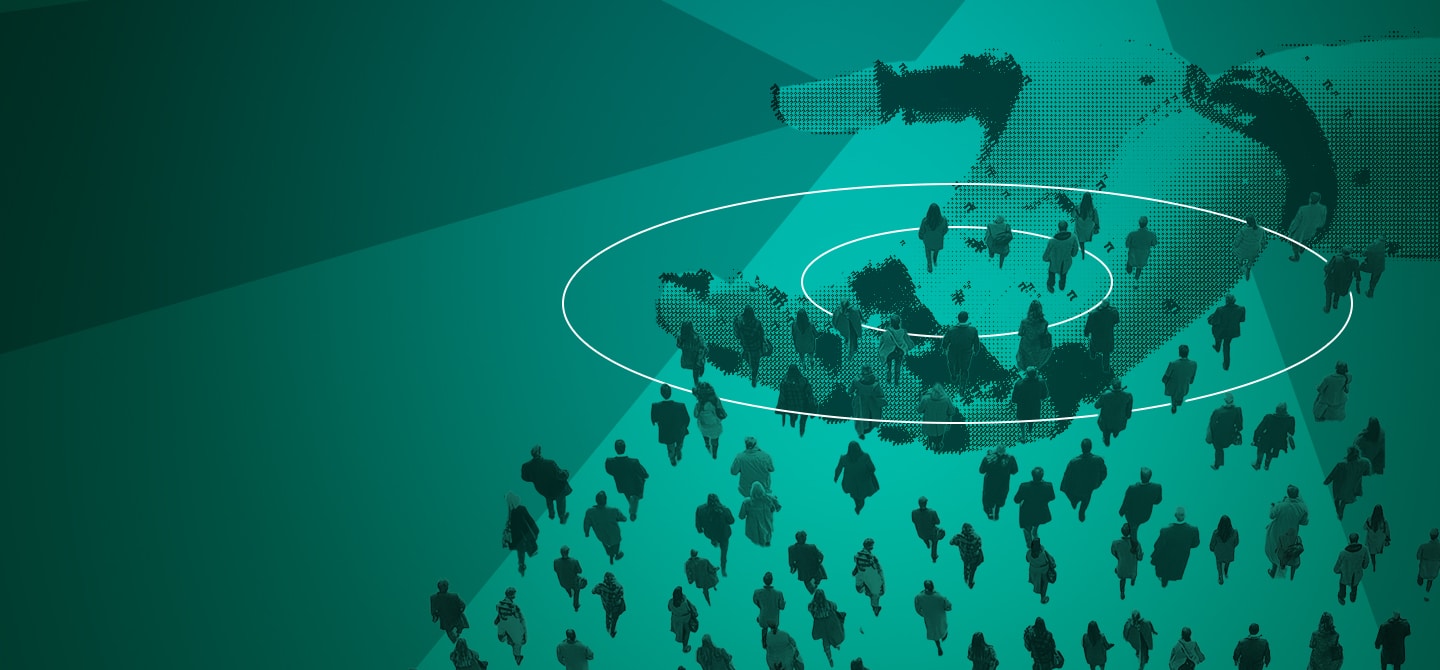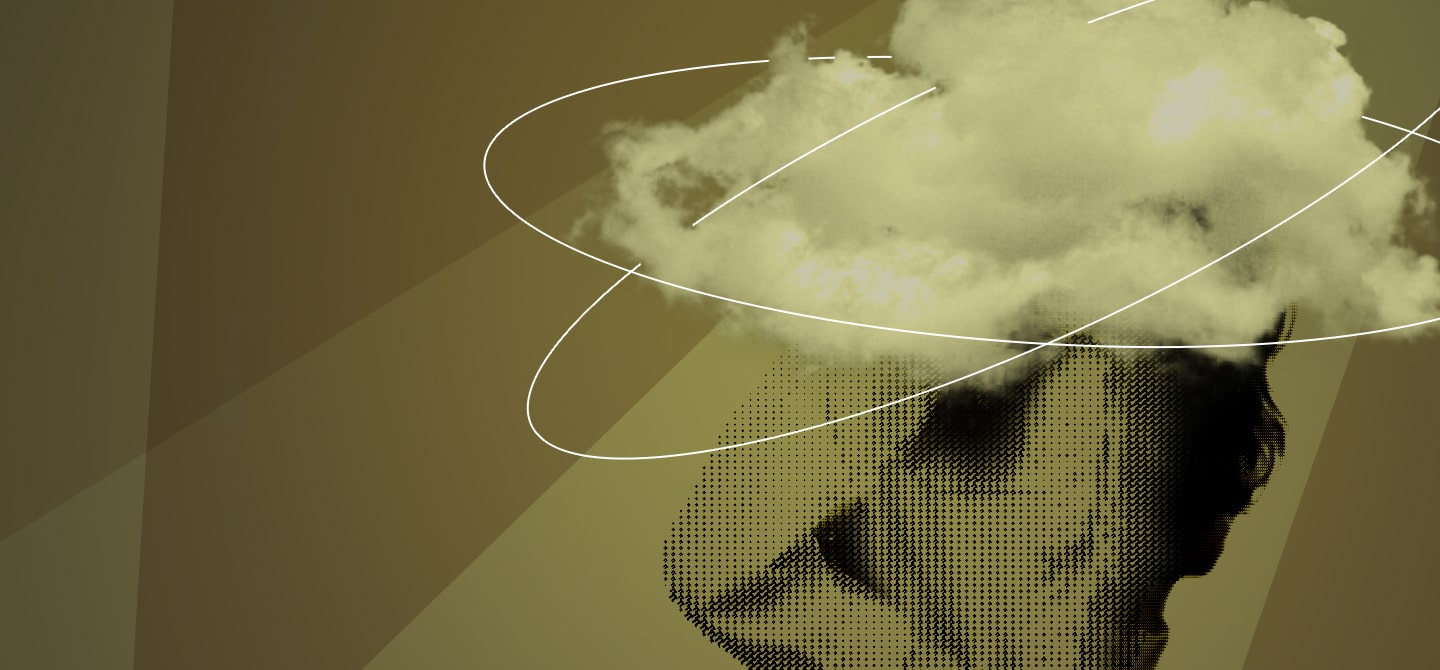IA en Europe : réguler ne suffit plus, il faut désormais innover
- Les États-Unis détiennent un monopole dans le domaine du numérique grâce à des investissements massifs et à des choix technologiques stratégiques.
- L’Europe investit aujourd’hui dans le numérique par le biais de la recherche, notamment à travers ses programmes-cadres et les réglementations adoptées.
- Cependant, l’exemple du Health Data Hub illustre le fait que l’Europe a mis trop de temps à prendre conscience de sa forte dépendance au numérique américain.
- Pour combler son retard, le paradigme des communs numériques est une solution possible : en France, le secteur public s’y intéresse de plus en plus.
- Les communs numériques permettent de renforcer l’autonomie stratégique, de tirer parti de l’intelligence collective et de favoriser une dynamique de coproduction avec les usagers.
« Arrêtons de consommer américain ! » Ce mot d’ordre, assez tranché, semble avoir un tant soit peu circulé à la suite des annonces de tarifs douaniers de Donald Trump : 20 % pour les importations en provenance de l’Europe. Les marchés ont vivement réagi et les producteurs du vieux continent se sont inquiétés. L’Union européenne s’est par ailleurs empressée de réagir, misant sur des négociations jugées encore possibles. En suspens pour quelques mois, la situation a tout de même mis en avant un certain déséquilibre commercial entre les deux alliés historiques. Les Américains achètent bien plus de produits européens que les Européens n’achètent de produits américains — avec un excédent commercial à hauteur de 227 milliards de dollars1. Coca-Cola, ou McDonald’s par exemple, des emblèmes américains, ont la plupart de leur production en Europe. Difficile donc pour les États-Unis de rétorquer sur des tarifs douaniers dans les négociations.
Notre dépendance vis-à-vis du marché américain est plus subtile, elle se niche dans l’immatériel : le numérique. Maintenant que nous avons pu voir en quoi cette dépendance s’est installée jusqu’à influencer nos politiques internes, Valérie Peugeot, professeure affiliée à Sciences Po Paris, dont les travaux portent notamment sur les communs numériques, nous propose des clefs de réflexion pour se détacher de ce quasi-monopole. « Sur le numérique, nous avons laissé le boulevard ouvert aux États-Unis, chez qui il y a eu des investissements conséquents autour de choix technologiques stratégiques, explique-t-elle. Cela dès le début d’Internet, et l’histoire peu connue de Louis Pouzin2le démontre. »
« L’Europe régule, les États-Unis innovent » ?
L’économie du numérique a suivi une trajectoire pour le moins singulière, suscitant, dans un premier temps, la méfiance des investisseurs. Le cas d’Amazon le montre bien, avec des années de pertes financières qui ont finalement amené à l’émergence d’une des entreprises les plus puissantes au monde. Ce modèle de croissance ne vise pas une rentabilité immédiate, il est plutôt fondé sur le principe du « winner takes all » qui permet d’asseoir une domination à long terme. Ceci pourrait expliquer le désengagement des pouvoirs publics européens : « Pour le numérique, à l’inverse de ce qui a pu être fait avec des sociétés comme Airbus, il y a eu un manque de politique industrielle de la part de l’Europe, estime Valérie Peugeot. Car même si historiquement, les États-Unis ont toujours été considérés comme les chantres du libéralisme économique, en réalité, il y a toujours eu des investissements massifs dans le numérique de la part des pouvoirs publics. Derrière Internet, par exemple, il y avait la DARPA3et ses 25 millions de dollars investis dans l’ARPANET de 1966 à 1975 – l’ancêtre du Web. »
Tout cela amène à l’idée, très répandue et amplement réfutée par la chercheuse, que les États-Unis financent l’innovation pendant que l’Union européenne régule. « D’une part, l’Europe investit aussi massivement dans la recherche, à travers ses programmes-cadres. Par ailleurs, tous les règlements européens adoptés récemment, comme l’AI Act (régulation des intelligences artificielles), le DGA (règlement sur la gouvernance des données), le DMA (règlement sur les marchés numériques) ou encore le DSA (règlement européen sur les services numériques) illustrent, certes, une volonté européenne de réguler ce marché, de résister notamment à sa tendance monopolistique, tout en participant à créer de la sécurité juridique. Car le droit est aussi un élément de sécurité pour entreprendre. »
Le Health Data Hub, un exemple français
Il semblerait tout de même que l’Europe ait mis trop de temps à se rendre compte de son « ultra-dépendance » au numérique américain. L’exemple utilisé par Valérie Peugeot pour appuyer cette impression est celui du Health Data Hub, qui a pour mission de récupérer les données de santé des patients, pour les rendre accessibles à la recherche médicale, tout en assurant leur sécurité et protégeant la vie privée des personnes. « Ce service public de la donnée de santé a été présenté à la CNIL dès 2019–2020. Il a directement été question d’utiliser la solution Azure de Microsoft, ce qui a vivement fait réagir la Commission : comment envisager de confier à un acteur soumis au droit états-unien des données aussi sensibles ? se remémore la chercheuse. Cependant, en mettant de côté la question de la protection de la vie privée, la question de la politique industrielle reste posée : pourquoi le gouvernement, dès le début de ce beau projet, n’a pas choisi de flécher cet argent public vers une solution européenne, certes certainement bien moins puissante que celle de Microsoft, mais ce qui aurait permis progressivement de réduire cet écart ? La commande publique comme levier d’autonomie stratégique a été sous-utilisée. »
Tout l’argent investi dans une société états-unienne aurait pu l’être dans un acteur européen.
Bien que Valérie Peugeot semble encore amère quant au choix initial du gouvernement, elle ne peut que se réjouir de la loi SREN, adoptée en 2024, stipulant que les données de santé des Français doivent être hébergées sur un cloud souverain et européen. « Avec cette loi, le Health Data Hub se décide, 5 ans plus tard, à chercher des solutions européennes, explique-t-elle. Malheureusement, cela signifie également une perte de temps. Tout l’argent investi dans une société états-unienne aurait pu l’être dans un acteur européen. Cette perte de temps n’a pu qu’accentuer notre retard à cet égard, les GAFAM générant des revenus qui leur permettent de continuer à creuser l’écart qualitatif qui nous enferme dans un cercle vicieux. »Aujourd’hui, le Health Data Hub devra trouver une solution de transition pour commencer à migrer vers un acteur européen.
Les communs numériques
Mais alors, comment sortir de ce cercle vicieux ? Comment rattraper le retard conséquent dans lequel l’Europe s’est progressivement enfoncée ? Pour l’enseignante-chercheuse, la solution pourrait se trouver dans un choix osé, mais structurant : adopter un tout autre paradigme, celui des communs numériques. « Aujourd’hui, il y a trois manières de gérer une ressource, considère-t-elle. Il y a la propriété privée, la propriété publique et les communs, qui ne relèvent ni du privé ni du public et qui organisent des droits d’usages autour de la ressource. Les communs restent encore assez marginaux dans nos sociétés actuelles. » Cette notion ne date pourtant pas d’hier. Les communs étaient un mode de gestion des terres, des forêts, des puits, des lavoirs ou encore des fours à pain extrêmement répandu jusqu’à la révolution industrielle. Sans pour autant totalement éliminer le droit de propriété privée, il existait un découplage entre la propriété du foncier et les droits d’usage : les paysans, notamment les plus pauvres, avaient le droit de ramasser du bois, de glaner, d’amener leurs bêtes à paître sur les terres appartenant au Roi ou à la noblesse.
« Cette gestion communautaire par les villageois a fini par disparaître sous l’influence de différents penseurs libéraux à partir du 18e siècle : John Locke, Thomas Hobbes, Adam Smith, etc., explique Valérie Peugeot. Ces penseurs ont promu l’idée que la propriété est la condition sine qua non d’une économie et d’une société florissantes. Cela, couplé à la révolution industrielle, a conduit à la privatisation des terres gérées jusque-là en communs, ce qu’on appelle des enclosures. » Mais les communs reviennent au goût du jour, portés entre autres par les technologies numériques, qui facilitent la gestion partagée de ressources dématérialisées et la constitution de communautés déterritorialisées. L’exemple le plus connu de commun numérique est bien entendu Wikipédia, mais on peut citer aussi OpenStreetMap, des logiciels libres comme Nextcloud (alternative allemande à Google Drive, Dropbox ou iCloud), PeerTube (alternative française à YouTube) ou encore Mastodon (alternative allemande à X), etc. « Au cœur même d’Internet et du Web, il y a du commun. Les protocoles de ces infrastructures (TCP/IP, HTTP, HTML, CSS…) sont ouverts, non propriétaires. C’est notamment ce qui a rendu possible l’explosion fulgurante du Web en quelques années, assure-t-elle. N’importe qui, n’importe où, a pu créer un site web sans payer de redevance à qui que ce soit ! »
C’est une manière de transformer le service public, en passant d’une logique descendante à une dynamique de coproduction avec les usagers.
En France, le secteur public s’intéresse de plus en plus aux communs numériques. La DINUM (Direction interministérielle du numérique) dispose d’une direction « open source et communs numériques » ; le ministère de l’éducation nationale a ouvert une « forge des communs numériques éducatifs » pour que la communauté enseignante puisse partager outils et contenus pédagogiques ; l’ADEME lance son troisième « appel à communs » pour encourager la résilience des territoires ; l’IGN soutient les géocommuns, comme Panoramax (alternative française à Google Street View), sans parler des initiatives des collectivités territoriales. « Plusieurs raisons justifient l’intérêt de la puissance publique pour ce qu’on appelle des partenariats public-communs (PPC), insiste Valérie Peugeot. Les communs sont d’abord une façon de gagner en autonomie stratégique, de ne plus dépendre de fournisseurs non européens. C’est ensuite une manière de bénéficier de l’intelligence des foules, celles des contributeurs à ces communs porteurs d’une innovation au plus près des besoins collectifs. C’est enfin une manière de transformer la culture même du service public, en passant d’une logique descendante à une dynamique de coproduction avec les usagers. »
« Les communs constituent ainsi une résistance à un capitalisme informationnel caractérisé par une accumulation et une concentration de capital sans équivalent dans l’histoire industrielle et plus récemment par une intrusion sur la scène politique », conclut-elle. Ces alternatives montrent donc qu’un autre paradigme est possible : celui d’une innovation ascendante soutenue par la puissance publique, gouvernée collectivement, et capable de réduire progressivement l’écart avec les géants du numérique sans pour autant les imiter.