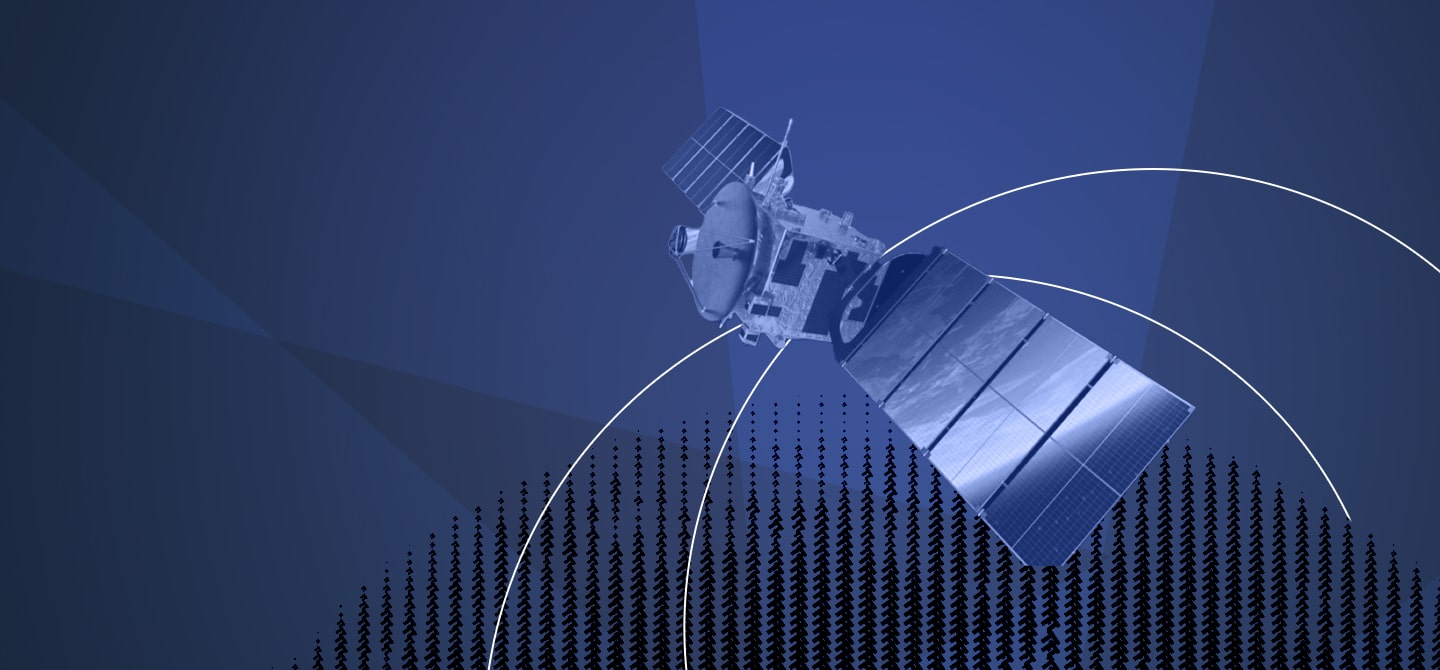Face à l’urgence climatique, les « solutions fondées sur la nature » représentent des solutions d’atténuation prometteuses et relativement simples. Inventé en 2008, ce terme désigne « des actions de protection, de gestion durable et de restauration des écosystèmes naturels et modifiés de façon à relever les défis sociétaux de manière efficace et adaptative, afin d’assurer le bien-être de l’humanité et des bénéfices pour la biodiversité1 ». Ces solutions visent à favoriser le stockage du carbone dans les sols ou la biomasse ou à éviter les émissions, en limitant la déforestation par exemple. Quantifier leur potentiel fait encore l’objet de débat, des évaluations estiment qu’il serait possible d’éviter le rejet de plusieurs dizaines de milliards de tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année.
Quel est le rôle des solutions fondées sur la nature dans l’atténuation du changement climatique ?
Vincent Jassey. Les solutions fondées sur la nature maximisent le stockage du CO2 dans la biomasse ou le sol, entre autres, en s’appuyant sur des processus biologiques naturels. Ces écosystèmes se dégradent en raison des activités humaines et perdent leur potentiel de stockage. Par exemple, les sols représentent un important stock de carbone d’environ 2 500 milliards de tonnes, soit deux fois plus que dans l’atmosphère. Or, la déforestation et l’exploitation des sols réduisent cette capacité. La dégradation d’un milieu riche en carbone comme une tourbière peut relarguer d’importantes quantités de carbone, et leur restauration peut prendre des années. Il est nécessaire de protéger et restaurer les écosystèmes, ce sont des puits de carbone d’une grande importance pour notre avenir.
Quel est l’intérêt de s’appuyer sur les solutions fondées sur la nature pour atténuer le changement climatique ?
Il est important de rappeler qu’une approche globale est nécessaire : conjuguer sobriété et préservation des écosystèmes est essentiel pour lutter contre le changement climatique. Les solutions fondées sur la nature existent déjà et ne nécessitent pas de nouvelles technologies. Cela ne coûte rien, il suffit de laisser faire la nature… C’est pour moi leur principal intérêt. Les sols représentent 25 % du potentiel de stockage des solutions climatiques naturelles, qui s’élève au total à 23,8 milliards de tonnes de CO2e par an [N.D.L.R. : les émissions anthropiques mondiales s’élèvent à 53,8 milliards de tonnes CO2e en 20232].

De plus, préserver les écosystèmes protège la biodiversité. Les tourbières par exemple abritent des espèces végétales, animales et des micro-organismes uniques. Enfin, ces écosystèmes ont une valeur patrimoniale : les carottes de tourbe représentent des archives historiques uniques.
Les solutions basées sur la nature reposent sur trois leviers : protéger, restaurer et gérer durablement les écosystèmes. Quel est le plus important ?
Il faut agir sur les trois leviers. Dans le Jura, des tourbières ont été réhabilitées avec succès. En milieu urbain, nous travaillons actuellement sur un projet visant à maximiser le stockage de carbone dans le sol d’une friche industrielle. Le sol est amendé en biochar et nous ajoutons des plantes fixatrices d’azote dans le but de stocker du carbone et de l’azote dans le sol. La restauration est indispensable mais peut prendre plusieurs années avant d’être efficace.
Dans l’hémisphère Nord, la transformation des tourbières en terres agricoles a relargué environ 40 milliards de tonnes de carbone dans l’atmosphère entre 1750 et 20103. Cela illustre l’importance de préserver ces écosystèmes pour limiter le réchauffement climatique. Enfin, les gestionnaires de réserves naturelles effectuent un important travail de gestion durable qui permet de concilier la préservation de la biodiversité avec leur aspect récréatif.
Un panel d’exemples qui fonctionnent :
Un projet porté par l’Université d’Oxford fournit une carte mondiale interactive recensant les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour les solutions fondées sur la nature. 150 exemples sont documentés à travers le monde, concernant majoritairement des interventions sur la production alimentaire et la restauration d’écosystèmes dégradés. Parmi eux, 62 cas visant à atténuer le changement climatique sont répertoriés : programmes nationaux de restauration des mangroves, de reforestation ou encore protection des forêts.
Existe-t-il des solutions universelles possibles à implémenter à travers le monde ?
Non, car les décisions doivent tenir compte du contexte sociétal et géopolitique. Par exemple, au Canada, les acteurs locaux savent que les tourbières stockent du carbone. Mais elles recouvrent aussi des minerais, ce qui pose un dilemme entre conservation et exploitation.
En France, la tourbe a longtemps été exploitée pour le chauffage, laissant un héritage culturel important dans certaines régions. Une restauration efficace peut néanmoins se faire en préservant des traces de cet héritage. Mais de nombreux exemples documentés existent et démontrent l’efficacité de méthodes de restauration.
D’après Carbon Brief4, certains dénoncent l’utilisation de la nature en tant qu’outil ou rejettent le terme « solutions basées sur la nature » en raison de son imprécision, ouvrant la voie à des abus. Qu’en pensez-vous ?
Il ne faut pas oublier que ce sont des processus naturels qui existent déjà, nous rendent service depuis des millénaires, et que cela demande uniquement de ne pas plus les dégrader. Il peut y avoir certaines dérives ou obstacles. Par exemple, certains envisagent d’ajouter des algues dans les sols pour maximiser l’absorption du CO2. Cela doit être soigneusement étudié pour éviter l’introduction d’espèces invasives par exemple. La restauration d’écosystèmes demande d’importantes compétences naturalistes : ce sont des approches coûteuses en temps, la solution n’est pas immédiate. À court terme, la priorité reste la réduction des émissions de CO2, les solutions fondées sur la nature sont en parallèle une stratégie long-terme pour lutter contre le changement climatique.