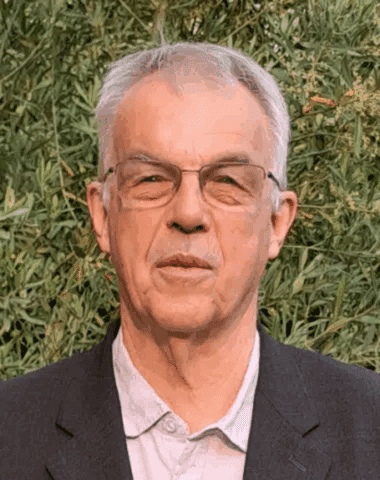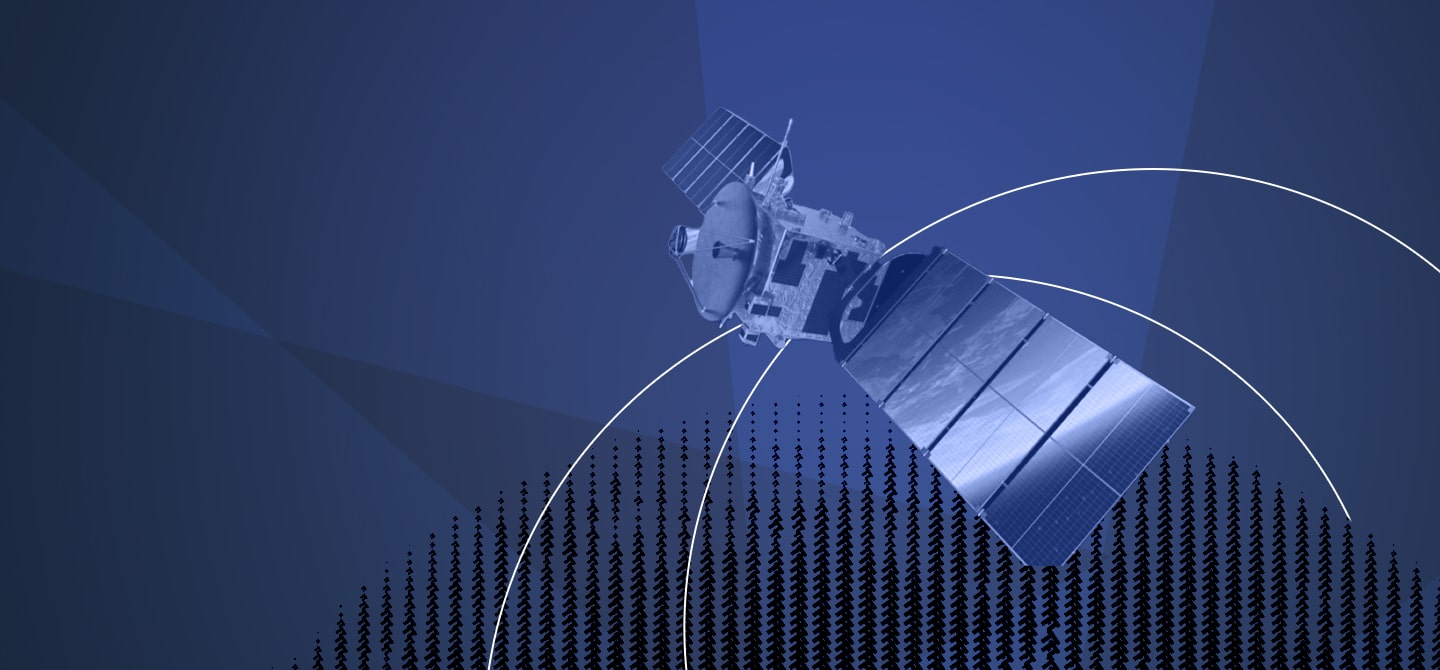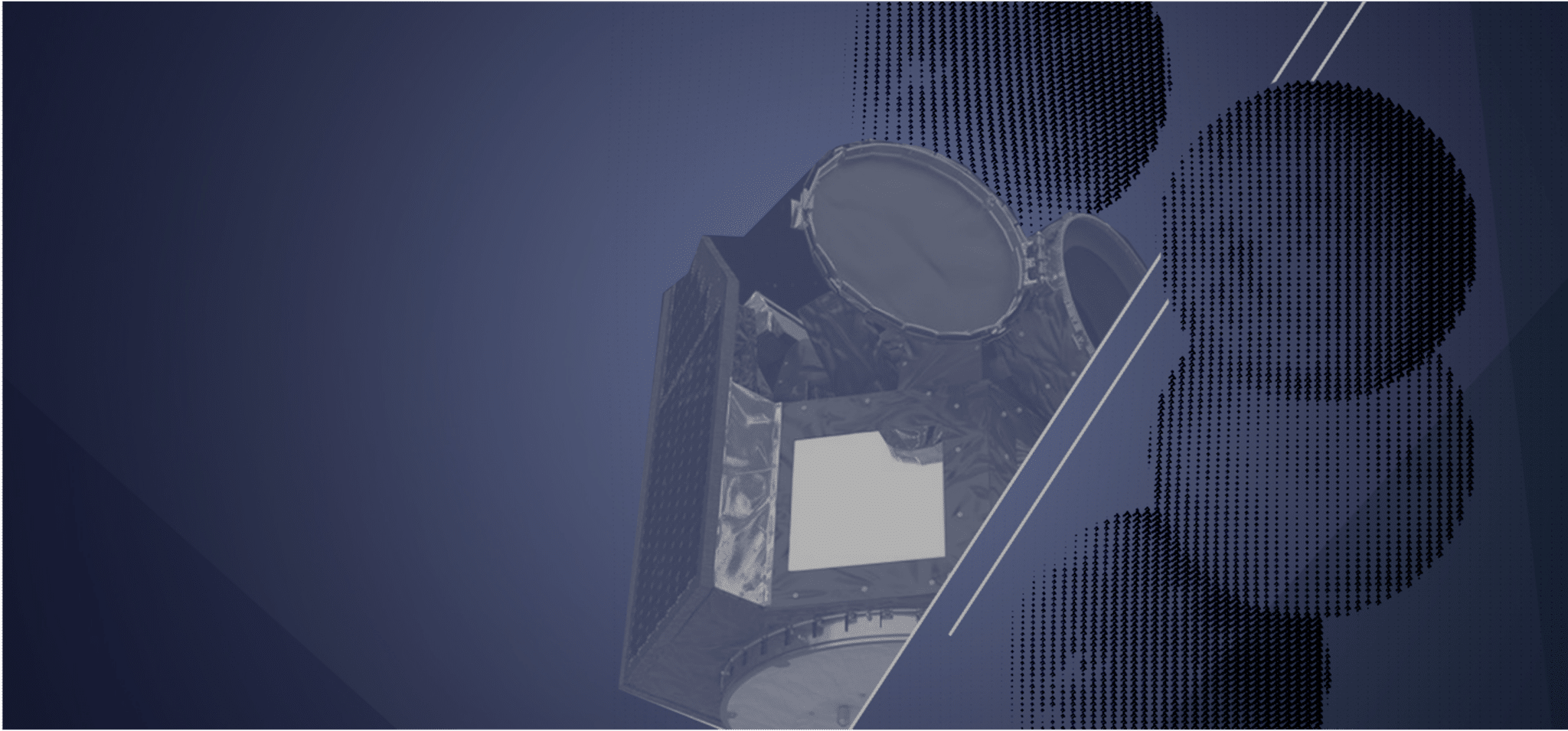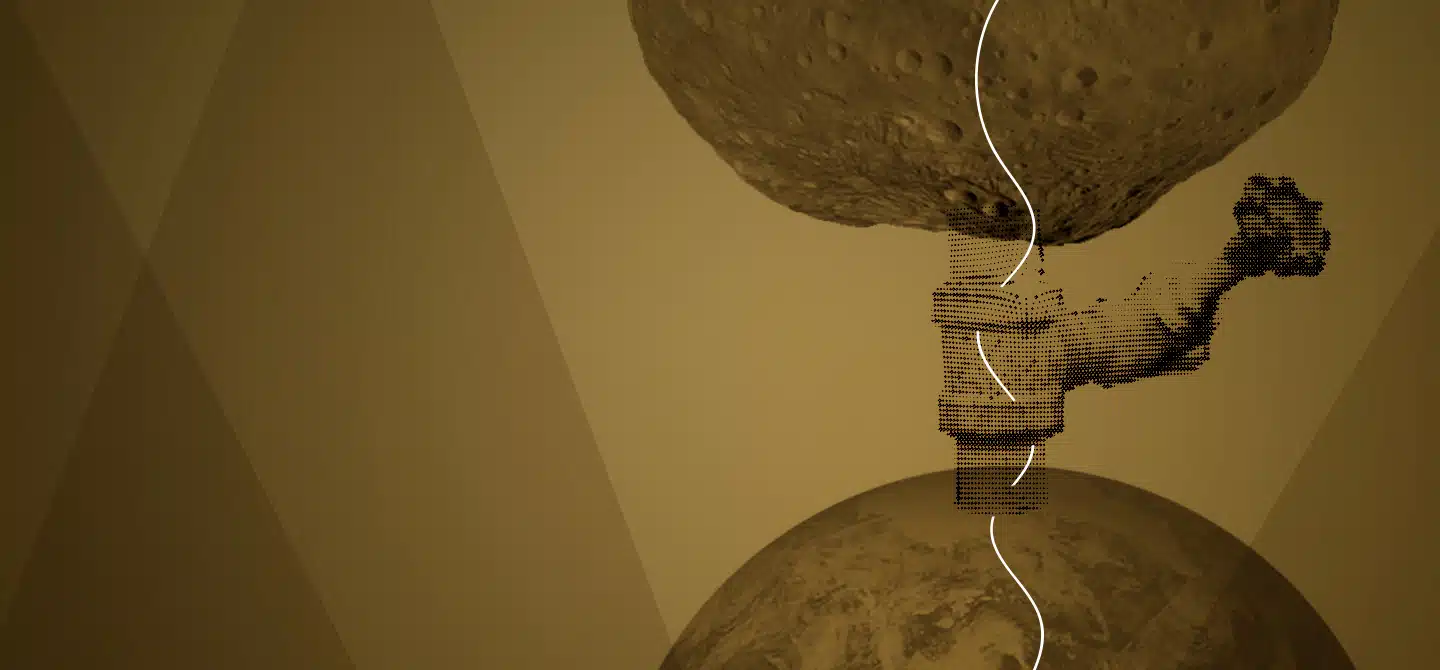Ultraléger, performant, pliable : les progrès du photovoltaïque spatial
- L’effet photovoltaïque, qui exploite les rayons du soleil pour en faire de l’électricité, intéresse de plus en plus le secteur du spatial.
- Au départ, la technologie photovoltaïque n’était compétitive que pour le secteur du spatial, même si l’idée d’utiliser les panneaux sur Terre était déjà présente.
- La plupart des satellites en orbite autour de la Terre sont aujourd’hui équipés de panneaux photovoltaïques, la source d’énergie spatiale la plus compétitive.
- Parmi les innovations du spatial qui pourraient être utiles sur Terre, on compte le fait que le photovoltaïque devient aujourd’hui ultraléger, performant et pliable.
- Aujourd’hui, le coût des cellules pour le spatial s’élève à environ 300 € par watt, contre 10-20 centimes d’euros pour le terrestre.
Quel rôle ont joué les satellites dans la démocratisation des panneaux photovoltaïques ?
Daniel Lincot. L’effet photovoltaïque a été découvert par Edmond Becquerel en 1839. Les cellules solaires au silicium ont été inventées avant la Seconde Guerre mondiale par Russell Ohl, et le premier brevet déposé en 19411. En 1954, la première cellule solaire efficace est fabriquée : elle atteint un rendement de 6 %. Les États-Unis, qui cherchaient à ravitailler les satellites en énergie, ont immédiatement démarré une production de cellules pour les satellites. En 1958, Vanguard 1 est le premier satellite envoyé dans l’espace avec des cellules solaires. Le coût du photovoltaïque était alors extrêmement élevé [N.D.L.R. : Dans les années 1950, un watt de capacité solaire photovoltaïque coûte 1 865 $, ajusté à l’inflation et aux prix de 2019. En comparaison au prix de 1956, un module solaire d’aujourd’hui coûterait 596 800 $2, mais abordable en comparaison avec le coût du lancement d’un satellite dans l’espace. La production de plus en plus importante de cellules solaires pour le spatial enclenche une baisse des coûts, qui se poursuit aujourd’hui. Sans l’usage du photovoltaïque dans le spatial, la technologie ne se serait probablement pas développée aussi vite.
Pourquoi le secteur du spatial est-il autant intéressé par la technologie photovoltaïque ?
Loris Ibarrart. Le satellite est un objet autonome, en particulier du point de vue de l’énergie. Pour mener à bien sa mission – télécommunication, militaire, observation spatiale ou terrestre – il doit pouvoir communiquer et survivre. Ces deux exigences requièrent de l’énergie, pour envoyer et recevoir des informations depuis la Terre, maintenir les équipements à la bonne température ou encore maintenir l’altitude. Enfin, la mission nécessite aussi de l’énergie. Si les missions d’observation de la Terre sont peu énergivores, les télécommunications le sont. Au départ, une pile était placée à bord du satellite. Sa capacité de survie ne s’élevait alors que de quelques semaines. Les acteurs du spatial ont donc pensé à utiliser la seule ressource disponible dans l’espace : le Soleil.
DL. Le premier satellite lancé dans l’espace en 1957, Spoutnik, n’a été en mesure de communiquer avec la Terre que durant quelques semaines ! Il est ensuite resté en orbite autour de la Terre, sans aucun moyen de communication avec lui.
À quel moment les panneaux photovoltaïques sont-ils « redescendus sur Terre » ?
LI. Dès le départ, l’idée d’utiliser les panneaux photovoltaïques sur Terre était présente, mais la technologie n’était compétitive que pour le secteur du spatial.
DL. À partir des années 70, de premiers besoins terrestres ont émergé : équipement des phares et balises dans les zones isolées, moyens de communication dans des lieux inaccessibles ou encore protection cathodique des conduits de pétrole pour limiter leur oxydation. Ces usages très spécifiques toléraient des prix élevés. Puis le coût des cellules a commencé à baisser, notamment à la suite du choc pétrolier de 1973 qui a conduit à une augmentation de la production, et donc une baisse des coûts par effet d’échelle.
Depuis les premiers usages du photovoltaïque dans l’espace, le secteur du spatial a beaucoup évolué… le photovoltaïque y a‑t-il toujours sa place aujourd’hui ?
LI. L’exigence du spatial reste la même : produire un maximum d’énergie à bord pour une masse et un volume les plus contenus possible. La plupart des satellites en orbite autour de la Terre sont équipés de panneaux photovoltaïques. Les satellites de télécom ont la plus grande capacité de production, elle peut grimper jusqu’à une trentaine de kW, soit une surface de cellules solaires d’environ 100 m2. Seules quelques missions ne peuvent pas reposer entièrement sur la ressource solaire : les sondes envoyées dans l’espace lointain ou encore les rovers [N.D.L.R. : les « astromobiles », ces véhicules conçus pour explorer la surface d’un corps céleste]. Elles embarquent un cœur nucléaire, une sorte de pile à radioisotopes. Cette source d’énergie est plus coûteuse et contraignante que le photovoltaïque.
DL. Le photovoltaïque a beaucoup progressé, notamment ses rendements, et demeure la source d’énergie spatiale la plus compétitive. Les rendements des cellules spéciales utilisées (à multi jonctions) peuvent atteindre 35 %. Un rendement record de 47 % a été atteint en laboratoire. En comparaison, ceux des cellules terrestres au silicium s’élèvent jusqu’à 25 %.
Les innovations du photovoltaïque spatial servent-elles les applications terrestres ?
DL. Le rendement théorique de la conversion des photons (particules de lumière) en électricité s’élève à 85 %. La recherche est très active sur ce sujet et c’est une voie de progression formidable pour le terrestre. Enfin, le spatial requiert de plus en plus des cellules très légères pour limiter les coûts du lancement et faciliter leur déploiement. Alors que les panneaux photovoltaïques terrestres pèsent en moyenne 25 kg par m2, nous travaillons à atteindre un poids de 200 g par m2. C’est un changement de paradigme : le photovoltaïque devient ultra léger, performant et pliable. À Terre, cela ouvre le champ des possibles : on imagine par exemple un rideau solaire qui pourrait se déployer sur les façades, les toitures ou en aérien. On pourrait aussi déployer temporairement ces rideaux sur les champs après la récolte pour stocker de l’électricité. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Institut photovoltaïque d’Ile-de-France et le laboratoire de physique des interfaces et couches minces de l’École polytechnique (IP Paris), spécialistes de ces sujets.
LI. Nous sommes aussi à un tournant pour le photovoltaïque spatial, avec un retour de la Terre vers l’espace.
Dans quelle mesure sommes-nous à un tournant pour le photovoltaïque spatial ?
LI. Depuis environ 10 ans, on observe une appétence du spatial pour les technologies terrestres. En cause ? L’essor des constellations de satellites, pour lesquelles le modèle économique du spatial n’est plus compatible. Les exigences sont ici différentes : une capacité de production élevée, un coût plus faible et des performances moindres puisque la redondance est assurée par le nombre important de satellites. Aujourd’hui, le coût des cellules pour le spatial s’élève à environ 300 € par watt, contre 10–20 centimes d’euros pour le terrestre. On peut imaginer qu’un compromis émerge entre la production de masse pour le terrestre et le travail d’orfèvre pour le spatial, même si l’avenir est incertain. L’enjeu est de modifier les cellules terrestres pour qu’elles fonctionnent le plus longtemps possible dans l’espace, tout en modifiant le moins possible les chaines industrielles existantes.
C’est donc la fin des filières photovoltaïques dédiées au spatial ?
LI. Non, l’essor des constellations de satellites ne tuera pas les filières historiques du panneau solaire spatial. Les télécommunications, l’observation et la science continueront à avoir besoin des procédés développés spécifiquement pour le spatial. Les fabricants n’ont jamais enregistré autant de demandes qu’aujourd’hui.