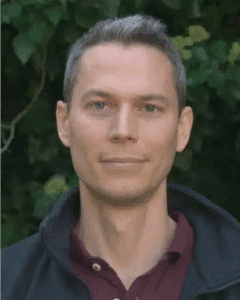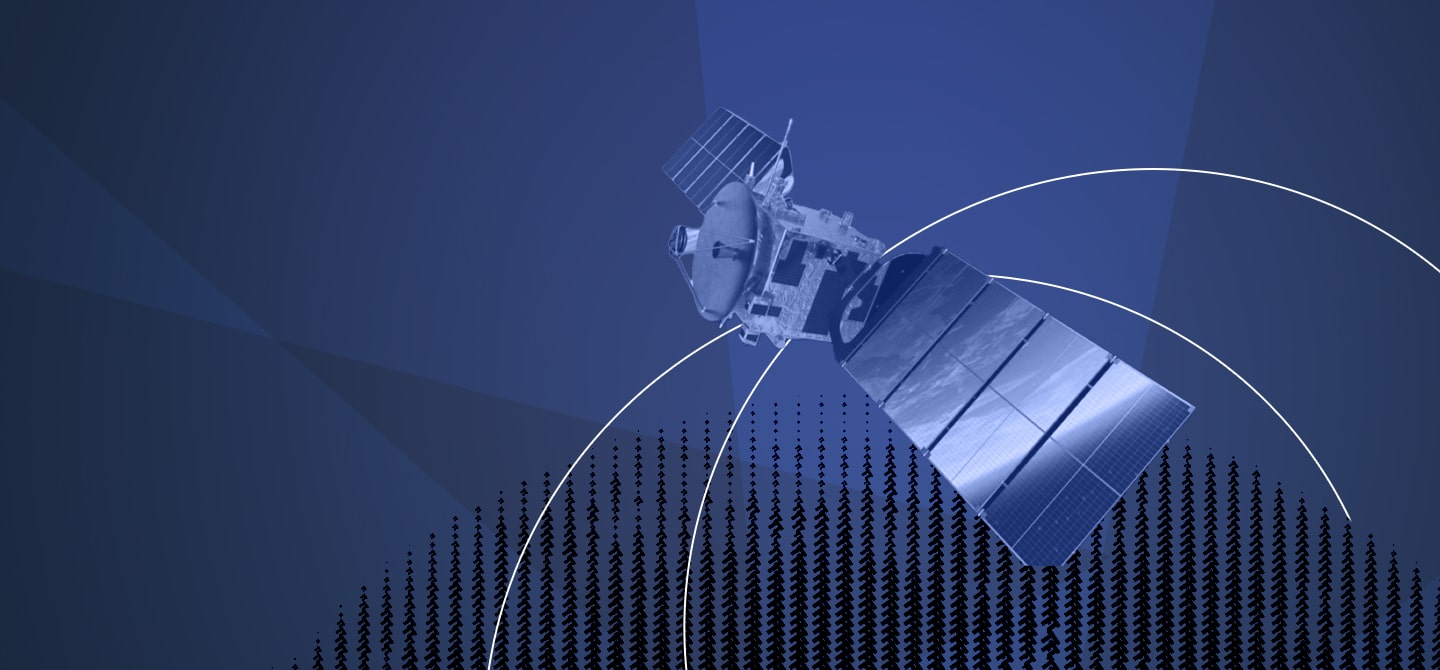La biodiversité derrière les microphones. L’enregistrement des sons d’un environnement permet d’établir des paysages sonores. Ce procédé très utile pour les chercheurs offre la possibilité de connaitre, ainsi que de suivre, la biodiversité mesurable d’un lieu. Cette technique, sollicitée en écologie, est utilisable sur terre comme sous l’eau. Cependant, l’accès à ces données reste difficile, car aucune banque mondiale d’enregistrement n’existe aujourd’hui. Pour faire face à ce constat, Kévin Darras, chargé de recherche à l’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation, et l’environnement) en écologie, apporte une solution en compilant ces paysages sonores dans son projet intitulé « Worldwide Soundscapes ».
Qu’est-ce que le projet « Worldwide Soundscapes », que l’on pourrait traduire par « Les paysages sonores du monde entier » ?
Kevin Darras. À travers le monde, de nombreuses équipes de recherche collectent des enregistrements audios pour étudier la biodiversité. Cette méthode est appelée « suivi acoustique passif ». Or, ces données sont peu partagées entre les communautés scientifiques. Worldwide Soundscapes recense les enregistrements de plus de 12 000 sites – soit environ 5900 To de données – et les met à disposition de tous les scientifiques.
Qu’est-ce que le suivi acoustique passif ?
Le suivi acoustique passif est une méthode très complète qui permet de recenser ou faire du suivi de la biodiversité animale. Concrètement, cela consiste à enregistrer à l’aide d’un microphone et d’un enregistreur des sons de façon passive, à la différence du sonar qui lui émet des sons. Le suivi acoustique passif peut être utilisé pour tous les écosystèmes, qu’ils soient terrestres, aquatiques et même dans le sol. C’est une méthode efficace, précise et vérifiable.
Selon l’espèce et l’environnement, on est capable d’enregistrer des animaux distants de quelques dizaines de mètres, comme un rouge-gorge dans une forêt, voire quelques centaines de mètres ou même quelques kilomètres pour les chants d’orques, par exemple.
Comment arrive-t-on à mesurer la biodiversité uniquement à partir d’enregistrements sonores ?
En premier lieu, l’écoute de l’enregistrement permet de déterminer la présence des différentes espèces animales sonifères (qui émettent des sons). On peut identifier les oiseaux, chauve-souris, mammifères terrestres et marins, insectes, amphibiens, etc. En utilisant des modèles statistiques, il est aussi possible d’estimer le nombre d’individus présents sur un territoire donné. Ces mesures sont à la base d’un nombre important de décisions en matière de gestion des habitats naturels, d’atténuation des effets délétères de l’urbanisation, etc.
Pourquoi avoir travaillé à la création d’une base de données commune internationale ?
J’utilisais le suivi acoustique passif pour réaliser des suivis de biodiversité pour mes recherches relatives à l’agroécologie tropicale. De nombreux collègues qui étudient les milieux marins, d’eau douce ou terrestres utilisent aussi cette méthode, et j’ai réalisé qu’il était utile de faire un état des lieux du suivi acoustique passif à l’échelle mondiale. Une base de données commune permet de connaitre les sites et périodes d’enregistrement, les espèces caractérisées. Cela offre une vision globale des régions déjà instrumentées à la communauté scientifique et aux gestionnaires. L’intérêt ? Il est tout à fait possible de réutiliser un enregistrement pour identifier d’autres espèces ! Cela permet aux scientifiques de repérer les zones jamais instrumentées et celles où des données existent déjà.

Quels sont les premiers résultats issus du projet Worldwide Soundscapes ?
Nous avons caractérisé la densité d’échantillonnage à l’échelle mondiale. Bien sûr, ce n’était pas une surprise, mais nous mettons en évidence qu’il existe bien plus de données dans l’hémisphère Nord que Sud, que les lacunes sont importantes en Asie centrale, et que la densité de la couverture spatiale est plus importante à terre qu’en mer. Nous observons que les données recouvrent la grande majorité des écosystèmes.
Dans une première publication scientifique, nous montrons – à l’aide d’une petite sélection d’enregistrements – que cette base de données permet de répondre à des questions d’ordre écologique sur des échelles très vastes, c’est inédit.
Quelles connaissances ont émergé ?
Pour l’instant, nous n’en sommes qu’au début de l’exploitation des données et nous retrouvons des résultats connus en macro-écologie [N.D.L.R. : l’écologie à large échelle]. Par exemple, on observe que la biodiversité décroit en se rapprochant des pôles. Si cela était déjà connu, cette observation avait nécessité une analyse poussée et des suppositions fortes. Avec la base de données, il est maintenant possible de le faire facilement avec une seule méthode standardisée.
Nous retrouvons également une relation négative entre les bruits naturels animaux et les bruits d’origine humaine. C’est un indicateur de la pression anthropique exercée sur les écosystèmes. En revanche, certains écosystèmes semblent peu affectés par le bruit anthropique : cela montre qu’il existe encore beaucoup de sujets de recherche, mais aussi de possibilités de coexistence entre humains et nature ?
Quelles connaissances scientifiques pensez-vous pouvoir développer à l’avenir avec le projet Worldwide Soundscapes ?
Énormément de questions pourront être adressées. Nous analysons actuellement les sons présents dans la base de données : l’objectif est d’identifier des patrons globaux de biodiversité, ou des liens entre des gradients écologiques et une certaine répartition de la biodiversité.
Grâce à ces nouvelles données, je souhaiterais étudier le lien entre le déclin de la biodiversité et le changement climatique. L’échelle mondiale est très adaptée, car le changement climatique affecte toute la planète. En identifiant les conditions climatiques néfastes à la biodiversité, il serait alors possible de s’y adapter. L’autre question très intéressante est celle de l’effet des activités humaines sur la biodiversité. En identifiant les conditions les moins défavorables à la biodiversité, il pourrait être possible de mieux préserver la biodiversité en mettant en place de nouvelles législations.
Dans quelle mesure la législation pourrait-elle mieux protéger la biodiversité, et quel est le rôle des données scientifiques ?
Légiférer exige des données robustes, et la mise en place d’un observatoire acoustique – un réseau de capteurs – permettrait de répondre à cette exigence. De tels observatoires nationaux existent déjà en Australie, au Canada et dans certains pays d’Amérique du Sud. Cela permettrait par exemple de détecter les premiers signes d’un changement de biodiversité. Imaginons que l’on observe des espèces invasives [N.D.L.R. : l’une des causes de la crise de la biodiversité] au Sud qui commencent à se propager vers le Nord : il serait alors possible d’agir de manière préventive pour les régions encore non atteintes.
Propos recueillis par Anaïs Maréchal
Pour en savoir plus :