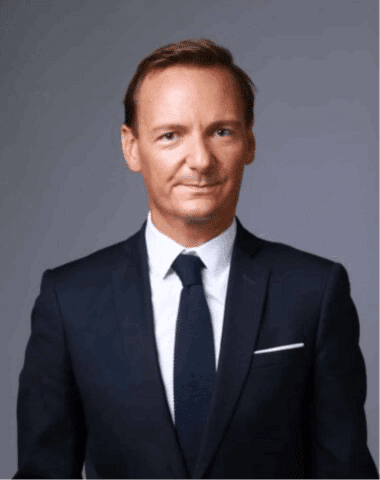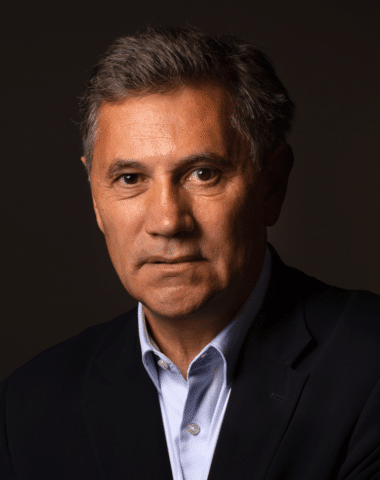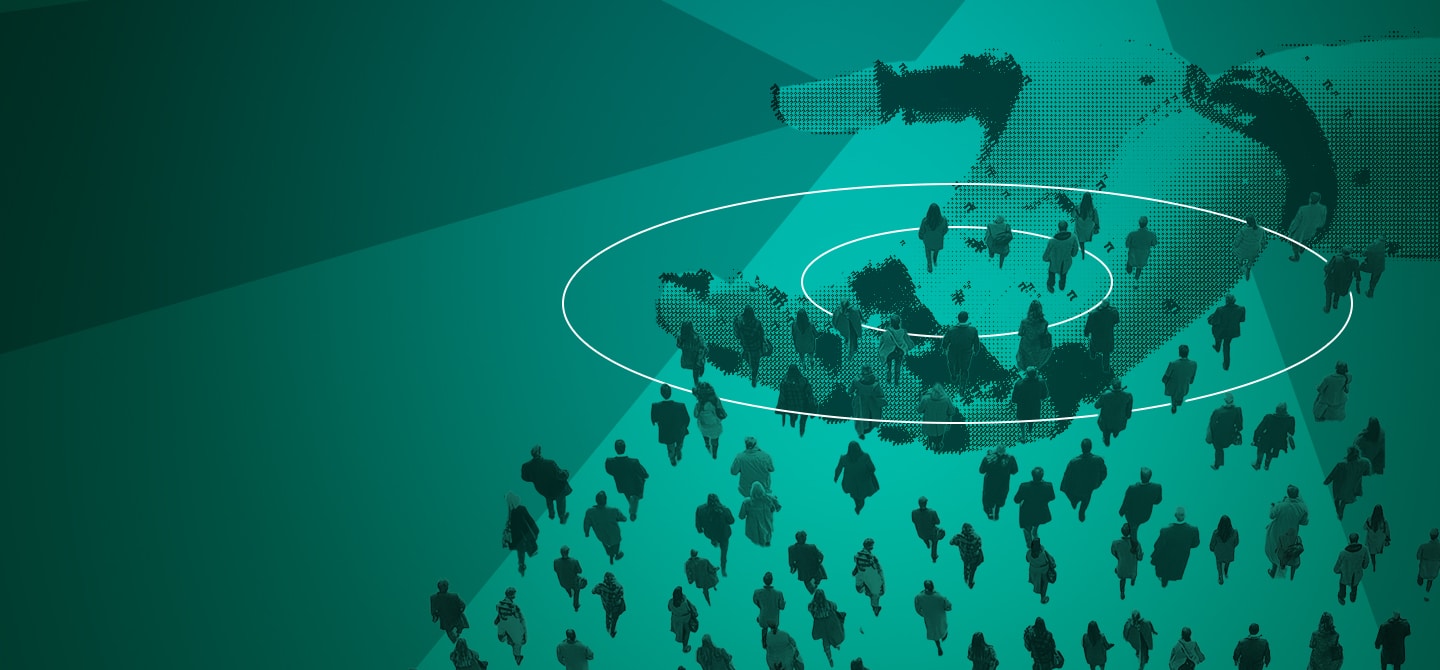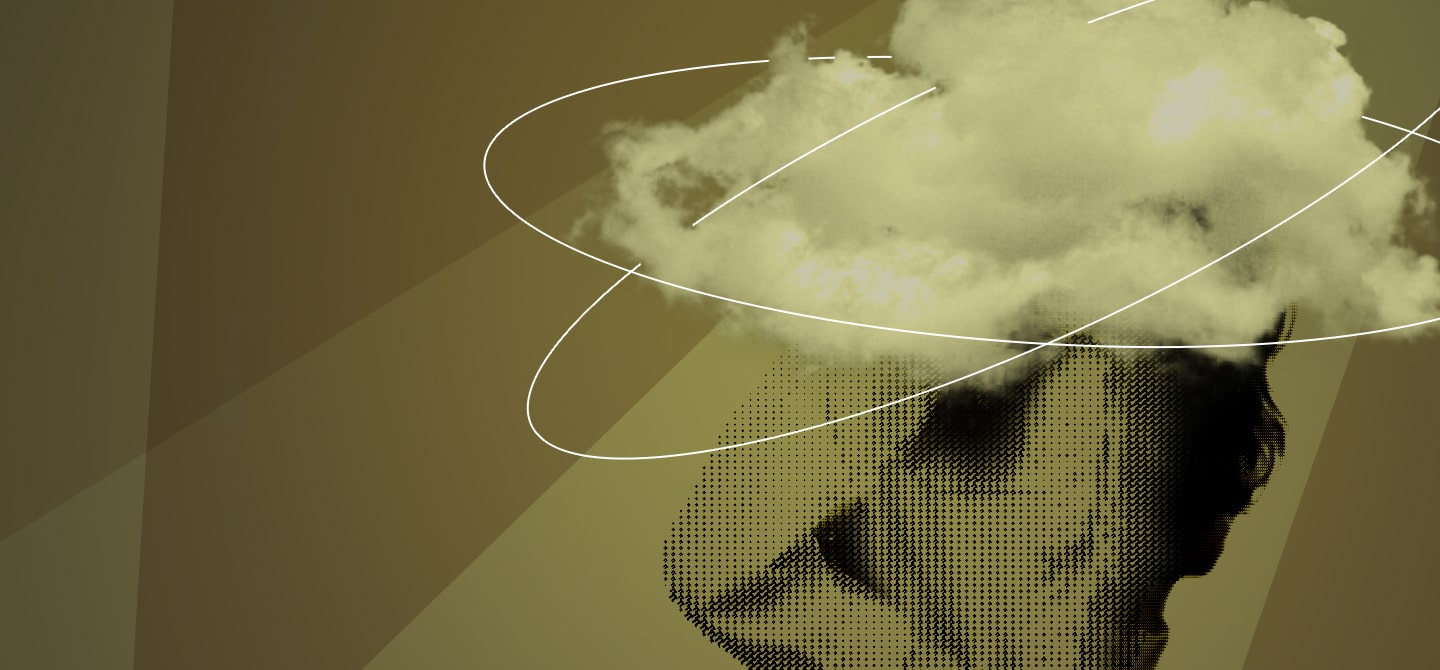France – Singapour : regards croisés sur l’innovation en matière de santé mentale
- La santé mentale est l’une des premières préoccupations à Singapour, où un jeune sur trois serait atteint d’anxiété ou de dépression.
- Pour faire face, le gouvernement singapourien a récemment mis en place des mesures basées sur un modèle de soins échelonnés, le « tiered care model ».
- Parmi les points clés du modèle, on compte ses mesures systémiques ou intersectorielles, ou encore son recours important aux avancées numériques.
- La France partage plusieurs traits communs avec Singapour en matière de santé mentale, qu’il s’agisse des problèmes rencontrés par les citoyens ou de la façon de les traiter.
- Cependant, des différences culturelles persistent entre les deux pays, notamment en ce qui concerne la question du traitement des données personnelles des citoyens.
« Depuis 2012, la santé mentale est l’une des premières préoccupations à Singapour », déclare Serenella Tolomeo à propos du pays d’Asie du Sud-Est, où elle est chercheuse à l’Institute of High Performance Computing. Engagée dans les politiques de santé publique, elle dresse en effet un constat alarmant : « Un jeune sur trois serait atteint d’anxiété ou de dépression à Singapour. » Pour faire face, le gouvernement singapourien a joué un rôle clé dans l’amélioration de la santé mentale des citoyens.
Pour trouver des pistes de réponse à cette épidémie de problèmes psychiques, Serenella Tolomeo a présenté les mesures récentes adoptées par les institutions du pays. En plus des interventions éclairantes de la chercheuse, ce sont aussi Quitterie Marque (directrice générale de Koa Health en Asie), Antoine Tesnière (directeur général de Paris Santé Campus) et Étienne Minvielle (directeur du Centre de recherche en gestion de l’École polytechnique) qui nous invitent à prendre part à une discussion aussi critique qu’instructive sur notre santé mentale.
Le « tiered care model » : une réponse à une santé mentale vacillante
Les difficultés psychologiques éprouvées par les Singapouriens sont imputables à diverses causes. Pour Quitterie Marque, la pression professionnelle et scolaire rencontrée par les habitants du pays et le fort stigma autour des problèmes en santé mentale y contribuent largement. Sans compter la pandémie de COVID-19, qui a encore amplifié la crise : « En 2023, près d’un employé sur deux déclarait être épuisé mentalement ou physiquement à la fin de sa journée de travail, explique la directrice de la société asiatique et singapourienne Koa Health. La pression de la performance scolaire est l’un des revers d’un système éducatif parmi les mieux classés à l’international. Le COVID, quant à lui, a provoqué des restrictions longues et des confinements difficiles.»
En octobre 2023, à la suite des retombées du COVID, le gouvernement singapourien a pris le problème à bras le corps. L’objectif : mettre en place des actions concrètes pour traiter des problèmes comme l’anxiété ou la dépression par le biais de la prévention et du soin. Ces mesures systémiques et intersectorielles, visant à solutionner la crise de santé mentale, sont toujours en cours d’application et d’ajustement dans le pays. Elles sont basées sur la stratégie du « tiered care model », soit une adaptation du stepped care model, un modèle de soins organisé par paliers plus répandu, et notamment utilisé au Canada et en Australie.

Plus précisément, à Singapour, « les personnes sont réparties dans quatre groupes. Pour chaque palier, le gouvernement propose des stratégies différentes », appuie Serenella Tolomeo. Le tiers 1 est consacré aux personnes en bonne santé mentale – les aidant à devenir plus conscientes de leurs états mentaux – et le tiers 4 à celles sous traitement depuis des années, qui requièrent davantage d’assistance.
La méthode repose sur quatre principes clés. Premièrement, elle propose un vaste éventail de choix et s’adapte aux besoins et au degré de détresse du patient. Le deuxième principe clé du modèle vise à toujours prioriser l’intervention la plus légère possible en fonction des besoins de la personne. Troisièmement, la méthode s’adapte à ce que chacun est prêt à faire pour sa santé mentale. Enfin, le dernier point concerne la flexibilité du modèle dans différents contextes, de l’école à l’hôpital, en passant par le travail. « On ne va pas régler ces problèmes en améliorant uniquement le système de soins », ajoute Quitterie Marque.
Quelles actions concrètes pour la santé mentale à Singapour ?
Un autre maître mot du programme est son « pragmatisme ». Il s’appuie sur le numérique et les technologies de pointe dans le but d’atteindre des objectifs précis et concrets en matière de santé mentale d’ici 2030.
Parmi les actions mises en place par le gouvernement, citons les resilience courses, ces cours qui offrent des outils aux élèves – mais aussi aux professeurs – pour mieux gérer l’adversité et identifier des fragilités psychiques. Mentionnons également Mindline.sg, une plateforme numérique anonyme qui propose des outils et des connaissances pour se soigner soi-même, l’accès à des communautés pour être épaulé lors des difficultés rencontrées dans la vie, et de recourir à des professionnels si nécessaire. Terminons ce rapide état des lieux avec la présentation d’un autre programme numérique prometteur, Hopes. Le programme tracke le sommeil et les activités physiques des individus par l’intermédiaire d’une montre intelligente, puis stocke les données recueillies dans le cloud. Cela permet de les transmettre à des équipes de R&D ou à des cliniques afin de fournir un meilleur suivi des patients, mais aussi des populations à haut risque.
Plus encore que les actions concrètes, la perception des problèmes psychiques se transforme à Singapour. En ce sens, Quitterie Marque a mis en lumière trois lignes directrices à suivre pour améliorer la manière dont les problèmes de santé mentale sont traités dans le pays. Parmi elles, le rééquilibre des ressources allouées à la prévention de la maladie mentale par rapport à celles allouées aux soins cliniques. Le deuxième axe concerne l’intégration des problèmes de santé psychique au sein du système de santé traditionnel, pour ne plus les traiter comme des problèmes « à part ». Enfin, dernier point crucial, tirer parti des opportunités massives qu’offre le numérique pour prévenir et soigner les fragilités psychologiques.
Comparaison avec le cas français
Cette discussion internationale cherchait avant tout à « construire des ponts entre Singapour et la France », selon les mots de Serenella Tolomeo. L’enjeu : apprendre mutuellement de la situation d’un autre pays pour accroître l’efficacité des actions menées en matière de santé mentale. Les deux pays, séparés par treize heures de vol et des politiques et cultures qui diffèrent sur de nombreux points, peuvent-ils s’inspirer l’un de l’autre ?
Pour Antoine Tesnière, les situations en France et à Singapour partagent certains traits communs, ce qui est déjà un point de départ. En effet, le bien-être psychologique des Français traverse lui aussi une crise considérable. En France, une personne sur quatre sera confrontée à des problèmes de santé mentale dans sa vie, et environ 13 millions de personnes souffrent de troubles anxio-dépressifs ou de pathologies psychotiques. Autre point commun : en France aussi, le COVID-19 n’a fait qu’aggraver la situation. « On estime que les troubles anxio-dépressifs ont doublé entre la période du COVID et aujourd’hui. Ils concernaient environ 10 % de la population à l’époque, et ont grimpé à quasiment 19 % aujourd’hui », ajoute le directeur du Campus.
En France, environ 13 millions de personnes souffrent de troubles anxio-dépressifs ou de pathologies psychotiques.
Face à cette épidémie de problèmes psychiques, la façon dont la France tente de pallier ces problèmes se rapproche de celle mise en place par Singapour en ce qui concerne la prise en compte de l’importance de la prévention : « Si l’on sort du champ de la santé mentale, 80 % de dépenses de notre système de santé sont des dépenses en soins, et de 2 à 3 % des dépenses en prévention. Pourtant, un euro investi en prévention pourrait globalement rapporter jusqu’à 14 euros, selon des chiffres d’études mises en place à l’échelle européenne », explique Antoine Tesnière.
La stratégie française passe d’ailleurs aussi par l’investissement dans des outils numériques à la pointe, permettant de détecter des troubles, de les diagnostiquer, de les suivre et de les traiter. Pour mettre en place davantage de mesures afin de résoudre ces problèmes, « des stratégies basées sur les données, et les algorithmes – entre téléconsultations, télésurveillance, thérapies digitales, outils conversationnels – constituent des axes de recherche pertinents », complète le directeur de Paris Santé Campus.
Cependant, un fossé culturel persiste entre les deux approches de gestion des problèmes de santé mentale. Antoine Tesnière pointe à ce titre la différence de traitement des données personnelles des citoyens en France et à Singapour. Si l’utilisation de ces données pourrait apporter des bénéfices individuels et sociaux, la question de la « confiance » dans leur gestion se pose : « En Europe, pendant le Covid, la question de la sensibilité des données est plus importante que dans d’autres pays, notamment dans ceux d’Asie du Sud-Est, où le débat n’a pas été aussi complexe. » Quitterie Marque précise qu’à Singapour, le problème n’est pas tant celui du contrôle des personnes, que le fait que l’approche générale du pays anticipe, planifie et mette en place des mesures de mitigations : « Il existe un équivalent du RGPD à Singapour. Mindline.sg laisse par exemple une grande place à l’anonymat, ce qui limite parfois la possibilité d’analyser des données. » Enfin, Serenella Tolomeo souligne qu’il s’agit de maintenir une ligne éthique dans la gestion des datas, tout en actant le besoin d’une approche collaborative pour solutionner la crise.