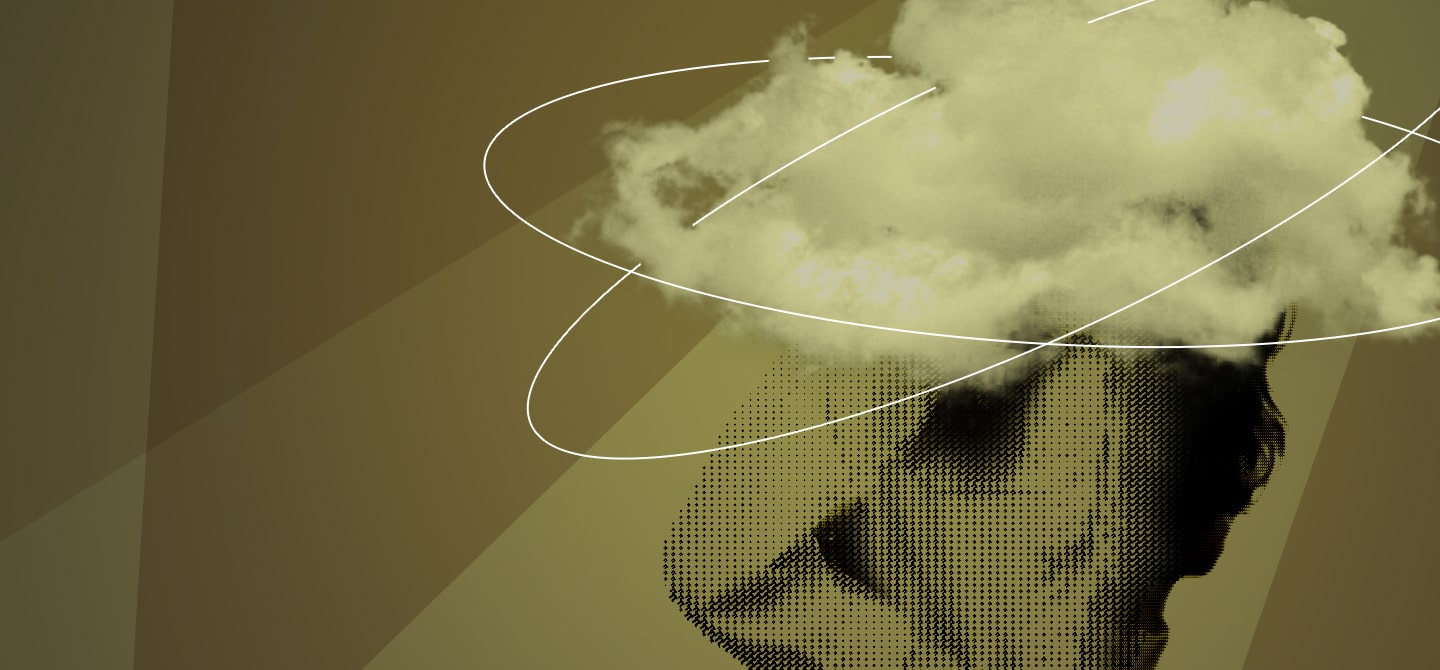Vers une psychiatrie augmentée par le numérique
- 95 % des praticiens gèrent déjà les dossiers de leurs patients à l’aide d’outils numériques, notamment pour surveiller les interactions entre les différents médicaments prescrits.
- Il est important d’adapter des méthodes médicales viables aux outils numériques, en se demandant, par exemple, si le suivi des patients en ligne est aussi efficace qu’en présentiel.
- Le numérique n’a pas vocation à remplacer les médecins, mais à offrir aux patients un suivi complémentaire, entre autres pour évaluer l’efficacité des traitements prescrits.
- 9 % des étudiants questionnés préfèrent être traités à l’aide d’une solution numérique plutôt que par une personne réelle, c’est pourquoi il s’agit prouver l’efficacité des méthodes numériques pour convaincre de leur fiabilité.
Le numérique transforme déjà le monde de la santé, en ouvrant des perspectives inédites. De la personnalisation des soins à la désaturation des hôpitaux, ses promesses émerveillent. Mais pour que cette révolution tienne ses promesses, les professionnels de santé doivent non seulement adopter ces outils, mais aussi repenser leur usage. C’est précisément cette réflexion qu’a initié le laboratoire i3-CRG, dirigé par Étienne Minvielle, à l’École polytechnique (IP Paris), à travers son cycle de séminaires sur l’intégration du numérique dans la santé. L’un des sujets les plus attendus ? La santé mentale, un domaine où les avancées technologiques pourraient réellement changer la donne. À ce titre, les professeurs Pierre-Alexis Geoffroy et Jean-Baptiste Masson reviennent sur la séance du séminaire consacrée à la psychiatrie, à laquelle participaient également Guillaume Couillard, directeur général du GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences et Raphaël Gaillard, professeur de psychiatrie à l’Université Paris-Cité.
« Étant donné les contraintes économiques qui pèsent sur le système, il est impossible de s’imaginer que tout le monde ira à l’hôpital dans le futur, explique le professeur Pierre-Alexis Geoffroy, psychiatre au GHU Paris. Une personne me disait que son fils avait développé des troubles du sommeil assez tôt, et qu’elle avait essayé de le faire suivre par un pédopsychiatre, en vain. Pour qu’au final, six ans après, une schizophrénie soit diagnostiquée chez ce dernier. Seulement, la pédopsychiatrie ne pourra jamais recevoir tous les enfants ayant des troubles de sommeil ou des troubles anxieux. Et donc, ces solutions numériques, qui sont par ailleurs moins chères, seront là pour s’adapter au niveau d’intensité de soin à mettre en place, mais aussi au niveau de l’intervention que nous pourrons proposer. »
Adapter, pas transposer
« Nous parlons du numérique en santé comme si cela relevait de la science-fiction, admet Pierre-Alexis Geoffroy. Alors que pour dire vrai, le numérique est déjà là, et nous l’utilisons tous au quotidien. » Aujourd’hui, 95 % des praticiens remplissent les dossiers de leurs patients à l’aide d’outils numériques. « Quand nous faisons des prescriptions, par exemple, l’IA nous aiguille dès à présent sur les possibles interactions médicamenteuses, ajoute le professeur. Le tout, en fonction de la littérature scientifique qui s’actualise en temps réel. » L’intérêt n’est donc pas tant de faire un état des lieux des outils déjà présents et utilisés dans le monde de la psychiatrie. Il est plutôt de se projeter dans les évolutions possibles que ce monde subira avec les avancées technologiques qui pourraient s’y produire.
« Globalement, et pendant longtemps, nous essayions de transposer dans le numérique différentes échelles et évaluations que nous utilisions dans la vie réelle. Mais cela ne marchait pas, car s’adapter aux nouveaux outils du numérique nous demande de tout repenser », précise le psychiatre. L’exemple des applications de santé existantes en témoigne. Bien que moins nombreuses que les applications de bien-être, seulement 15 % d’entre elles suivent une approche scientifique — c’est-à-dire, basée sur une étude avec preuve d’efficacité. « Quand nous étudions ce type de solutions, nous réalisons aussi qu’il y a un problème d’observance [N.D.L.R. : le suivi par le patient des prescriptions émises], poursuit-il. Seules 30 % des personnes parviennent jusqu’au bout des programmes. La question se pose donc : comment bien développer ce type de solutions ? »

« En santé mentale, nous avons la chance d’avoir des modèles très robustes, relève Pierre-Alexis Geoffroy. Pour développer, en addictologie par exemple, ce type de solution, il faut adapter au numérique des modèles avec une approche scientifique connue. » Ainsi, une application pour inciter l’arrêt d’une addiction, comme le tabac, doit se développer sur un modèle existant, comme celui de préparation au changement de Prochaska et Di Clemente.
« Si ma solution suit la logique du “one size fits all” [N.D.L.R. : approche uniforme où un même protocole est appliqué à tous les patients, sans tenir compte de leur spécificités individuelles], nous établirons une balance du pour et du contre de ce que l’arrêt du tabac apportera au patient. Seulement, si le patient est déjà dans une phase de rechute, cela ne lui parlera pas. Il aura besoin de propositions bien plus concrètes. Le modèle de Prochaska et Di Clemente est donc important pour déterminer dans quelle phase le patient est, et donc de quel type de suivi il aura besoin. S’il est au stade de contemplation, il lui faut des entretiens motivationnels pour essayer de préciser avec lui ce qu’il veut et ce qu’il est prêt à faire. S’il est déjà dans un stade d’action, il faudra organiser le sevrage avec lui. Et pour un stade de rechute, l’interroger sur ce qu’il a déjà fait, pour déterminer ce qui a bien ou mal fonctionné. Ce qui est primordial pour avoir l’engagement du patient sur la solution et d’éviter, qu’au bout de 5 minutes, il arrête tout, car l’application ne répond pas à ses besoins. »
Un soutien pour le praticien
Selon le professeur, l’intérêt premier du numérique se trouve dans un service additionnel à la pratique du médecin. Proposer un suivi plus assidu du patient ne veut pas dire le rendre autonome dans sa démarche, ni même lui demander une implication trop importante dans ce suivi. « Il y a un peu moins de 10 ans, l’étude Monarca I1 avait eu une idée intéressante. Pour autant, aujourd’hui, cette solution nous paraît déjà “has been”, argumente-t-il. L’idée consistait à autosurveiller les patients ayant un trouble bipolaire, afin de prédire leurs moments de rechutes. Pour cela, les 61 patients devaient noter leurs symptômes sur des échelles de dépression. » Les auteurs de cette étude ont montré que plus le patient était dans un état dépressif, moins il interagissait avec l’équipe médicale. Et, au contraire, plus il était dans un état maniaque, plus le nombre et la durée des appels étaient importants.
« Les résultats étaient suffisamment parlants pour que la classification de l’état du patient puisse se faire facilement, confirme Pierre-Alexis Geoffroy. Ce qui pousse à la conclusion des auteurs que les applications smartphone étaient valides pour le suivi en temps réel du patient. » Seulement, une deuxième étude a suivi celle-ci, avec des conclusions bien moins avantageuses. « Dans cette étude, les auteurs décident de garder tous les patients, même ceux ayant arrêté la solution proposée, précise le professeur. Résultat, il n’y a pas d’effet significatif de l’autosurveillance, et même, les auteurs observent que le fait de noter tous les jours ses symptômes dépressifs aggrave l’état mental du patient. »
« Ce type de suivi n’a ainsi pas pour vocation de remplacer le médecin, mais plutôt d’offrir un service additionnel qu’il pourra prescrire. » C’est donc un nouvel outil à disposition du médecin pour assurer l’efficacité de son traitement. Car, outre la possibilité de télésurveillance du patient, le numérique offre aussi des solutions thérapeutiques. « Je prends souvent l’exemple de la thérapie à l’aide de la réalité virtuelle augmentée. Je suis psychothérapeute et j’ai un patient ayant une phobie des cafards. Je peux travailler avec lui sur l’exposition aux insectes, en projetant, autour de sa main, des insectes à l’aide de la réalité virtuelle. »
Vers une preuve d’efficacité
« L’adhésion à ce type d’outil est un enjeu majeur. En demandant à des étudiants s’ils préféreraient être traités via une solution numérique ou par une personne réelle, seulement 9 % d’entre eux choisissent le numérique, constate Pierre-Alexis Geoffroy. Il faudra donc appuyer sur l’efficacité de ces méthodes avec des preuves pour débloquer ces verrous. Le numérique n’est aujourd’hui pas encore présent dans ma pratique, car des solutions numériques permettant d’apporter des données sur le patient en temps réel ne sont pas encore disponibles. Je rêve, un jour, dans ma pratique de psychiatre, en plus de ma pratique traditionnelle, d’avoir des arguments numériques m’aidant à la prise de décision. Je pense donc que l’adhésion sera de facto plus grande lorsque de telles solutions, prouvées comme efficaces, seront disponibles. »
Le numérique n’a pas pour vocation de remplacer le médecin, mais il peut devenir un allié précieux de notre pratique
Le professeur Jean-Baptiste Masson, chercheur à l’Institut Pasteur, questionne les méthodologies à l’œuvre pour juger de l’efficacité du numérique dans les contextes médicaux. « À un moment, si nous voulons prouver que quelque chose est efficace, il faudra faire des tests statistiques, appuie le chercheur. Il faudra donc comparer un groupe à un autre, alors que l’esprit humain, lui, n’est tout de même pas facilement catégorisable. » Il est vrai que le numérique donne une quantité énorme de données, et agrandit le groupe témoin. En psychiatrie, plus le groupe est grand, plus il sera hétérogène. Des sous-groupes se formeront et les comparaisons deviendront moins solides. « Ainsi, une difficulté se trouvera dans la transposition de résultats convaincants sur un échantillon faible de personnes à un échantillon plus grand pour lesquels les résultats seront moins fiables, ajoute-t-il. Une limite qui se retrouve également dans la quantité de paramètres possibles à mesurer grâce au numérique : plus il y a de paramètres et de données étudiés, plus il y a de chances de corrélations, dues à l’aléatoire, sans pour autant qu’elles soient significatives. » Ces limites méthodologiques freinent encore la validation et l’adoption de ces solutions numériques par les praticiens.
Le mariage entre le numérique et la santé mentale ouvre donc des perspectives fascinantes. Mais pour que ces solutions gagnent la confiance des praticiens et des patients, elles doivent être accompagnées de preuves solides de leur efficacité. Ce qui n’est pas facile à réaliser. Comme le résume le professeur Geoffroy, « le numérique n’a pas pour vocation de remplacer le médecin, mais il peut devenir un allié précieux de notre pratique ». Avec une recherche clinique rigoureuse et une adoption progressive, le numérique pourrait bien redéfinir l’approche des soins en psychiatrie, en rendant les traitements plus accessibles, personnalisés et efficaces. Cependant, il faudra faire sauter les derniers verrous qui entravent le bon développement de ces solutions.