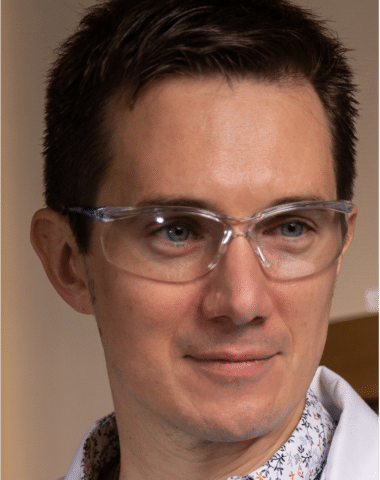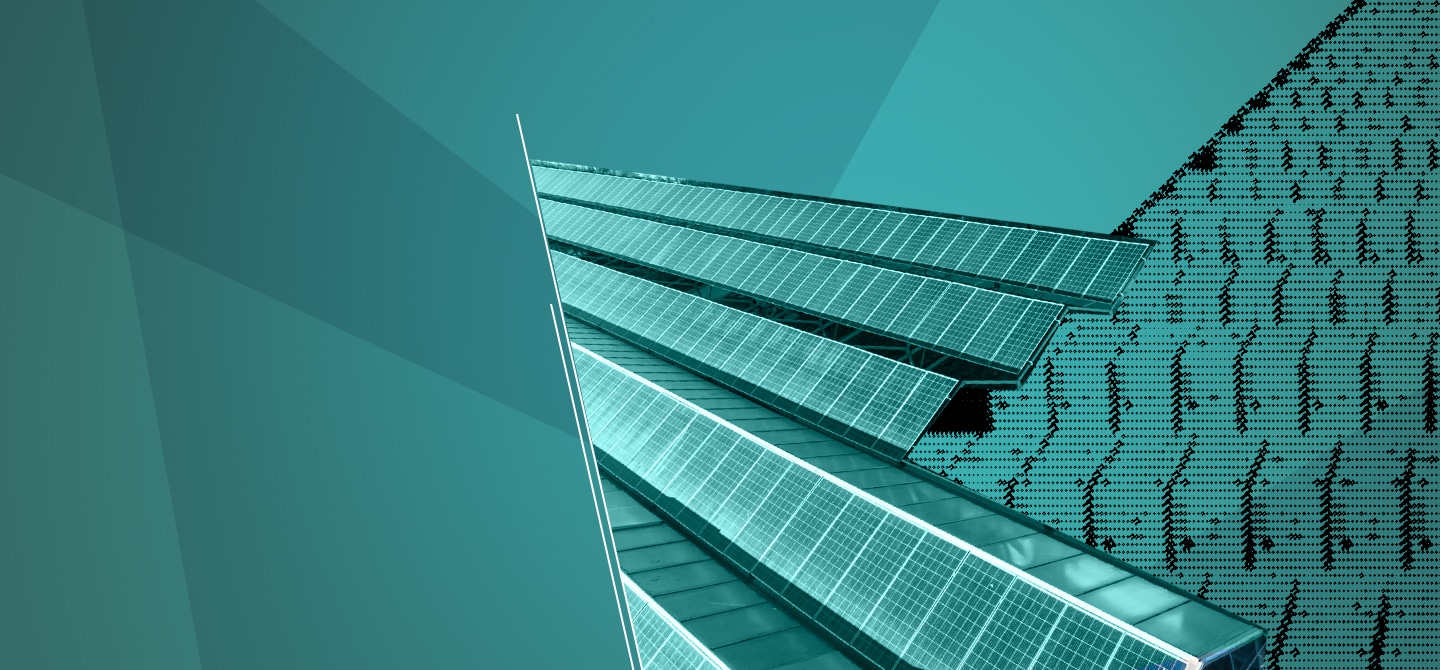Quand l’impression 3D s’invite sur les champs de bataille
- La fabrication additive est une technique qui repose sur un logiciel de création et une imprimante 3D.
- Ce procédé, utile dans les industries ou même sur le front, est utilisé par l’ensemble des armées (navales, terrestres, aériennes).
- Dans l’armée, la fabrication additive est utilisée pour deux usages principaux : la fabrication des pièces et la réparation.
- Des pièces en polymère sont fabriquées pour des réparations, et la fabrication additive métallique pourrait même être utilisée à l’avenir.
- Parmi les enjeux actuels de la recherche : le développement de matériaux parfaitement adaptés à la tâche, ou d’alliages permettant de réparer de nombreux types de pièces.
À la suite de la guerre en Ukraine, la Direction générale de l’Armement annonçait la création d’un groupe de travail dédié à la « fabrication additive », comme le révélait la presse. La fabrication additive est une technique de fabrication qui repose sur un logiciel de création et une imprimante 3D. Que ce soit dans les industries ou sur le front, le procédé séduit la défense.
Comment la défense utilise-t-elle la fabrication additive ?
Éric Charkaluk. Ce procédé est utilisé par l’ensemble des armées (navales, terrestres, aériennes). La fabrication additive a émergé dans le domaine de la défense depuis une quinzaine d’années, initialement de manière exploratoire. Aujourd’hui, elle est prioritaire pour l’Agence de l’innovation de défense, et la plupart des groupes industriels l’utilisent pour la fabrication de pièces pour les engins terrestres, des éléments de moteurs d’avion ou encore de missiles. Beaucoup de pays européens sont concernés, tout comme les États-Unis.
Deux usages principaux sont concernés : la fabrication de pièces ou la réparation. La fabrication additive est utilisée depuis les lignes de production industrielles jusqu’au front. Dans les zones de conflit, elle peut être très utile pour réparer rapidement sur le champ de bataille ou réaliser la maintenance dans les bases arrière.
Concrètement, comment répare-t-on une pièce sur le champ de bataille ?
Fabien Szmytka. Il existe plusieurs procédés et matériaux dans la fabrication additive, ce qui offre une large gamme d’usages et de possibilités. Mais en pratique, de nombreuses réparations sont effectuées avec des imprimantes 3D du marché telles que celles que nous connaissons tous ! De nombreuses pièces en polymère sont fabriquées ainsi. Il suffit de disposer d’un endroit où poser la machine et d’une source électrique. La matière première – de la résine liquide ou du fil – est assez facile à déplacer.
La fabrication additive métallique pourrait également être utilisée, le procédé se rapproche alors de la soudure. Un premier démonstrateur au sein d’un conteneur a été testé par l’Agence européenne de défense. Mais ce procédé n’est pas encore suffisamment fiable dans sa version mobile et n’est pour le moment pas utilisé sur les champs de bataille.
Quels sont les avantages de la fabrication additive ?
FS. Pour la réparation sur le front, la fabrication additive permet de déposer de la matière sur des zones endommagées ou des pièces existantes, ce qui est parfois impossible avec d’autres procédés ou alors avec des variations assez fortes dans la finition.
À cela s’ajoute la relative simplicité du procédé. Prenons l’exemple d’un engin terrestre, un cas d’usage récurrent est l’endommagement d’éléments fonctionnels comme les poignées de portes, qui sont notamment sensibles aux impacts. Or il n’est pas possible d’embarquer un nombre infini de pièces de rechange sur le champ de bataille. L’impression 3D permet de réimprimer en quelques heures la poignée ou n’importe quel élément en embarquant uniquement de la matière et une machine. Il est même possible d’adapter la géométrie de la pièce de rechange pour la rendre plus résistante dans le cadre d’opérations en cours ou pour la fonctionnaliser. Le gain de temps et de logistique est très important.
EC. Les engins militaires évoluent parfois dans des environnements extrêmes : chaleur, sable, humidité, etc. Les pièces de moteur par exemple s’usent très vite, et améliorer la maintenance est un véritable enjeu sur les théâtres d’opérations.
Au-delà de la réparation, la fabrication additive sur le front offre-t-elle de nouveaux moyens à la défense ?
EC. Oui, cela permet également de fonctionnaliser les équipements, un usage très employé par les forces spéciales. Face à des conditions spécifiques sur un théâtre d’opération, des développements très rapides peuvent être réalisés : par exemple, des pièces sont imprimées pour permettre de fixer de nouveaux systèmes d’arme, d’observation ou de mesure sur un engin terrestre.
La fabrication additive ne présente-t-elle pas un risque pour les soldats ?
EC. Les pièces imprimées peuvent avoir des propriétés un peu différentes de celles des pièces initiales, mais ce n’est pas forcément un problème, en particulier dans deux situations : celle de pièces faiblement sollicitées, et celle qui permet un maintien en condition opérationnelle jusqu’à une prochaine opération de maintenance. Même si le cahier des charges initial n’est pas forcément respecté, cela ne fait courir aucun risque aux utilisateurs. Il faut noter par ailleurs que grâce aux programmes de recherche menés depuis des années dans les laboratoires, les pièces imprimées ont désormais des propriétés très proches des pièces fabriquées par des procédés plus classiques. Ainsi, la réparation est encore un domaine de recherche actif.
Utiliser la fabrication additive sur un champ de bataille représente-t-il un défi ?
EC. Il y a un vrai enjeu de formation du personnel. Actuellement, de nombreuses actions sont engagées par les armées pour former le personnel des services de maintenance à l’usage de ces machines. La fabrication additive repose sur une logique différente de conception des pièces, à laquelle les nouvelles générations d’ingénieur(e)s sont formées.
FS. L’autre défi est celui de l’accessibilité et la géométrie de la pièce, mais c’est un problème qui concerne de nombreux exploitants comme EDF, SNCF, etc. Les plans des composants ne sont généralement pas partagés en raison de la propriété industrielle. Sans connaissance de la géométrie de la pièce, il faut la scanner pour la reconstituer, cela alourdit le procédé. Prendre en compte la réparabilité dès la conception des pièces et composants permettrait de dépasser cette problématique.
Il existe différents procédés et matériaux de fabrication additive, quels sont ceux utilisés par la défense ?
EC. Les polymères reposent sur des procédés matures, et sont les seuls largement utilisés aujourd’hui par la défense. Les procédés utilisant des alliages métalliques inspirés du soudage sont à l’étude en raison de leur potentiel de réparation, et des démonstrateurs sont développés. Enfin, de nouveaux procédés émergent, comme la fabrication additive par friction-malaxage pour des alliages plus légers (aluminium par exemple).
Les procédés à base de céramique ne trouvent pas d’application en réparation aujourd’hui. Ce matériau est par exemple utilisé dans les gilets pare-balles. Mais cette application exigerait d’importantes études en amont pour pouvoir garantir un niveau de risque nul en cas de réparation par fabrication additive.
Quels sont les enjeux de recherche aujourd’hui ?
EC. La composition chimique des matériaux d’apport fait l’objet de nombreux travaux, car les matériaux utilisés dans les procédés classiques ne sont pas toujours les plus adaptés à la fabrication additive. Des équipes travaillent également à mettre au point des alliages qui permettrait de réparer un grand nombre de pièces réalisées dans des matériaux différents, ce qui permettrait de diminuer le nombre de poudres ou de fils à emporter sur le front.
FS. Il y a un réel enjeu autour de la disponibilité des matériaux. Beaucoup de matériaux nobles ne sont pas faciles à récupérer dans un contexte militaire. Des recherches sont donc menées pour utiliser des matériaux faciles d’accès et présentant de bonnes propriétés. Mais cela pose la question de la durabilité et de la résistance mécanique. En réparant une pièce avec un matériau différent, on peut avoir des problèmes d’adhérence et on crée des hétérogénéités qui peuvent être sources d’endommagement.