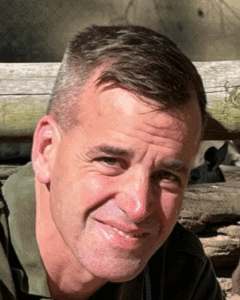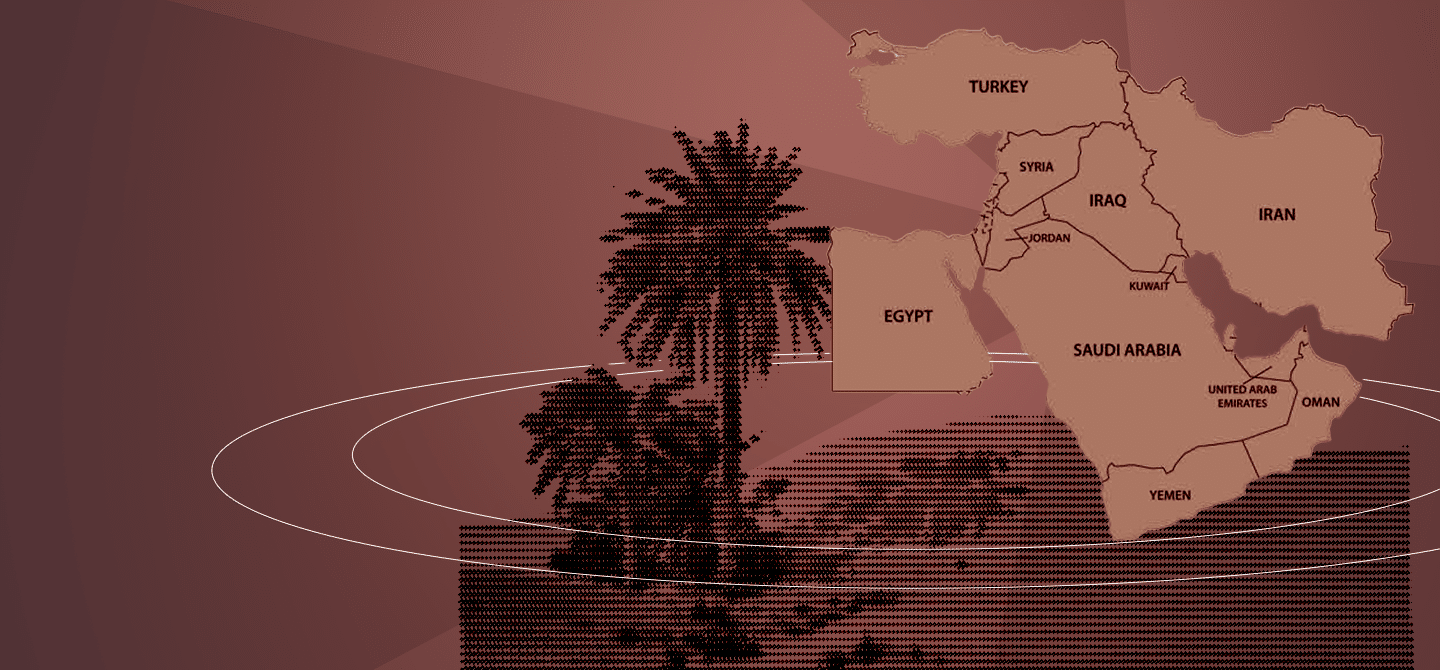Lutter contre la pensée de l’adversaire n’a rien d’un concept très original : les pratiques développées par les maîtres de la désinformation soviétique en constituent des illustrations très concrètes et relativement bien documentées. Cependant, par la complexité des opérations montées et les ressources nécessaires, elles relèvent davantage de l’artisanat que de l’industrie de masse et restent comprises comme une forme annexe de désinformation. Néanmoins, au début du XXIᵉ siècle, les progrès des neurosciences et d’une forme de compréhension du fonctionnement du cerveau amènent à penser qu’on peut désormais cibler de manière plus scientifique les processus cognitifs.
La naissance d’un concept
En 2017, le terme de « guerre cognitive » est employé pour la première fois par Vincent Stewart, directeur de la Defense Intelligence Agency (DIA) américaine. Cependant, il relève davantage du « buzz word » que du concept scientifiquement défini. Quelque temps après, fin 2018, la « guerre cognitive » n’était toujours qu’une formule commode pour désigner l’ensemble des manipulations informationnelles et psychologiques. Ce terme circulait d’ailleurs dans les colloques et était souvent entouré de références de science-fiction ou de cybernétique. Les premières tentatives de vulgarisation mêlaient prospectives imaginaires, jeux de guerre et communication stratégique. Ces démarches ont eu leur intérêt puisqu’elles ont sensibilisé les institutions, stimulé l’imagination stratégique et permis d’explorer les possibles. Mais elles appartenaient à un autre registre : celui de la projection, et non de la mesure.
À partir de 2022, un autre travail s’engage dans les grands lieux de la doctrine militaire française. Les armées cessent de traiter la guerre cognitive comme un thème de prospective pour l’aborder plutôt comme un système observable. Le Centre de doctrine et d’enseignement du commandement (CDEC) mène alors une série d’analyses approfondies sur la période 2022–2023. En 2023, le Centre d’enseignement militaire supérieur-Terre (CEMST) reprend le flambeau en y intégrant la modélisation et les outils issus des sciences de la décision.

En résulte le concept de Net Assessment Cognitif (NAC) – inspiré des travaux d’Andrew Marshall – par les rapports du coordinateur Langlois-Berthelot (2023–2024). Ces résultats marquent la jonction décisive entre ces travaux institutionnels et la recherche scientifique. Là où les « wargames » explorent des scénarios futurs, le NAC cherche à construire une méthode rigoureuse. Plutôt que d’imaginer l’avenir, il cherche à comprendre les mécanismes de stabilité et de déséquilibre des environnements cognitifs contemporains.
Des mécanismes qui sont davantage sollicités dès l’année 2022, car durant celle-ci les intelligence artificielle (IA) génératives sont devenues accessibles au grand public. Ces modèles d’IA changent radicalement la donne, puisqu’ils permettent à la guerre cognitive de sortir du concept artisanal et d’entrer dans l’ère de la « production de masse », et donc, de la menace existentielle.
Pourquoi le « Net Assessment » cognitif ?
Le Net Assessment classique, né au Pentagone dans les années 1970, comparait les dynamiques plutôt que les moyens statiques. Il évaluait les asymétries réelles, les vitesses d’adaptation, les ruptures lentes. Le NAC applique la même logique à la sphère de la perception et de la décision collective. Il ne cherche pas à cartographier des récits ou des « influences » diffuses, mais à comprendre comment un collectif maintien ou perd sa cohérence interprétative face aux flux informationnels.
Trois notions structurent cette approche : (1) La superposition décisionnelle : moment où plusieurs représentations contradictoires du réel coexistent sans qu’aucune ne s’impose ; (2) L’effondrement cognitif : bascule soudaine vers un récit unique, souvent sous l’effet d’un choc émotionnel ou informationnel ; (3) L’entropie cognitive : mesure du désordre mental et informationnel au sein d’un système social. Ces notions traduisent la conviction qu’il faut traiter la guerre cognitive comme une question de dynamique plutôt que de discours. Le NAC en fait un domaine d’ingénierie dont l’objectif est de comprendre la fragilité d’un système cognitif pour pouvoir le protéger et le renforcer.
Tel que Langlois-Berthelot l’a démontré, le NAC repose sur deux indicateurs complémentaires : un indice d’entropie cognitive, qui mesure la dispersion et la redondance des récits circulants, et un indice de tension de superposition, qui estime la proximité d’un seuil d’effondrement. Ensemble, ils permettent d’identifier les zones d’instabilité cognitive et d’agir avant que la rupture ne survienne. Ce qui distingue fondamentalement cette approche des expérimentations prospectives des années 2020, c’est cet équilibre subtil entre opérationnalité et scientificité. Les résultats peuvent être reproduits, comparés, discutés dans un cadre méthodologique partagé. La discipline quitte définitivement la narration pour rejoindre la mesure et l’expérimentation contrôlée.
Le rôle de l’intelligence artificielle
L’IA occupe une place centrale dans cette architecture conceptuelle. Elle accélère les cycles attentionnels, favorise le micro-ciblage et l’isolement cognitif, mais elle offre aussi les moyens techniques de les modéliser : détection de flux artificiels, simulation de propagation informationnelle, apprentissage automatique des signaux faibles. L’IA devient un double miroir : facteur d’instabilité d’une part, instrument d’observation d’autre part. Dans le NAC, elle permet de construire des représentations dynamiques des environnements mentaux — non pour prédire mécaniquement les comportements individuels, mais pour mesurer la charge cognitive collective et la résilience d’un système social face aux perturbations informationnelles.

Cette approche n’est pas née d’une école unique, mais d’un besoin de convergence interdisciplinaire. Les chercheurs en cognition, les ingénieurs de données et les officiers de doctrine y trouvent un terrain commun. Cette hybridation féconde a permis de produire un langage stable — attracteurs, entropie, collapse — et d’établir des passerelles durables entre cultures militaire et scientifique. Les rapports de 2023–2024 ont posé les fondations de cette grammaire commune. Ils ont permis à la France d’aligner ses travaux sur les standards internationaux émergents, tout en affirmant une voie propre : une science de la résilience cognitive ancrée dans la mesure, pas dans la spéculation.
Diagnostiquer les vulnérabilités cognitives
Cette dynamique scientifique s’est prolongée en 2024 avec un nouveau jalon : le diagnostic systémique des vulnérabilités cognitives, coordonné par Langlois-Berthelot en association avec Christophe Gaie (Services du Premier Ministre). Là où le Net Assessment cherchait à caractériser la stabilité globale d’un environnement, ce dispositif vise à comprendre le moment précis où un système social perd la capacité de s’autoréguler. S’inspirant des travaux de Bateson, Morin et Friston, cette approche considère la cohésion sociale comme une propriété émergente d’un système d’informations saturé. Les crises ne résultent pas uniquement d’attaques extérieures, mais de l’amplification interne de boucles de rétroaction non régulées.
La société y est représentée comme un réseau d’interactions multi-échelles entre individus, institutions et symboles. Les vulnérabilités cognitives apparaissent alors comme des effets de structure observables dans le temps : une surcharge informationnelle engendre une polarisation émotionnelle, qui fragilise les médiations et accélère la désynchronisation entre groupes sociaux. Le modèle de Langlois-Berthelot et Gaie articule trois dimensions — récits collectifs, médiations institutionnelles, régulations politiques — et évalue non ce que pensent les acteurs, mais la vitesse à laquelle leurs représentations se reconfigurent. La stabilité cognitive devient alors la capacité à maintenir plusieurs interprétations du réel sans effondrement narratif.
Sept champs cognitifs servent de résonateurs de cohésion : appartenance nationale, écologie morale, normes sociales, mémoire historique, légitimité institutionnelle, autonomie stratégique et cohésion interethnique. L’analyse de leurs interactions permet de dresser une cartographie d’entropie cognitive, comparable à une carte énergétique du corps social. L’IA y joue un rôle d’observation, les graphes sémantiques détectent les densifications narratives, identifient les corrélations entre champs et mesurent les transitions cognitives – elle ne conclut pas : elle instrumente la lecture sans la substituer à l’interprétation humaine.
Cas réels en cours
Une première expérimentation interne, conduite dans un cadre limité et non public, a permis de tester cette architecture méthodologique. Sans détailler les modalités, cette mise en œuvre a confirmé la possibilité d’un suivi dynamique de la cohésion cognitive et d’une détection précoce des zones de tension symbolique. Ces résultats partiels, obtenus sur un périmètre restreint, orientent désormais les travaux vers l’intégration de ces mesures dans les dispositifs d’observation stratégique. La force du dispositif réside dans la convergence entre cultures militaire et civile. L’une apporte la gestion du temps long et la formalisation des seuils critiques ; l’autre, la compréhension fine des dynamiques symboliques. Ensemble, elles posent les bases d’une science appliquée de la stabilité cognitive, capable de mesurer la cohésion sociale avec rigueur méthodologique.
Aujourd’hui, la guerre cognitive est devenue un champ d’ingénierie à part entière. Le NAC en constitue l’architecture centrale : un outil de veille et de simulation qui remplace les narrations d’alerte par des indicateurs objectivables. Les priorités pour 2025–2028 sont claires : consolider les métriques, intégrer la simulation dans la planification opérationnelle et enseigner la gestion temporelle de la décision. Après six années de maturation progressive, la guerre cognitive entre dans une phase d’équilibre : la méthode se stabilise, les outils se précisent et l’approche gagne en cohérence sans perdre en prudence conceptuelle.
Ainsi, le travail mené par Langlois-Berthelot et Gaie prolonge le mouvement amorcé par le NAC : il fait passer la guerre cognitive du champ de la spéculation à celui de l’ingénierie systémique, où la cohésion devient une variable mesurable — et désormais expérimentée — de la résilience nationale.