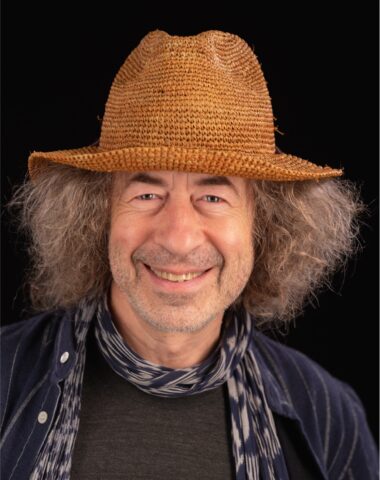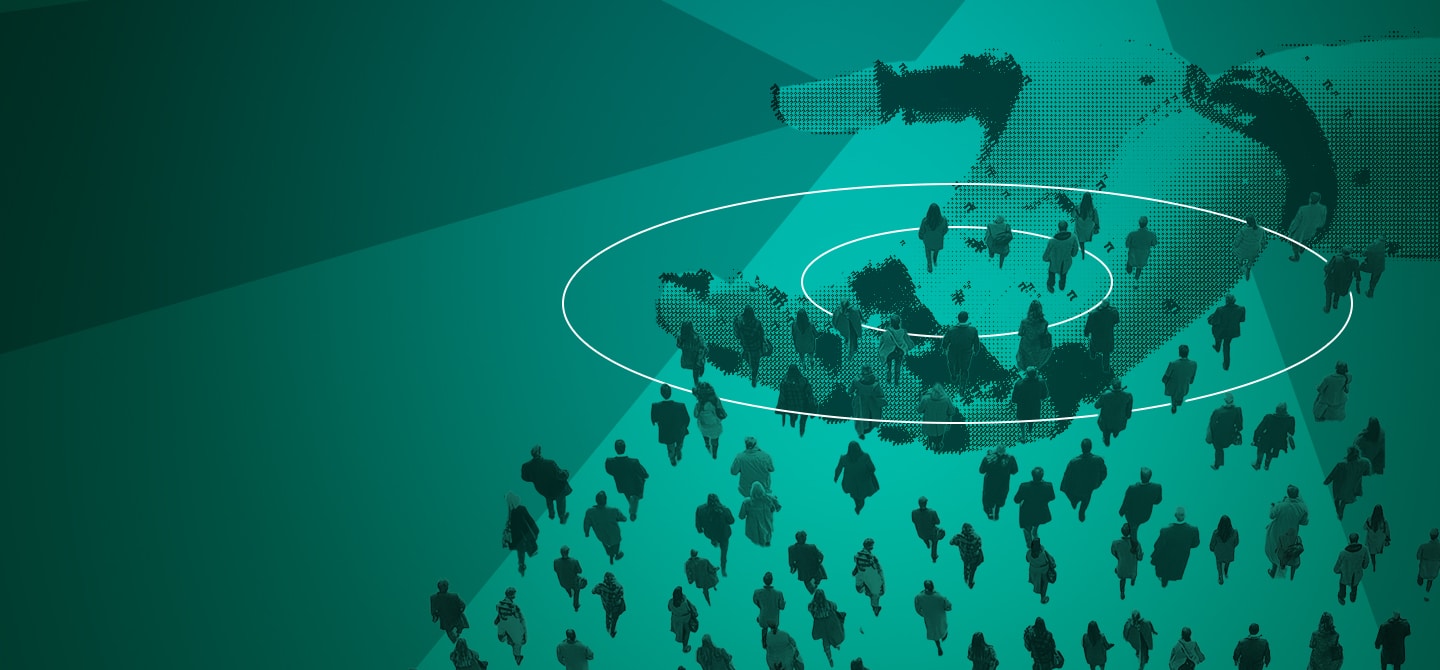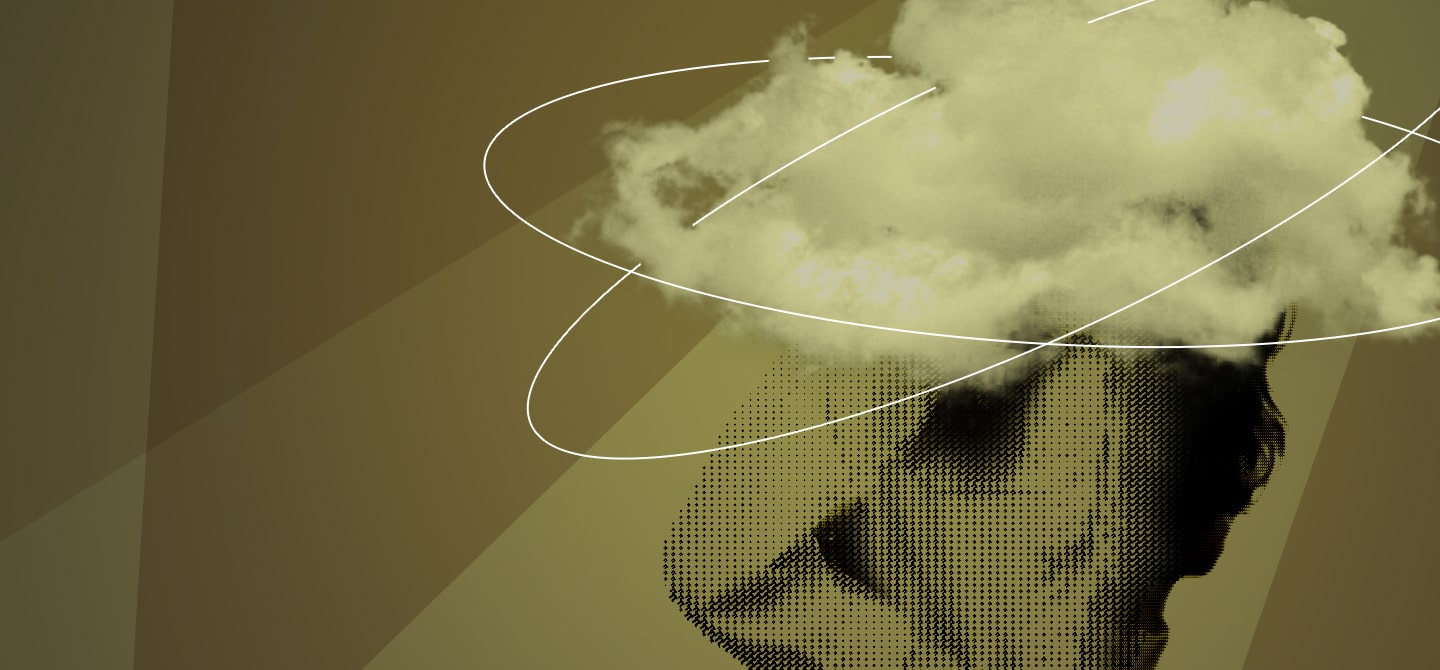La co-création au théâtre : un antidote à la controverse dans la démocratie ?
- Confrontés à la polarisation croissante de la société, des chercheurs étudient comment la création collective d’une pièce de théâtre peut contribuer à renouer le dialogue.
- Le projet prend la forme de productions artistiques menées en 2018 par des groupes de professionnels aux intérêts opposés, et impliqués dans une controverse.
- L’objectif pour eux est de créer ensemble une pièce de théâtre d’environ 20 min, centrée sur des sujets clivants (usage des pesticides en agriculture, impact des technologies sur le réchauffement climatique).
- Une seconde enquête a permis d’observer qu’après le processus de création collective, les participants avaient notamment une bien meilleure compréhension du contexte et des logiques des positions des autres.
- Parmi les limites de cette approche, on note le caractère éphémère du théâtre, et le fait que cette discipline exige des moyens importants pour pouvoir être rejouée.
Usages et mésusages des pesticides en agriculture, rôle de la technologie dans la lutte contre le réchauffement climatique… Lors d’une discussion sur l’écologie, la politique ou diverses questions de société, n’avez-vous jamais eu l’impression de prendre part à un dialogue de sourds ? Dans une société polarisée, le débat avec des gens qui ne partagent pas nos valeurs devient parfois impossible. Une tendance amplifiée par la prolifération de « chambres d’écho1 », ces espaces relationnels où l’on n’interagit plus qu’avec des personnes partageant nos convictions. À ce titre, une discipline est née : la sociologie des controverses, qui étudie les différents points de vue et les contextes dans lesquels ils sont émis. Alors comment renouer le dialogue ?
Cette question est centrale dans les études menées par Sylvie Bouchet – docteure en psychologie, chargée d’enseignement à l’université Paris Dauphine – et Olivier Fournout – maître de conférences en sciences de la communication au sein de l’Institut Interdisciplinaire de l’Innovation/CNRS et Télécom Paris/Institut Polytechnique de Paris. Dans Le Champ des possibles2, ils étudient comment la création collective d’une pièce de théâtre peut contribuer à renouer le dialogue au sein de populations fragmentées par de vifs conflits. Le projet prend la forme de productions artistiques menées en 2018 par des groupes de professionnels – agriculteurs, militants écologistes, entrepreneurs, experts, administratifs du secteur public ou privé, responsables d’associations – impliqués dans une controverse. L’objectif : créer ensemble des pièces de théâtre de 25 minutes centrées sur des sujets clivants, comme les pesticides dans l’agriculture ou l’impact des technologies dans le réchauffement climatique. Les personnes impliquées ont le champ libre pour mettre en scène leur propre pièce, qu’ils écrivent et interprètent eux-mêmes.
Deux ans après la création, la moitié des participants considèrent que quelque chose a changé dans leur façon de se situer dans la controverse.
L’ouvrage s’enrichit des résultats d’une enquête menée auprès des participants, visant à évaluer comment le travail créatif commun a pu « modifier leur perception du débat, des autres protagonistes, des données du problème3 ». En outre, en juillet 2020, une seconde enquête4 a été menée auprès d’eux afin de décrire les effets de l’expérience sur le long terme. Parmi les constats dressés : deux ans après la création, « la moitié des participants (56 %) considèrent que quelque chose a changé dans leur façon de se situer dans la controverse5 », et les multiples niveaux de changements sont spécifiés.
Pour parler de la création de lien dans une société où les interactions sont très vite incendiaires, c’est donc à un dialogue avec Olivier Fournout que nous vous convions, qui nous apparaît ici réparateur.
Quel a été le point de départ de vos travaux, visant à faire dialoguer par la voie de la mise en scène théâtrale des citoyens aux positions parfois contraires, et que l’on jugerait presque irréconciliables de prime abord ?
Olivier Fournout. Le point de départ est le constat que dans nos sociétés, les divisions et les controverses sont attisées en permanence dans la chambre d’écho médiatique et sur les réseaux sociaux. Il y a du clivage, de l’irréconciliable. Face à toute réalité – même scientifique et reconnue – l’on est entraînés politiquement et éthiquement dans des spirales de violence. Les différentes populations en affrontement ne se parlent plus, ou ne parlent qu’à des semblables et ignorent ce qu’il se passe à côté. Ces sociétés de division sont étudiées par la sociologie des controverses.
Fort de ce constat, ma perspective a été d’aider les citoyens et les élèves à se saisir de controverses pour, à la fois, en comprendre les ressorts et tenter de les surmonter. Après les avoir étudiées et parfois vécues directement, les personnes impliquées s’inscrivent dans la construction d’une création théâtrale collective traitant de la controverse. Cette démarche a été accompagnée d’une question de recherche centrale : qu’est-ce que le processus de création artistique collective change au vécu des personnes en controverse ? Qu’est-ce que la production théâtrale peut apporter de spécifique en termes de représentation de la controverse, et comment celle-ci est rendue sensible pour le public ? Grâce aux moyens d’un contrat ANR6, nous avons pu mettre en place un processus d’étude empirique de ces effets, permettant d’en faire un objet de recherche.
Quelle a été la méthodologie à l’œuvre pour aider les gens à se parler, même s’ils se sont construits autour d’idées opposées ?
Cette méthodologie de mise en théâtre, je l’ai effectuée plus de 150 fois : avec des élèves et des citoyens, mais aussi, plusieurs fois, avec des comédiennes professionnelles sur le sujet du transhumanisme7. Le processus de création collective est stabilisé. Un documentaire de cinquante minutes, tourné en 2018, rend compte de ce processus8. À chaque fois, on part d’un phénomène sociétal étudié et/ou vécu. Le temps de création est court. Les participants créent en deux jours une pièce de 20–25 minutes et la jouent devant un public. Il y a beaucoup d’improvisation, y compris dans la représentation finale. Les personnes qui, la plupart du temps, n’ont jamais fait de théâtre, peuvent se retrouver à l’aise dans l’improvisation et jouer très juste, très vivant, très naturel, alors que ce serait moins le cas si elles récitaient un texte appris par cœur. Les choix de mise en scène, le jeu et le texte sont entièrement assumés par les groupes de création. Les accompagnateurs du processus font des feedbacks, mais le groupe et sa dimension collective décident toujours à la fin. Les règles du jeu sont partagées avec le groupe en amont, et la créativité naît dans ce cadre. J’ai testé ce format de création collective pour la première fois en 2009, dans un cours très innovant pour le Corps des Mines, mêlant géologie sur le terrain, théâtre et observation des dynamiques de groupes. Ce cours, qui existe toujours, a donné lieu à une communication en sciences de l’éducation en 20119.
Vous partez de controverses variées : des pesticides, aux rapports entre technologie et réchauffement climatique, en passant par la question du mariage pour tous… Comment ces personnes vivent-elles la controverse en temps réel ?
Pour revenir sur la controverse du mariage pour tous, nous avons sorti une publication de recherche en 2017 avec Valérie Beaudouin sur cette création théâtrale mise en place en 201310. Ce qui était très fort avec le groupe d’étudiants qui y a participé, c’est que les personnes qui s’étaient inscrites volontairement à cette mise en théâtre pour mettre en scène la controverse étaient pour la plupart très concernées par le sujet. Des étudiants étaient venus s’inscrire en disant qu’ils n’arrivaient plus à en discuter entre eux et qu’ils souhaitaient ouvrir le dialogue. C’est pour cela qu’ils se sont inscrits, et une étudiante a notamment confié à cette occasion être très concernée par le sujet. Cela a conféré au travail de ce groupe d’étudiants une tonalité particulière, parce qu’il ne s’agissait pas juste d’étudier la controverse. Quelque chose de vivement vécu passait par la création.

Pour les questions des pesticides et pour savoir si la technique aide ou non à lutter contre le changement climatique, nous avons eu des moyens pour faire une enquête et objectiver les effets provoqués chez les participants de la création collective. Dans la pièce sur les pesticides, jouaient un agriculteur bio, un autre qui traite ses plus de cent hectares au glyphosate, un conseiller technique pour les grandes exploitations, un militant écologiste, la responsable d’une association, un médecin agréé d’une mutuelle de santé agricole et lui-même viticulteur. Avec ce panel, on atteint le degré maximal de représentativité de la controverse. Cela est éprouvant, sans concession, car il y a vraiment, au départ, une rupture, une peur des participants à l’idée de se faire attaquer. Par exemple, l’agriculteur qui nappait ses terrains de glyphosate pensait qu’il allait « se faire lyncher ». D’une certaine façon, on a un terreau empirique où l’on part de très loin dans la division et le risque de blessures.
Pour la pièce sur le mariage pour tous, nous n’avions pas pu procéder à l’époque à une enquête auprès des étudiants sur le processus de création collective, mais le contenu même de la pièce de théâtre porte la trace de résultats très positifs. Alors qu’ils n’étaient pas du tout d’accord entre eux, les élèves avaient réussi à dessiner une frise avec six représentations de couples différents, projetées au cours de la pièce, qu’avec Valérie Beaudouin nous avons reproduites dans notre article. D’une certaine façon, la pièce de théâtre a donc accouché d’un modèle de diversité, alors même que les étudiants s’opposaient à propos de ces représentations dans l’espace public. Un autre acquis est le nom que s’est donnée la troupe de théâtre, appelée « théâtre pour tous », qui résume assez bien la force de réunion du théâtre – comme, par exemple, une pièce de Shakespeare va réunir Falstaff et le futur Henry V dans une taverne. En résumé, les étudiants ont réussi à trouver du commun via le théâtre, là où le sujet divisait, ce qui est à la fois touchant et efficace.
Finalement, est-ce que dans le cas de vos études sur les pièces montées sur la question des pesticides et des technologies dans leur rapport à l’écologie, les citoyens ont « changé d’avis » ?
Changer d’avis n’est pas quelque chose que l’on peut placer comme un objectif imposé. Ce que nous avons pu observer avec notre seconde enquête conduite en 2020, c’est qu’il y avait, après le processus de création collective, une bien meilleure compréhension du contexte et de la logique des positions des autres, une sensibilité à l’égard des histoires personnelles et une ouverture au dialogue, mis en acte avec les personnes avec lesquelles, jusqu’ici, on n’arrivait pas à discuter. De la fréquentation des positions adverses, perçues d’abord comme les pires ennemies dans la controverse, finissent par naître l’empathie et l’émotion, ce qui est un résultat fantastique. Fantastique, car ce premier résultat ouvre la voie à des avancées sur le plan cognitif : deux ans après l’expérience, 70 % des participants déclarent avoir appris des choses de l’ordre de la « réflexion » et des « pensées ».
Le point clé est sans doute ici le processus de création théâtrale, qui fait se rejoindre des personnes qui ne se parlent plus dans la vie, et qui crée un objet commun autour duquel se noue le dialogue. En effet, les éléments de controverse de la pièce, comme le thème des pesticides, sont pris dans l’obligation d’arriver à faire ensemble une pièce de théâtre. Cette obligation, plus forte que les sujets de discorde, permet de retisser les liens, ou bâtir ce que j’appelle dans le livre une « écologie relationnelle », devenant la condition de possibilité de tout progrès sur le fond. En résumé, il y a d’abord à travailler l’écologie des relations humaines pour parvenir ensuite à des résultats en écologie de la nature, qui demande la contribution de toutes et tous dans la recherche des solutions. Le processus théâtral permet de restaurer une forme d’alliance pour déjà réussir à co-créer la pièce de théâtre – pièce de théâtre qui elle-même est un dialogue qui travaille le fond du problème.
Avez-vous cependant rencontré des limites dans votre approche ? Dans votre enquête de 2020, les participants vous disent qu’ils auraient aimé être accompagnés sur le temps long, après les deux créations théâtrales collectives réalisées en 2018… Comment analysez-vous cette limite de vos travaux ?
Parmi les limites de l’approche, le théâtre est une discipline très éphémère qui demande beaucoup de moyens pour être rejouée. Par exemple, nous avons monté deux pièces de théâtre dans les Deux-Sèvres, en partenariat avec une « Zone Atelier » du CNRS en agroécologie (Centre d’Étude Biologique de la Forêt de Chizé) et la société WISION, spécialisée en médiation sur les territoires. Le sujet était les relations entre agriculteurs et habitants. Les pièces ont été créées et jouées par des agriculteurs et des habitants du secteur, rejoints par quelques étudiants. Les deux pièces de théâtre que nous avons filmées11 se sont très bien passées, et nous nous sommes quittés en nous disant qu’il faudrait les rejouer. Mais les volontés et les ressources ne sont pas forcément présentes pour le faire, et trouver des lieux de diffusion est difficile. C’est un processus très fort sur le plan existentiel, émotionnel et affectif, impliquant les corps, mais qui ne se reproduit pas facilement.
Il faut des dispositifs qui travaillent la relation pour travailler ensuite les changements de pratiques et de valeurs.
En 2020, en plein confinement COVID, nous avons monté avec Cyrille Bombard, qui exerce le métier de médiateur sociétal, un dispositif de dialogue nommé ZigZagZoom12. Nous faisons se rencontrer trois personnes en faveur d’une position et trois personnes en défaveur de celle-ci, avec un public participatif de dix à quinze personnes. Nous arrivons au même constat : les changements de comportements et d’attitudes ne peuvent venir que si l’on travaille d’abord le terreau relationnel. Ce résultat est probablement généralisable. Ce ne sont pas les discours d’experts, aussi nombreux et compétents soient-ils, qui provoquent le changement, et si cela fonctionnait, bien des problèmes seraient déjà résolus. Ce qui le permet en revanche, c’est d’abord de tisser des liens autour des perceptions des uns et des autres. Il faut des dispositifs qui travaillent la relation pour travailler ensuite les changements de pratiques et de valeurs.
Les participants de notre enquête de 2020 ont eu une attente déçue par rapport au cadre de l’expérimentation, dont ils attendaient qu’il les accompagne après l’expérience théâtrale collective. Effectivement, il s’agit d’une limite que je n’ai pas réussi à traiter, car la recherche est très dépendante de financements limités dans le temps et par projet. Lorsque le financement s’arrête, il n’y a plus de suivi car les moyens chutent d’un coup. Je ne peux plus travailler, par exemple, avec mon collègue médiateur sociétal, qui aurait la volonté de poursuivre l’effort pour ancrer les changements amorcés et faire vivre le dispositif sur la durée.
Pensez-vous, plus largement, que la fiction puisse apporter quelque chose à nos sociétés ? On a souvent l’idée que la fiction invente, et donc divise…
Dans notre pièce de théâtre sur les pesticides en 2018, un nouveau personnage mythologique est apparu : « le petit champ malade ». Ce personnage est une innovation de la troupe. Il n’est cité dans aucune des encyclopédies de l’imaginaire que j’ai consultées. C’est une invention de la pièce qui, peut-être, un jour, changera le monde. Mettre au centre de l’Histoire une invention fictionnelle comme « un petit champ malade », c’est déjà s’entraîner à le soigner. Voir, c’est déjà faire, comme tendent à le monter les travaux sur les neurones miroirs13. Ainsi, les actions fictionnelles sur une scène de théâtre, surtout quand elles ont été créées par les personnes mêmes qui sont impliquées dans les problèmes de nos sociétés, ouvrent au dépassement des divisions. Elles inspirent nos manières de construire ensemble un futur commun. Condition sans doute nécessaire et primordiale à la résolution des problèmes.