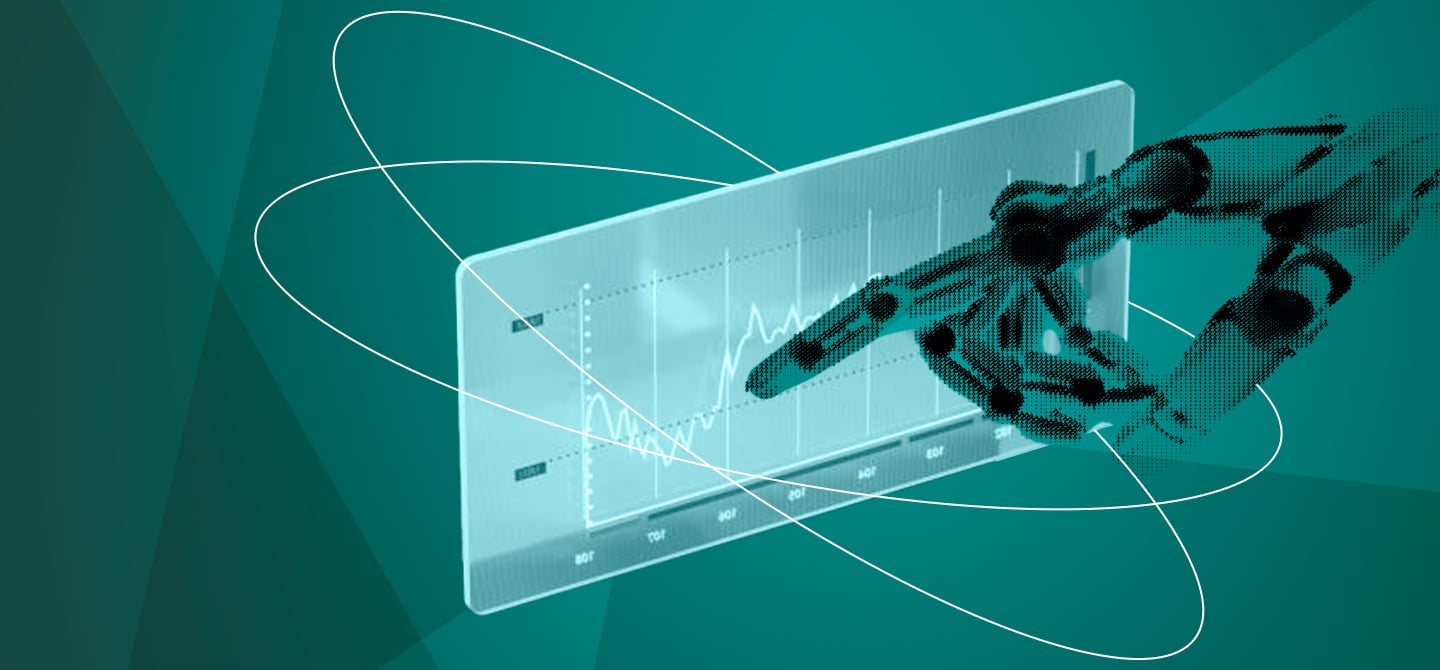La croissance verte est, d’un point de vue sémantique, un concept tout aussi trompeur que la décroissance. Alors que le terme décroissance agit comme un repoussoir, activant des imaginaires de privations et de dépression, la croissance verte s’apparente à une pensée magique, qui donne l’illusion de pouvoir continuer à produire et consommer plus grâce au progrès technique. Sauf qu’il n’y a absolument aucune raison d’espérer que la finance ou le marché, dont le seul objectif est la recherche maximisée des profits, sauvent la planète.
Les économistes d’inspirations néolibérales qui travaillent sur les liens entre croissance, nature, et environnement, affirment qu’en monétisant les externalités négatives, et en augmentant le prix du carbone, on va résoudre le problème du réchauffement climatique, et plus globalement l’ensemble des dommages environnementaux causés par les activités humaines. Mais là encore, c’est une chimère, car le prix est incapable de révéler la profondeur de champ des questions environnementales, et notamment la préservation de la biodiversité.
Les mirages du découplage
Pour asseoir leur thèse, les partisans de la croissance verte partent du principe qu’il sera possible de découpler la hausse du PIB des dommages sur l’environnement, grâce notamment au progrès technique. Nous en sommes loin. Il est vrai que dans certaines régions du monde, et à certaines périodes données, on a pu assister à un découplage PIB-émissions de GES (gaz à effets de serre). Entre 2010 et 2016, le PIB européen a par exemple augmenté, alors que les émissions de GES baissaient. Mais au niveau mondial, nous n’en sommes pas là : sur la période 1980–2018, on estime que le PIB a cru de 198 % (base 100 en 1980), pendant que les émissions GES augmentaient de 65 % (en équivalent CO2).
Or selon le programme des Nations Unies pour l’environnement, si nous voulons limiter le réchauffement à 1,5 °C, nous avons besoin de baisser nos émissions de l’ordre de 7 à 8 % par an, et ce dès aujourd’hui. C’est pourquoi dans une récente étude, Carbone 4 affirme que pour que le découplage fonctionne, il faudrait qu’il soit absolu (les émissions de GES doivent baisser), mondial (toutes les zones du monde doivent être concernées), pérenne (il doit se maintenir dans le temps), rapide, et total (le PIB doit être décorrélé de toutes les pressions sur l’environnement, et pas seulement des gaz à effet de serre). Concrètement, cela signifie que le découplage n’est que partiel si la baisse de la consommation des énergies fossiles se traduit par d’autres pressions environnementales, comme la déforestation par exemple, ou s’il se limite à une baisse de l’intensité carbone du PIB.
Les énergies bas carbone ne sont pas illimitées
Dans ce cadre, on peut comprendre que certains observateurs s’inquiètent de voir la transition énergétique brandie comme la solution technique infaillible capable de nous mener « sans douleur » vers ce scénario idéal. Car contrairement à ce qu’on projette parfois, les énergies bas carbone ne sont ni gratuites, ni illimitées, ni faciles à déployer. De fait, il n’existe aucune production d’énergie qui soit rigoureusement neutre sur le plan des émissions de GES. Par ailleurs, les solutions techniques qu’implique la transition, comme l’efficacité énergétique ou la captation de CO2, ne sont pas toujours abouties ou déployables à grande échelle. Enfin, qu’il s’agisse du solaire, de l’éolien, du nucléaire ou de la biomasse, ces énergies se heurtent à de nombreuses limitations techniques, financières, et même parfois démocratiques, que l’on ne peut plus ignorer : le nucléaire est une énergie du temps long, coûteuse, industriellement et démocratiquement compliquée à mettre en œuvre, le solaire et l’éolien ont des empreintes foncières importantes, en plus de poser de plus en plus de problèmes d’acceptation sociale. Quant à la biomasse, elle pose des problèmes de limitation et de gestion de la ressource.
Face à cela, on peut regretter la manière dont les institutions, notamment européennes, élaborent leurs scénarios prospectifs : partant du principe que la transition énergétique est techniquement faisable, elles n’insistent pas assez sur les conditions pour y parvenir. En la matière, la question est moins de savoir si les technologies existent que de savoir à quelle vitesse on va pouvoir les généraliser, et qui va payer. Quels que soient les scénarios retenus, nous devons nous préparer à ce que la transition ait un coût très élevé pour la collectivité. La Cour des Comptes européenne estimait récemment qu’elle coûterait 11.200 milliards de dollars entre 2021 et 2030. Il y aura des gagnants et des perdants, et il appartiendra aux pouvoirs publics de répondre aux inégalités qui en découleront.
Sortir de l’obsession du PIB
Alors, pour réduire nos pressions sur notre écosystème, faudra-t-il, comme l’assurent les décroissants, réduire notre train de vie, et abandonner toute perspective de croissance de nos économies ? Sur le papier, cette façon de poser le problème peut sembler convaincante : le système de nos économies linéaires — consistant à extraire, fabriquer, consommer, jeter — a conduit à la situation que l’on connaît, et nous ne réduirons pas nos impacts sur l’environnement sans changer en profondeur nos modèles économiques. On sait par exemple à quel point les excès du capitalisme, et la dérégulation des marchés ont été coûteux pour la planète. Mais faire du PIB le responsable de tous nos maux, et le cœur de nos débats présente un danger, et une perte de temps.
Le PIB est tout sauf un indicateur environnemental. Par nature, certaines activités créatrices de valeur permettent de réduire les émissions, quand d’autres sont néfastes. De plus, la croissance économique est toujours utilisée dans les scénarios prospectifs de référence comme une donnée exogène du modèle, sur laquelle ni l’augmentation des températures ni l’épuisement des ressources naturelles n’a de prise. Cette construction donne l’impression fallacieuse que le PIB peut continuer à augmenter, indépendamment de toute réalité physique. Ainsi, si l’on prend le pire des scénarios climatiques étudiés par la BCE et le NGFS, il apparaît qu’une hausse de 5 °C en 2100 ne réduirait le PIB que de 25 % par rapport à un scénario sans réchauffement, ce qui est ridiculement faible. Cela prouve l’inadaptation des modèles utilisés.
C’est pourquoi il faut sortir une bonne fois pour toutes de l’obsession du PIB, et remettre cet indicateur à sa juste place, à savoir qu’il est un outil de comptabilité et de gestion utile pour les finances publiques, mais qu’il ne peut plus être l’alpha et l’oméga des politiques publiques. Le pilotage de nos économies doit se faire avec des indicateurs physiques et sociaux plus pertinents qui nous permettent de nous assurer que nous respectons les « limites planétaires ». Parmi ces indicateurs, on peut citer la théorie du Donut de l’économiste anglaise Kate Raworth, qui dit assez bien les limites sociales et planétaires dans lesquelles devront être contenues toutes formes de prospérité économique.
Pour en savoir plus, cliquez ici
- https://www.carbone4.com/publication-decouplage
- https://alaingrandjean.fr/2021/02/25/changement-climatique-de-pib/