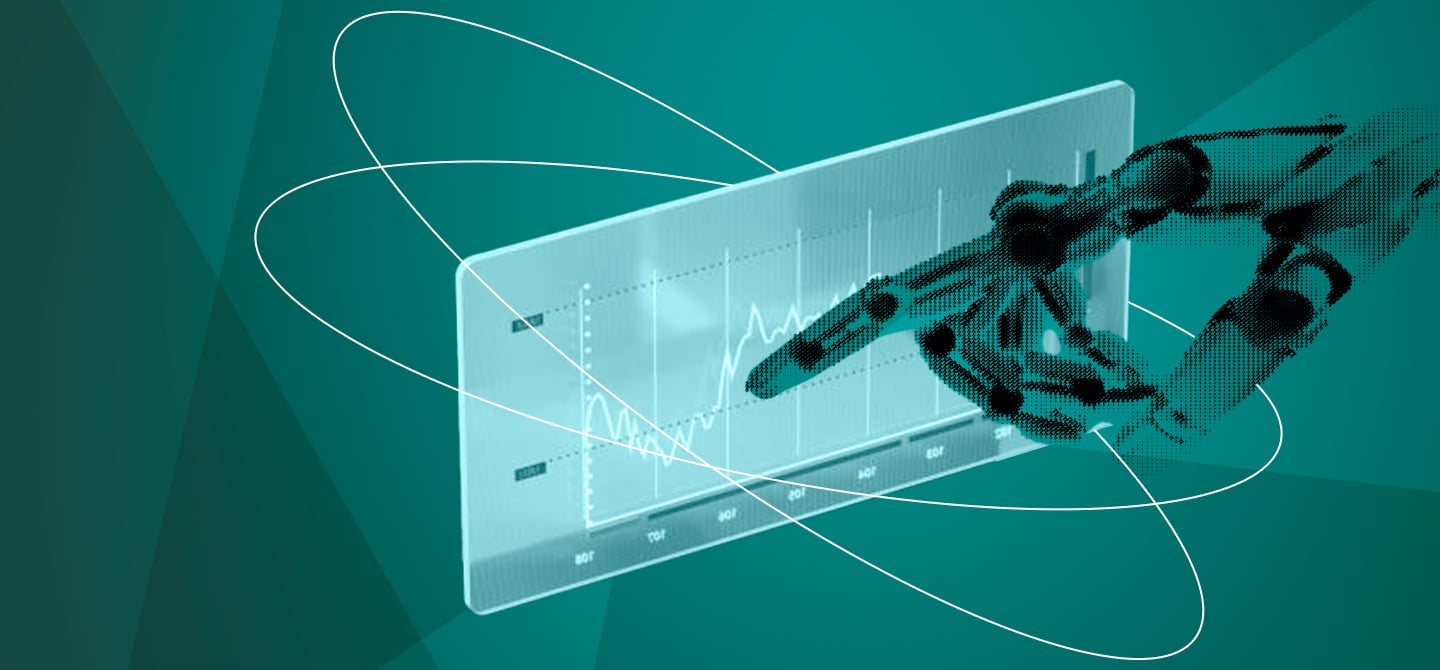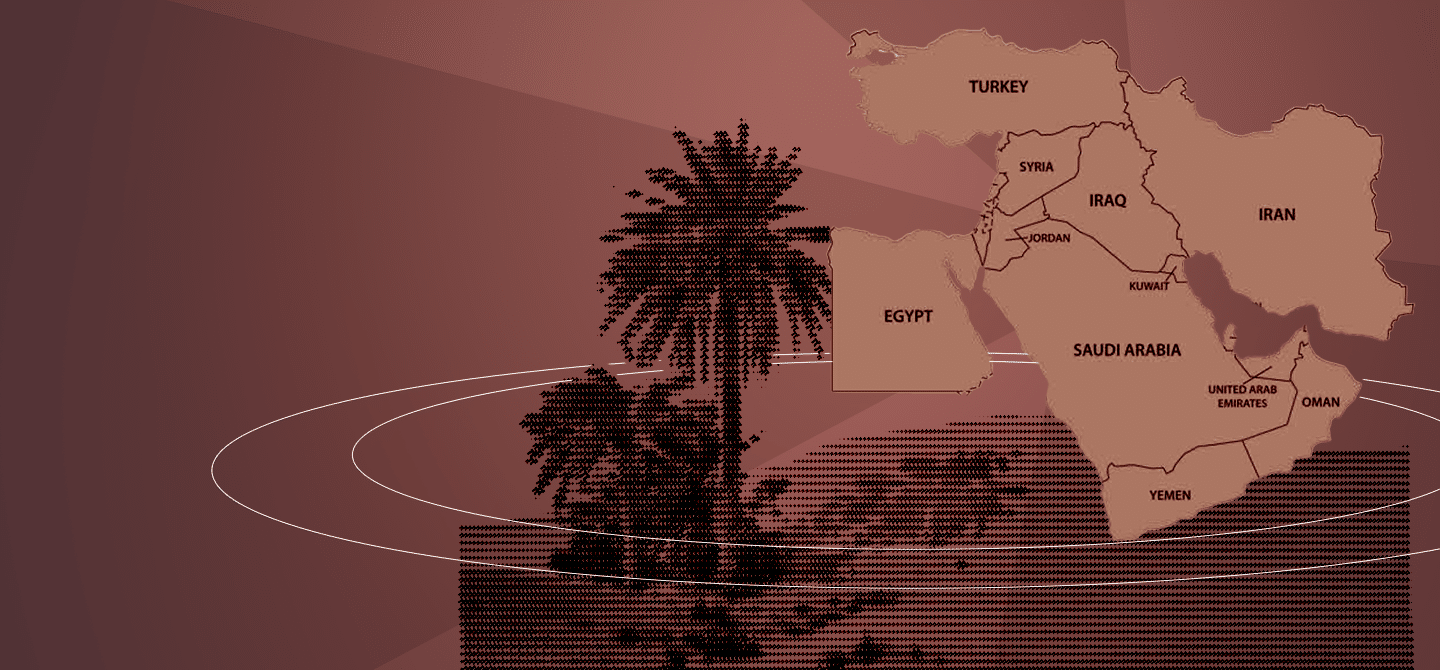Gaia‑X : le pari d’un cloud européen souverain
- En 2020, l’UE a lancé le projet Gaia-X, visant à construire une infrastructure de données interopérable, sécurisée et conforme aux normes européennes.
- Cette stratégie a pour objectif de renforcer la souveraineté numérique de l’Union européenne face à l’hégémonie des acteurs nord-américains.
- Gaia-X est un écosystème de nœuds interconnectés reposant sur des standards ouverts, afin d’éviter la concentration du pouvoir entre les mains d’un seul acteur.
- Le projet s’appuie sur le développement de collectifs de données sectoriels, destinés à faciliter l’échange sécurisé d’informations dans des domaines comme la santé, l’industrie automobile ou l’énergie.
- Toutefois, la mise en place de ces espaces se heurte à une réalité complexe : la gestion des relations entre des acteurs aux intérêts parfois divergents.
Alors que l’hégémonie des acteurs nord-américains – Amazon Web Services, Microsoft Azure ou encore Google Cloud – structure l’écosystème numérique mondial, l’Union européenne a lancé en 2020 le projet Gaia‑X, avec pour ambition de bâtir un rempart numérique, une infrastructure de données interopérable, sécurisée et conforme aux normes européennes1. L’initiative vise à encourager le développement de « data spaces » sectoriels dans des domaines tels que la santé, l’énergie ou encore la mobilité, afin de garantir une gestion des données alignée sur les principes de transparence, de réversibilité et de portabilité.
Cette année, Gaia‑X entre dans une phase d’implémentation, marquée par l’expansion de plus de 180 espaces de données2. Cette progression a été notamment mise en lumière lors de la plénière du Hub France, organisée en mars 2025, où les acteurs publics et privés impliqués ont débattu des enjeux de standardisation, des modèles économiques favorisant ces espaces de données, et des synergies potentielles avec l’intelligence artificielle3.
Dans un contexte où les flux transfrontaliers de données et l’IA redéfinissent les rapports de force géopolitiques, Gaia‑X soulève plusieurs interrogations : peut-il véritablement incarner une alternative crédible face aux mastodontes du numérique ? Sur quelles bases construire une infrastructure souveraine sans céder à l’isolement technologique ? Et quels leviers mobiliser pour en faire un vecteur d’innovation pour les entreprises européennes ?
Pour décrypter les enjeux sous-jacents à cette initiative, Francesca Musiani, directrice de recherche au CNRS, apporte son expertise en souveraineté numérique et en gouvernance des données. Elle a notamment analysé le projet Gaia‑X dans son article « À travers les infrastructures, c’est la souveraineté numérique des États qui se joue4 », où elle appréhende les implications de l’autonomie des États à travers les infrastructures de données.
L’Europe à l’épreuve de l’omnipotence numérique
L’Union européenne s’engage dans une stratégie visant à renforcer sa souveraineté et son contrôle sur les infrastructures numériques et les données, considérées comme des éléments prépondérants pour son autonomie. Face aux impératifs technologiques et géopolitiques actuels, l’objectif est de garantir que les acteurs européens conservent une maîtrise de cet écosystème. Un des leviers fondamentaux réside dans le développement de l’industrie numérique du continent, notamment dans des secteurs stratégiques comme le cloud, les composants microélectroniques et la cybersécurité. Le but est de réduire la dépendance à l’égard des fournisseurs extérieurs et de favoriser l’émergence d’acteurs européens offrant des solutions alternatives et indépendantes. Des projets phares, tels que l’Alliance européenne pour les semi-conducteurs et Gaia‑X, témoignent de cette volonté d’ériger une infrastructure numérique décentralisée et compétitive.

Francesca Musiani, directrice de recherche au CNRS, indique que le projet repose sur une architecture pensée à l’échelle de l’Union : « Gaia‑X a une structure de gouvernance européenne ; elle est une association AISBL [N.D.L.R. : Association sans but lucratif] basée en Belgique avec des organes de gouvernance qui sont composés majoritairement d’acteurs européens. » Cette approche vise à appréhender toute prise de contrôle par des puissances non-européennes. Bien que des entités extérieures puissent rejoindre le programme, elles doivent respecter des exigences strictes concernant les « règles de souveraineté et d’interopérabilité fixées », un point qui, selon la chercheuse, a parfois généré des « controverses en raison du “CV” de certains acteurs comme Microsoft, Google ou même Palantir ».
En parallèle, un cadre normatif ambitieux est mis en place pour encadrer l’utilisation des informations numériques. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est un pilier capital de cette approche, établissant des normes pointilleuses pour la protection des informations personnelles des citoyens européens5. De nouvelles régulations, telles que le Data Act et le Digital Markets Act, sont de rigueur pour améliorer la transférabilité des actifs informationnels, garantir la concurrence dans le secteur numérique et imposer des obligations aux plateformes en ligne afin d’éviter les pratiques anticoncurrentielles et d’améliorer l’accès aux données6.
Un autre aspect clé évoqué par Francesca Musiani est l’architecture décentralisée : « Gaia‑X n’est pas un cloud unique, mais un écosystème de nœuds interconnectés via des standards ouverts, ce qui est censé empêcher la concentration du pouvoir entre les mains d’un acteur unique, en particulier d’origine non-européenne. » Ce modèle, reposant sur une « interopérabilité garantie par des spécifications communes », cherche à minimiser les risques d’une domination excessive. La chercheuse souligne également la dimension juridique du projet, avec une protection contre les législations extraterritoriales : « Une partie importante de la stratégie de Gaia‑X est son exclusion du droit extraterritorial non-européen ; les fournisseurs doivent garantir que les lois extraterritoriales étrangères ne compromettent pas les données européennes. » Certains services vont même jusqu’à s’appuyer sur des « infrastructures entièrement européennes pour garantir une immunité juridique vis-à-vis des lois non-européennes ».
Pour proscrire toute influence indésirable, plusieurs mesures sont envisagées, comme le dit Francesca Musiani : « Limiter leur pouvoir de vote et de décision dans les organes de direction, contrôler les certifications par des auditeurs indépendants agréés par l’association Gaia‑X, et favoriser l’émergence d’alternatives européennes dans le cloud, l’IA et les données via des financements publics. » La transparence du processus décisionnel, avec des « arbitrages de gestion en principe publics » et une implication d’une « large communauté », constitue également un garde-fou important.
Les data spaces, entre vision et friction
Le dessein de Gaia‑X repose sur la création d’une infrastructure européenne de données interopérables, sécurisées et régies par des principes partagés, avec pour objectif de poser les bases d’une technologie souveraine qui pourrait rivaliser avec les plateformes dominantes non-européennes, tout en respectant les valeurs du continent, telles que la protection des données personnelles et la transparence des traitements.
« Le but ultime de cette démarche est bien la création d’un socle technologique européen souverain : le projet définit un cadre commun de standards techniques et de gouvernance qui garantit la compatibilité, la sécurité, et la portabilité des services numériques », explique Francesca Musiani.
L’entreprise repose sur l’essor des collectifs de données sectoriels, qui visent à faciliter l’échange sécurisé d’informations dans des secteurs stratégiques comme la santé, l’industrie automobile, l’énergie ou encore la mobilité. Des programmes tels que Catena‑X dans l’automobile ou GAIA‑X Health pour la santé sont des exemples concrets de cette approche. Ces actions ont pour objectif de garantir l’accès à des données essentielles pour l’innovation tout en assurant leur conformité avec le RGPD et les autres standards européens. Par exemple, Catena‑X ambitionne de transformer la chaîne de valeur automobile en Europe en facilitant la circulation des données entre les acteurs du secteur, tout en assurant leur sécurité et leur intégrité7.
Le dessein de Gaia‑X repose sur la création d’une infrastructure européenne de données interopérables, sécurisées et régies par des principes partagés
Le modèle proposé s’inscrit dans une logique de création d’un marché numérique intégré, où les données deviennent un bien commun à la disposition des entreprises européennes pour développer de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle. Les espaces de données sont également perçus comme des stimulus pour des opérations financées par des programmes européens comme Horizon Europe ou Digital Europe Programme, favorisant ainsi la formation de coalitions d’innovation. En ce sens, cette infrastructure entend favoriser la coopération renforcée entre acteurs publics et privés, ainsi qu’entre États membres, pour promouvoir une véritable autonomie numérique sur le continent.
« Cette initiative repose sur des collectifs de données sectoriels qui stimulent la co-innovation entre grands groupes, PME, laboratoires et institutions publiques », poursuit la chercheuse. « Elle sert de catalyseur pour les projets européens financés par des programmes comme Horizon Europe ou Digital Europe. »
Néanmoins, l’implantation de ces espaces se heurte à une réalité complexe : la gestion des relations entre les différents acteurs, aux intérêts parfois divergents, constitue un enjeu de taille. Cela est particulièrement visible dans des architectures comme GAIA‑X Health, où la diversité des parties prenantes et des approches nationales ralentit la synchronisation des actions. Au-delà des aspects techniques, ces défis impliquent des négociations de gouvernance difficiles, surtout en ce qui concerne la définition des normes communes à acter. Ce phénomène se traduit par des retards dans l’adoption des standards techniques et dans la mise en place des infrastructures nécessaires à la mutualisation des données.
« Le processus de coordination est difficile, car chaque acteur a ses propres exigences et priorités, ce qui génère parfois des tensions entre les pays européens eux-mêmes », observe la chercheuse.
Le dispositif progresse lentement, entre ajustements techniques et coordination encore en construction. Cela se traduit par une série de freins pratiques et institutionnels qui ralentissent sa mise en œuvre, et rendent encore incertain son succès à long terme. Par exemple, les divergences sur la répartition des rôles au sein des différents consortiums ou les questions de souveraineté numérique compliquent l’établissement de normes et standards communs pour tous les acteurs8.
« Bien que porteur d’une vision novatrice, ce projet reste fragile, en raison de tensions dans sa gouvernance, d’une maturité technique encore insuffisante et d’un manque d’alignement stratégique entre les différents acteurs européens », remarque Francesca Musiani.