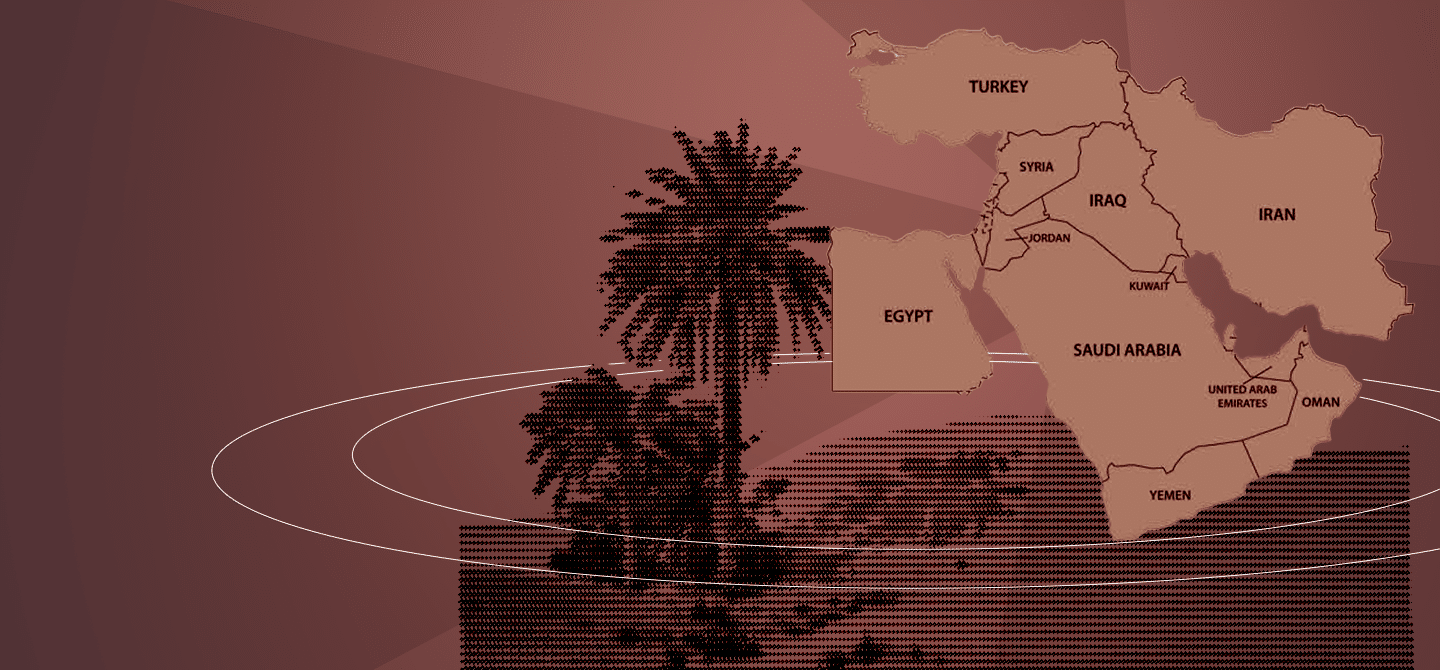Propriété privée et militarisation : les nouvelles frontières du droit spatial
- Au total, cinq conventions et leurs principes constituent aujourd’hui une base juridique solide, admise par tous et dont l’autorité est, à ce jour, incontestée.
- Le traité de l’Espace interdit les revendications de souveraineté par un État, mais il ne dit rien sur la propriété privée.
- Les accords Artemis sont un instrument juridique dont la signature conditionne la coopération des États avec les États-Unis et énonce un ensemble de principes nouveaux desquels est inscrit la propriété privée dans l’espace.
- L’adoption de normes techniques internationales est essentielle au développement des activités spatiales afin de développer une l’interopérabilité des équipements.
- Officiellement, l’espace n’est pas un théâtre d’hostilités, mais il est déjà fortement militarisé, notamment par des satellites de surveillance.
Dissimulées au-dessus de nos têtes, les constellations de satellites se multiplient à un rythme ahurissant. Pour preuve, les plus considérables actuellement, à savoir Starlink de SpaceX pour les États-Unis et Qianfan de la société Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) pour la Chine, ne cessent d’agrandir leur réseau. Ces déploiements d’appareils, ainsi qu’à plus large échelle les développements de projets spatiaux, occasionnent des interrogations juridiques cruciales, car, par exemple, en cas de collision entre des satellites, qui est le fautif ? Mais aussi, peut-on s’approprier les ressources minières de la Lune ou de Mars ? Ou encore, comment encadre-t-on les ambitions des acteurs privés et celles de certains États ? Pour répondre à ces interrogations, Lucien Rapp, spécialiste du droit de l’espace et professeur à l’Université de Toulouse-Capitole, ainsi qu’à HEC Paris, partage son expertise.
#1 Il existe un droit international de l’espace
VRAI
Effectivement, et aujourd’hui les activités spatiales sont aussi incluses. Ce droit international repose sur un certain nombre de textes juridiques fondateurs, dont le principal est constitué par le Traité de l’espace de 19671. Ces dispositions sont certes marquées par le contexte de guerre froide, mais elles restent très actuelles. Ce traité, signé par toutes les grandes puissances spatiales de l’époque – la France, les États-Unis, l’URSS et le Royaume-Uni – pose un certain nombre de règles comportementales dans l’exploration et l’utilisation de l’espace.
Tout d’abord, il sanctuarise l’espace extra-atmosphérique [N.D.L.R. : zone située au-delà de l’atmosphère terrestre] en s’opposant à toute revendication de souveraineté et en le dénucléarisant. Il invite les États à organiser les activités qui relèvent de leur juridiction et de leur contrôle. Il les rend responsables de leurs opérations et de celles de leurs ressortissants dans l’espace et sur terre. De plus, il protège les astronautes en en faisant d’eux des « envoyés de l’Humanité ». Ce traité n’est d’ailleurs pas le seul, car il est accompagné de quatre autres traités négociés entre la fin des années 60 et le milieu des années 70.
Au total, ces cinq conventions et leurs principes constituent aujourd’hui une base juridique solide, admise par tous et dont l’autorité est, à ce jour, incontestée.
#2 L’espace n’appartient à personne, il est en quelque sorte « sanctuarisé » ce qui sous tends que les États sont politiquement et juridiquement responsables
VRAI
Le Traité de l’Espace s’ouvre sur trois énoncés : l’engagement des États signataires d’explorer et d’utiliser l’espace, en ce sens est compris la Lune et les autres corps célestes « pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique », la proclamation – un peu contradictoire – de la liberté de le faire pour les États qui en ont les moyens et l’interdiction de toute appropriation nationale par proclamation de souveraineté. Le texte n’ajoute « ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen » comme s’il s’agissait de « l’apanage de l’Humanité tout entière » (dans la version française).
Le traité de l’espace est est articulé autour des États dont chacun est jugé responsable politiquement et juridiquement.
Et si l’on se souvient de la belle formule de Neil Armstrong lors la mission Apollon 11 (« c’est un petit pas pour l’Homme et un grand pas pour l’Humanité »), ces principes trouvent toutefois un écho dissonant dans la conjoncture actuelle où l’on évoque régulièrement l’éventualité d’une appropriation privée de ressources minérales tirées de l’espace, de l’installation de centrales nucléaires sur la Lune, de la mise en place de zones de sécurité autour des objets spatiaux.
Le traité de l’espace est généralement qualifié de traité « statocentré », ce qui signifie qu’il est articulé autour des États. Au sens du Traité, chaque État du club spatial est jugé responsable au double sens de ce terme : politiquement, parce qu’il doit organiser ses activités et celles de ses ressortissants ; juridiquement, parce qu’il prend l’engagement d’assumer les conséquences de ses actes et de ceux de ses ressortissants. C’est ce qui explique qu’avec le développement d’activités privées dans le secteur spatial et du nombre des États du club spatial, on ait vu se développer le nombre des lois spatiales. En France, le Parlement a adopté la loi relative aux opérations spatiales du 3 juin 2008, la LOS, qui fait office aujourd’hui de référence internationale pour de nombreux États.
#3 On peut exploiter librement les ressources minières de la Lune ou de Mars
INCERTAIN
En l’absence d’une interdiction spécifique, rien ne s’y oppose objectivement et il faut accepter que les règles évoluent pour régler définitivement le statut de ce type d’activités. La véritable question qu’il faut poser aux experts est celle de savoir ce que sont ces ressources, si elles présentent un intérêt économique et pour quels usages, à quels coûts et avec quelles technologies elles peuvent être extraites, stockées, raffinées, transportées … Ces questions sont, semble-t-il, entières.

#4 Selon ces règles, le traité de l’espace interdit donc la propriété privée ?
FAUX
On confond souvent souveraineté et propriété. Le traité interdit les revendications de souveraineté par un État, mais il ne dit rien sur la propriété privée autrement par la formule sibylline que j’évoquais plus haut : « ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen ». C’est dans cette brèche que les États-Unis avec les accords Artémis et d’autres États spatiaux après eux se sont engouffrés pour tenter de créer un précédent et se prévaloir d’une règle coutumière.
Durant l’été, ce sujet est revenu sur le devant de la scène internationale avec les projets américain ou sino-russe d’installation sur la Lune de réacteurs nucléaires destinés à produire de l’énergie électrique pour de futurs résidents. Cette installation défie par elle-même la règle autant que l’esprit du Traité de l’espace et, plus encore, de la convention internationale qui protège la Lune. Il s’y ajoute le fait que la nature sensible de la source d’énergie utilisée implique la mise en place de zones de sécurité, qui revient, pour les États concernés ou pour leurs ressortissants, à s’approprier des portions d’espace extra-atmosphérique.
#5 Les accords Artémis instaurent la propriété privée dans l’espace
INCERTAIN
Les accords Artemis sont un instrument juridique innovant, conçu par les autorités américaines, la NASA en particulier, et dont la signature conditionne la coopération des autres États avec les États-Unis sur le programme Artémis et, plus généralement, l’exploration pacifique de l’espace. Ils se présentent sous la forme d’un texte unilatéral, apparemment non négociable, énonçant un ensemble de principes nouveaux, qui complètent ou modifient sensiblement, pour certains de ces principes, le régime international des activités spatiales tel que défini par le Traité de l’espace. Parmi ces principes, figure en effet celui de la propriété privée dans l’espace.
Les accords Artémis précisent toutefois qu’ils s’inscrivent dans le respect du droit international général et du droit international de l’espace et que les engagements qu’ils recouvrent ne sont pas contraignants ; ce qui laisse un doute sur leur véritable portée juridique.
#6 L’espace est dénucléarisé, mais déjà militarisé
VRAI
Oui c’est l’un des enjeux actuels du droit international de l’espace. L’activité spatiale est par nature duale, militaire autant que civile. C’est vrai des technologies, c’est vrai de l’industrie, et c’est encore vrai des utilisations qui en sont faites.
D’où le contrôle des exportations pour éviter la prolifération des armements, l’interdiction progressive des missiles anti-satellites et les efforts actuellement déployés pour lutter contre les cybermenaces, du brouillage des émissions aux satellites-espions. La directive NIS2 en cours de transposition en France par un projet de loi dit « Résilience » va dans ce sens, tout comme le projet d’EU Space Act.
#7 L’espace deviendra un théâtre d’hostilités armées
INCERTAIN
L’espace n’est pas officiellement un théâtre d’hostilités, mais il est déjà fortement militarisé. Y cohabitent des satellites civils et militaires dont les activités pour ces derniers n’ont évidemment rien de pacifique. Il faut espérer que cette situation demeure et qu’elle ne bascule pas un jour prochain. Il semble que le plus grand nombre des États y soient attentifs.

#8 La Cour internationale de justice règle les conflits spatiaux, y compris privés
FAUX
Nous avons un juge international, la Cour internationale de justice. Mais ce juge ne règle que les conflits frontaliers entre États et l’espace extra-atmosphérique, en raison de sa nature, ne peut donner lieu à ce type de conflits. Je n’ai donc pas connaissance de décisions qui auraient été rendues en ce sens.
Mais l’on ne peut exclure que des difficultés se manifestent un jour, notamment dans la gestion du spectre des fréquences ou des positions orbitales, dont l’occupation est de plus en plus tendue et dont le régime international implique de délicates procédures de coordination. À défaut de faire l’objet de contentieux internationaux relevant de la Cour de justice internationale, ce type de litiges entre États, entre États et opérateurs, ou entre opérateurs peut relever de l’arbitrage international.
#9 La frontière entre espace aérien et espace extra-atmosphérique est claire
FAUX
Non. On sait définir l’espace aérien aussi bien dans la partie réservée à la circulation aérienne, telle que fixée par l’OACI que dans la partie correspondant à l’espace aérien supérieur, celui où évoluent actuellement des ballons ou des drones sophistiqués, les HAPS. Mais aucun des traités concernés, d’un côté la Convention de Chicago pour le transport aérien international et de l’autre le Traité de l’espace n’a fixé de frontières.
C’est d’autant plus gênant que la Convention de Chicago pose le principe de la souveraineté complète et exclusive des États sur leur espace aérien, alors que, comme je l’ai rappelé, le Traité de l’espace postule l’interdiction de toute proclamation de souveraineté de la part des États. Arbitrairement, on retient comme limite commode, la fameuse ligne de Von Karman, celle des 100 km.
#10 Les satellites doivent être immatriculés
VRAI
Comme les aéronefs ou les navires, ils dépendent de la souveraineté d’un État et lui sont rattachés. Et c’est parce qu’ils lui sont rattachés par l’enregistrement que l’État dit « de lancement » peut exercer sur eux sa juridiction et son contrôle et accepte d’en assumer la responsabilité internationale vis-à-vis des tiers comme des autres États. Tout cela est très cohérent.
J’évoquais plus haut l’interdiction de toute appropriation. Les objets spatiaux, corps artificiels dans l’espace extra-atmosphérique font exception à cette règle du fait de leur rattachement à la juridiction d’un État. La question reste toutefois de savoir si tous les objets spatiaux lancés – et pour beaucoup, encore opérationnels – sont effectivement immatriculés. Ce n’est malheureusement pas le cas. Le futur règlement européen (EU Space Act) dont le texte a été rendu public le 25 juin 2025, institue un registre européen des objets spatiaux, l’URSO, où seront recensés tous les objets lancés par les opérateurs européens autant que par les opérateurs non européens poursuivant des activités sur le territoire de l’Union.
#11 Les contrats et les normes techniques pèsent dans le droit spatial
VRAI
Les contrats que passent les opérateurs avec les agences spatiales nationales, comme entre eux sont aujourd’hui une source autonome et importante de règles juridiques. Pour beaucoup, ils comblent parfois opportunément les vides laissés par les textes nationaux ou internationaux.
L’adoption de normes techniques internationales est essentielle au développement des activités spatiales.
Un cas d’école est constitué par les contrats passés entre opérateurs pour les services fournis dans l’espace, de ravitaillement en carburant ou, plus généralement, de maintenance de satellites en fonctionnement. Pour fournir ses services, le satellite intervenant doit s’arrimer au satellite sur lequel l’intervention est requise. Arrimés l’un à l’autre, ces deux satellites forment-ils un seul objet spatial ou restent-ils distincts ? La question posée et que le contrat doit couvrir est évidemment celle de la responsabilité au cas d’accident causé à un autre satellite ou à un tiers.
L’adoption de normes techniques internationales est essentielle au développement des activités spatiales. Parce que la majeure partie du marché des activités spatiales est constituée par les communications par satellite, mais aussi parce que les industries du secteur spatial s’inscrivent dans des logiques d’assemblage. Tout cela implique l’interopérabilité des équipements. Il est donc important de disposer d’un corps harmonisé de normes techniques internationales.
#12 La gouvernance internationale de l’espace est stabilisée
INCERTAIN
Le Traité de l’espace et les conventions qui le complètent posent des bases solides. Même s’ils datent de la période des débuts de l’exploration spatiale, ils restent une référence utile qu’aucune nation spatiale ne songe sérieusement à remettre en cause. Depuis lors, l’espace est devenu un marché qu’il devient nécessaire de réguler. Le nombre des débris accumulés dans l’espace proche fait naître le risque d’un encombrement qui pourrait en condamner l’accès ; il faut donc le gérer. L’innovation est reine dans le secteur spatial et les évolutions technologiques vont assurément plus vite que celles des règles de droit.
Il faudra repenser la gouvernance de l’espace pour en tenir compte, songer à donner à l’espace extra-atmosphérique et à son exploitation commerciale éventuelle, un régime juridique inspiré de celui de la haute mer, retenir la cohabitation efficace d’une organisation internationale de plein exercice, l’OACI et d’une association internationale, l’IATA, que l’on trouve dans le secteur aérien, redéfinir le rôle des institutions onusiennes en place : le COPUOS, le Bureau des affaires spatiales internationales (CUPEEA).
Les périodes de grands bouleversements, comme celle que nous vivons dans le secteur spatial principalement, sont généralement propices aux grandes maturations qu’elles précèdent. Nous pouvons donc rester confiants.