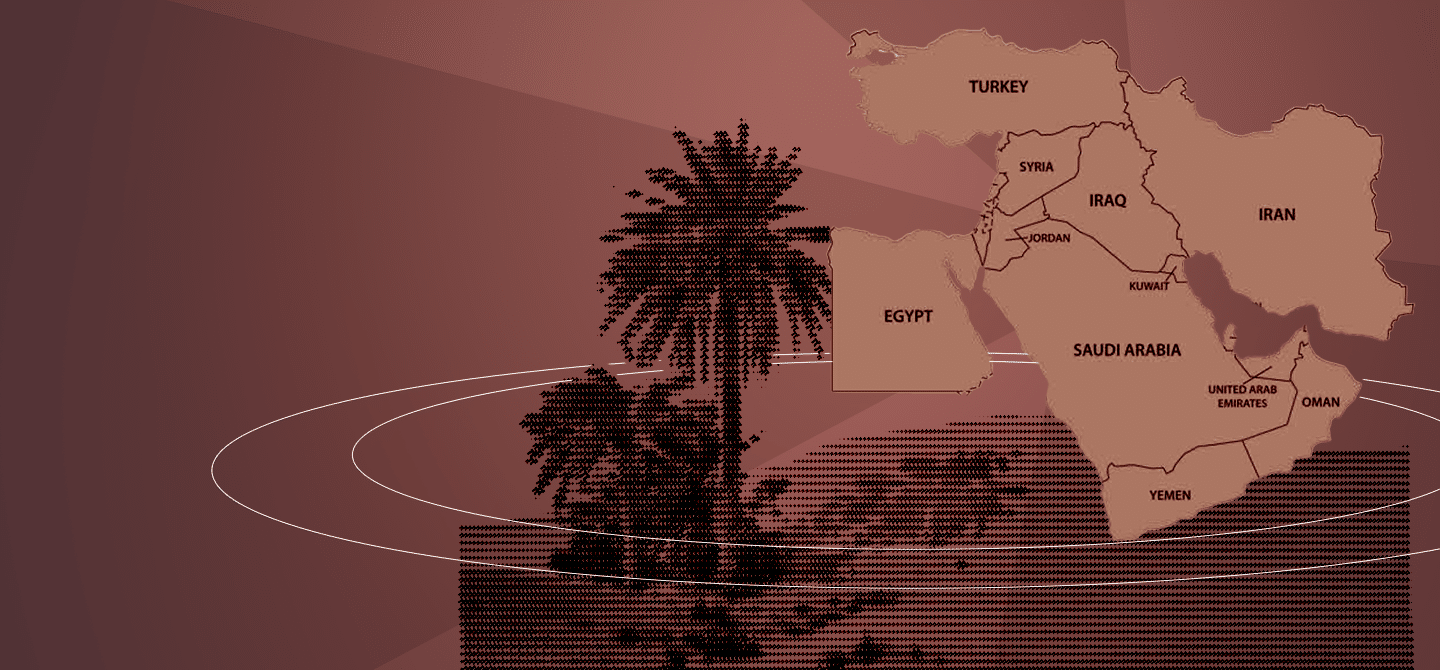Industrie de défense : comment l’Europe accroît sa production
- La France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la Suède sont les principaux États européens concepteurs, producteurs et exportateurs d’armement.
- Selon le SIPRI, la France se situe au second rang mondial des pays exportateurs d’armement sur la période 2020-2024, avec 18 Mds€ de prises de commandes en 2024.
- L’émergence de nouveaux pôles de production à l’est et au sud-est de l’Europe illustre la volonté des États de détenir sur leur territoire des capacités industrielles et technologiques sur des segments stratégiques.
- La montée en cadence des entreprises françaises de défense se poursuit, notamment avec les producteurs de systèmes d’artillerie, les munitions de moyens et gros calibres, les poudres et explosifs…
- La Commission européenne a présenté en mars 2025 un train de mesures dans le cadre du plan ReArm Europe, destiné à stimuler les investissements de défense.
Les atouts et les moteurs européens
Hélène Masson. Les armements et technologies militaires produits sur le sol européen sont pluriels et forment une offre européenne relativement complète : aéronautique militaire (avions de combat, avions de transport et de mission, hélicoptères, moteurs), armement terrestre (chars lourds, véhicules blindés médians et légers, véhicules logistiques et camions tactiques, systèmes d’artillerie, munitions tous calibres, équipements du combattant), naval militaire (sous-marins et navires de surface), spatial militaire, systèmes de missiles (tactiques et stratégiques) ou encore électronique de défense, TIC, cyber et systèmes autonomes (drones tactiques notamment).
La France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la Suède sont les principaux États européens concepteurs, producteurs et exportateurs d’armement. Toutefois, les Pays-Bas, la Finlande, la Norvège et la Belgique comptent également des capacités industrielles et technologiques sur des segments spécifiques ou dans la fourniture d’équipements et de sous-systèmes. Cette offre s’étoffe depuis l’invasion russe de l’Ukraine avec un mouvement de renaissance de l’industrie de défense à l’est de l’Europe. Le phénomène est alimenté par de fortes ambitions nationales en Pologne, en Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie, en Roumanie et dans les États baltes.
La France, leader dans la production européenne ?
Leader européen, la France se situe au second rang mondial des pays exportateurs d’armement sur la période 2020–2024, selon le SIPRI. Avec 18 milliards d’euros de prises de commandes, l’année 2024 représente un second haut point historique après celui de 2022 à 27 milliards d’euros (contre 8,2 milliards d’euros en 2023). Historiquement, l’offre française est fondée sur des systèmes d’armes complexes et haut de gamme, avec des ventes tirées par les avions de combat (Rafale), les sous-marins nucléaires d’attaque (Barracuda), les sous-marins à propulsion conventionnelle (Scorpène), et plus récemment, par les systèmes d’artillerie (canons Caesar) et les systèmes de missiles (Mistral et Aster notamment).
Les compétences françaises dans le domaine de la dissuasion nucléaire sont également reconnues, même si elles relèvent d’un périmètre exclusivement national. La base industrielle et technologique de défense française est structurée autour d’un noyau dur de maîtres d’œuvre industriels, têtes de filière (Dassault Aviation, Naval Group, branches françaises de KNDS et MBDA, Airbus Defence & Space, et Airbus Helicopters, ArianeGroup), et de grands systémiers-équipementiers (Thales, Safran). Elle compte une myriade d’ETI et de PME spécialisées, intervenant comme sous-traitants ou fournisseurs d’offres complètes, telles que Eurenco dans le domaine des poudres et explosifs, ou Exail pour la robotique navale.
Tandis que chaque pays européen tend à renforcer ses propres capacités, un risque d’éparpillement ou de concurrence intra-européenne est-il à prévoir ?
L’émergence de nouveaux pôles régionaux de production, à l’est comme au sud-est de l’Europe, illustre la volonté d’États se sentant menacés de détenir sur leur territoire national des capacités industrielles et technologiques sur des segments considérés comme stratégiques (véhicules blindés, armes, munitions, drones). Si cette évolution accentue la concurrence intra-européenne, elle ouvre également de nouvelles opportunités de partenariats entre les entreprises du vieux continent, via des coopérations interétatiques et interindustrielles en matière d’armement. Cette montée en capacités et en compétences à travers toute l’Europe devrait permettre aux États de reconstituer plus rapidement leurs stocks d’équipements et de munitions, de mieux répondre aux besoins ukrainiens et surtout d’être mieux préparés aux exigences d’une future guerre de haute intensité.

Néanmoins, cette forte hausse de la demande sur le marché européen de la défense aiguise toujours plus les appétits des entreprises concurrentes américaines, mais également israéliennes, coréennes et turques. Pour bénéficier de l’effet de taille du marché européen et résister à ces assauts, des opérations de concentration industrielle devront être menées dans les secteurs marqués par une fragmentation historique de l’offre (terrestre, naval, avions de combat), sous peine de perdre en compétitivité et de voir l’Europe rétrogradée au rang d’observatrice de la compétition technologique qui se joue entre les États-Unis et la Chine. Une volonté politique de la part des pays producteurs européens sera déterminante pour engager ces consolidations.
« Renforcer nos armées le plus rapidement possible », c’est l’objectif annoncé par Emmanuel Macron le 5 mars 2025. Les industries françaises avaient déjà augmenté la cadence au début de la guerre en Ukraine. Reste-t-il une marge de progression ?
La montée en cadence des entreprises françaises de défense a augmenté crescendo au cours de l’année 2023 et surtout en 2024. En première ligne, figurent les producteurs de systèmes d’artillerie, munitions de moyens et gros calibres, poudres et explosifs, et systèmes de missiles (KNDS, Eurenco et MBDA, en particulier). La formalisation de commandes par l’État français ou par des clients européens (ou en anticipation de ces marchés) a offert aux industriels et à leurs sous-traitants une meilleure visibilité, permettant d’être en mesure d’adapter leurs outils de production (modernisation des ateliers, nouvelles machines-outils, embauches et formation de salariés supplémentaires, constitution de stocks de pièces et de matières premières, relocalisation d’établissements, etc.). Cette dynamique d’adaptation, toujours en cours, repose sur un mix de financements : des investissements sur fonds propres, des aides publiques et, le cas échéant, des subventions européennes. Il restera toujours des marges de progression. Elles dépendront du niveau de commandes et de disponibilité des ressources humaines, matérielles et financières, mais aussi d’accès aux matières premières.
Afin d’augmenter les capacités de production, une réorientation des industries ou la relance de certaines lignes de production seront nécessaires. Quels sont les défis posés par ces processus ?
Contrairement à l’Ukraine, la France n’est pas en guerre, ni son économie, sinon l’heure serait aux mesures d’urgence, aux réquisitions et aux productions prioritaires. Cependant, pour ce qui est de l’augmentation des capacités de production, de nouvelles marges de manœuvre peuvent être trouvées dans un contexte d’attractivité du marché de la défense et de difficultés de certains secteurs civils comme l’automobile. L’exemple allemand en offre une bonne illustration. Rheinmetall réoriente la production d’une partie de ses établissements spécialisés dans le civil tout en proposant à Continental de reprendre une centaine de salariés d’un site en cours de fermeture. KNDS Deutschland va acquérir une usine du groupe ferroviaire Alstom. En France, citons Thales qui a réorienté à partir de 2023 la production d’un de ses établissements spécialisés dans la fabrication de cartes SIM vers des cartes électroniques destinées aux avions de combat.
Ces processus de réorientation peuvent s’étendre sur un ou deux ans, voire plus, selon le niveau de technicité requis. Si des PME sous-traitantes, déjà marquées par la crise Covid, cherchent aujourd’hui un nouveau souffle dans la défense, cette stratégie de diversification nécessite de disposer de capacités financières, car les obstacles sont nombreux : contraintes en matière de sécurité et sûreté, formation du personnel, acquisition de nouvelles machines, délai de notification des commandes.
Financer la production européenne : le plan « ReArm Europe » est-il à la hauteur ?
Toute la difficulté réside dans le fait de trouver de nouvelles marges de manœuvre financières lorsque le contexte économique et social est tendu dans nombre d’États européens. En juin 2025, l’OTAN devrait fixer des objectifs ambitieux aux Alliés : un minimum de 3 % du PIB consacrés à leur défense – encore loin de la cible fixée par Donald Trump à 5 % – et une part de 30 % dédiée aux équipements. La Commission européenne a en effet présenté en mars 2025 un train de mesures dans le cadre du plan « ReArm Europe/Préparation à l’horizon 2030 », destinées à stimuler les investissements de défense. Il voit la mise en place d’un nouvel instrument (SAFE) sous la forme de prêts destinés aux États membres d’un montant de 150 milliards d’euros. Ces derniers sont également invités à activer la clause dérogatoire nationale du pacte de stabilité et de croissance pour augmenter leurs dépenses de défense (maximum de 1,5 % du PIB par an, pour une période de 4 ans).
S’il ne s’agit pas, à proprement parler, d’un plan de 800 milliards d’euros, il représente néanmoins un puissant incitatif pour mutualiser les besoins, procéder à des achats communs et produire plus dans des domaines capacitaires jugés prioritaires. Il ouvre la voie à un changement de paradigme en produisant plus vite et en masse grâce à de nouveaux process de fabrication et une simplification des procédures d’achats.