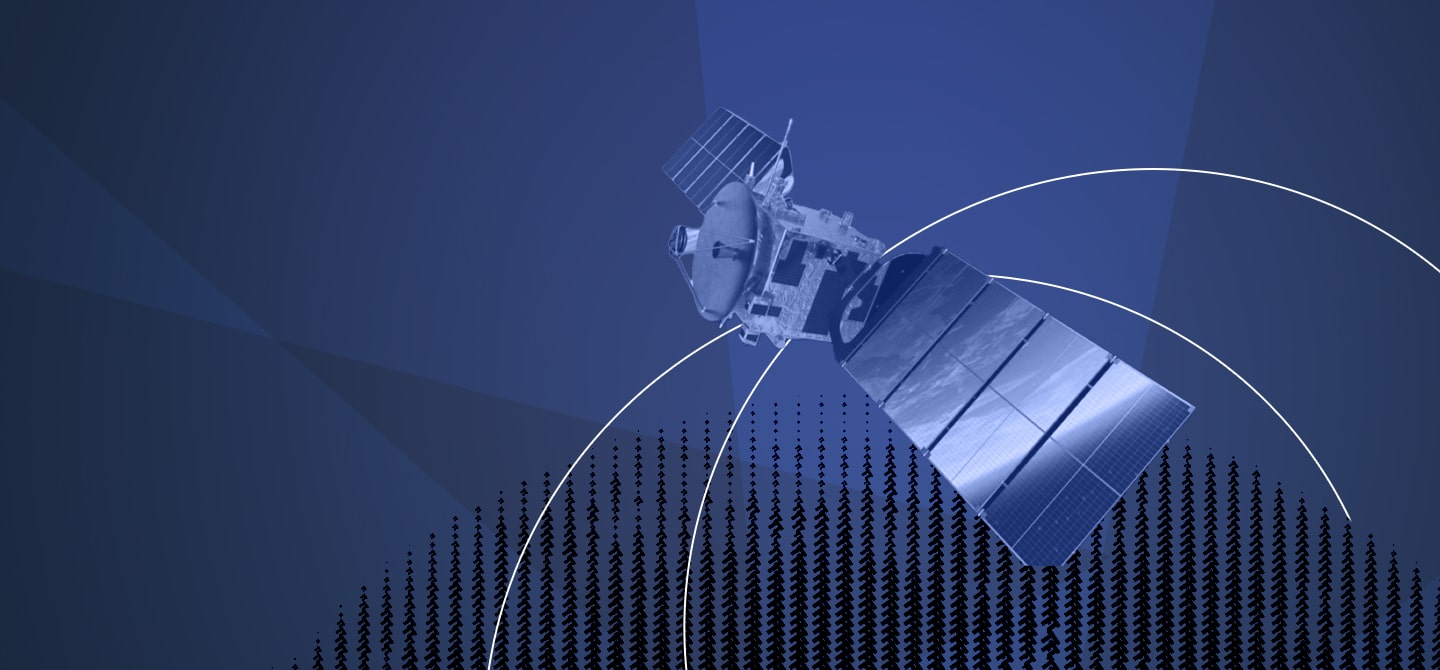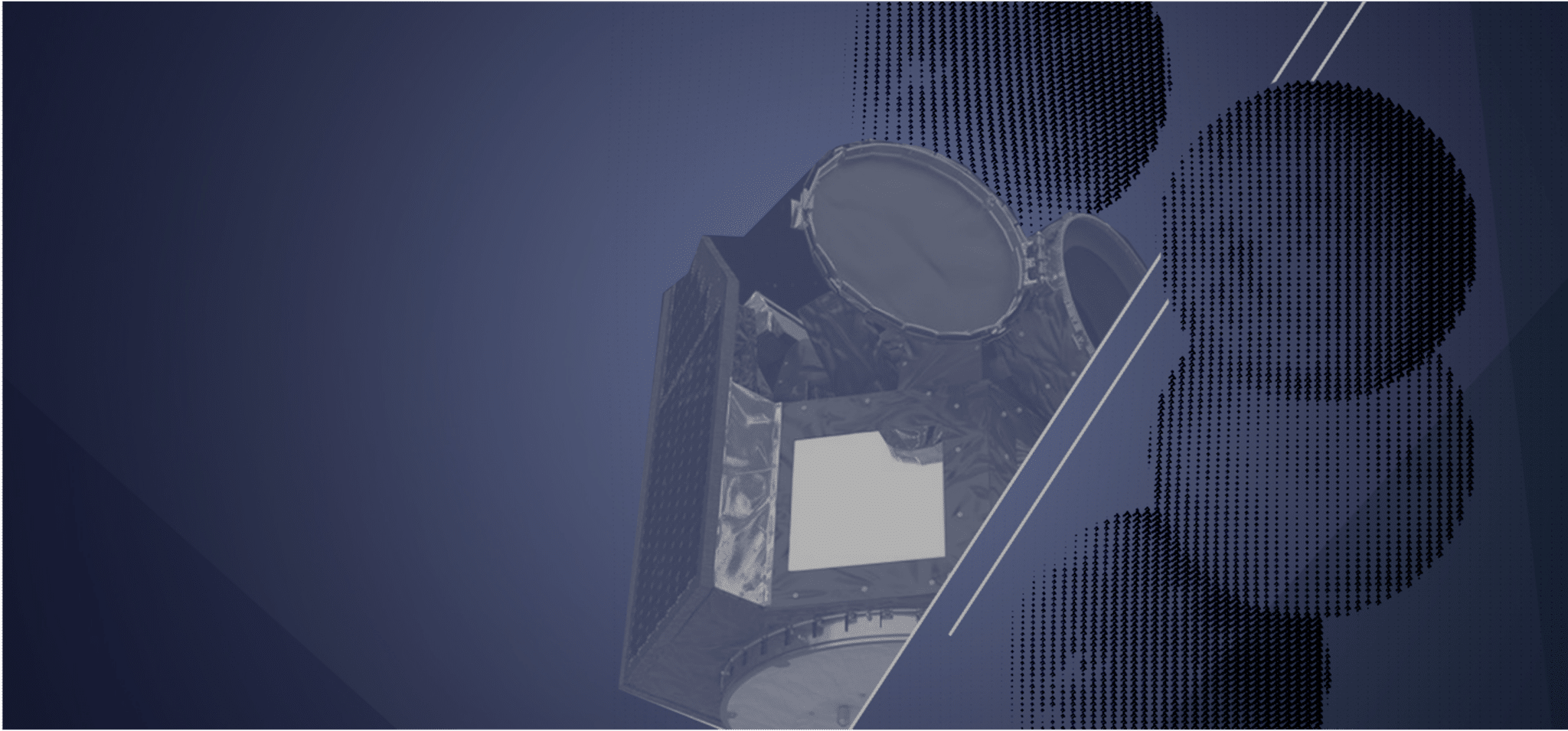Depuis le lancement de son premier satellite en 1970, la Chine a parcouru un chemin spectaculaire dans la conquête spatiale. Aujourd’hui troisième puissance mondiale dans ce domaine, elle rivalise avec les États-Unis et la Russie sur tous les fronts : vols habités, exploration planétaire, satellites d’application. Pourtant, malgré des budgets encore trois fois inférieurs à ceux de Washington, Pékin affiche des ambitions claires et une constance politique qui contraste avec les revirements américains. Entre mythes de prédation lunaire et réalités technologiques, quelle est la véritable nature de cette rivalité sino-américaine en orbite ? Isabelle Sourbès-Verger, directrice de recherche au CNRS, démêle le vrai du faux.
#1 La Chine est une puissance spatiale de premier rang
VRAI
Sans nul doute, la Chine figure aujourd’hui sur le podium mondial des puissances spatiales. Elle a démontré à plusieurs reprises ses capacités à réaliser tous types de missions, après avoir investi dans plusieurs grands domaines du spatial ces dernières décennies. Après avoir obtenu un accès à l’espace en toute indépendance en 1970 pour envoyer ses propres satellites en orbite, le pays est capable en 2003 d’envoyer des hommes dans l’espace puis de disposer de ses propres stations en orbite, autant de compétences que seules la Russie et les États-Unis possèdent. Les missions d’exploration, qui consistent à quitter l’orbite terrestre pour se diriger, par exemple, vers Mars, sont également maîtrisées. À ce jour, la Chine demeure, avec les États-Unis, la seule nation à avoir osé et réussi à poser un rover sur Mars et à le faire s’y déplacer. Sa maîtrise des technologies se vérifie dans le domaine des satellites d’application : les télécommunications, l’observation et la navigation. Enfin, l’astronomie et l’astrophysique sont deux champs d’étude eux aussi investis. En somme, tous les critères capacitaires permettant d’obtenir le statut de puissance spatiale sont largement remplis.
INCERTAIN
Si les États-Unis détiennent incontestablement la première place du classement depuis plusieurs décennies, la seconde et la troisième place sont plus difficiles à attribuer. Par rapport à la Chine, la Russie se démarque par ses capacités dans le spatial militaire, tandis que l’Union européenne porte d’ambitieux programmes de haute technologie, même si l’autonomie sur les vols habités lui fait défaut. Dans le cas où le critère retenu pour définir le classement est la diversité des capacités, et non le niveau de celles-ci, alors la Chine se positionne devant les deux concurrents, Russie et Union européenne. Néanmoins, plusieurs années d’efforts et d’investissements seront encore nécessaires avant d’être au coude-à-coude avec les États-Unis. Il suffit de comparer les budgets alloués au spatial pour saisir ce décalage entre les deux puissances. Washington consacre entre 60 à 70 milliards de dollars au domaine spatial, dont 40 à 50 milliards de dollars pour le spatial militaire, tandis que l’enveloppe chinoise s’élève à 20 milliards de dollars pour l’ensemble. Pékin a atteint son objectif premier, celui d’être reconnue mondialement comme une puissance spatiale de très haut rang en rattrapant un retard technologique initial considérable. En revanche, il n’est pas évident que ce soit dans le domaine spatial que la Chine veuille démontrer une supériorité par rapport à son concurrent, d’autres domaines symboliques sont aussi à conquérir.
#2 Les acteurs privés représentent un atout dans les stratégies spatiales
VRAI
Dans l’histoire spatiale des États-Unis, les grands industriels traditionnels, comme Boeing, étaient effectivement des acteurs privés qui détenaient un rôle clé dans la stratégie nationale. Cette configuration a profondément évolué, car les nouveaux acteurs – en premier lieu l’entreprise SpaceX et sa filiale Starlink, dirigées par Elon Musk – ont changé les règles du jeu. Ils se démarquent par leur volonté de mener leur propre politique spatiale, tandis que la première génération d’acteurs se contentait de remplir un rôle de prestataire en répondant aux commandes émises par la NASA. Aujourd’hui, les entrepreneurs du NewSpace peuvent posséder leurs lanceurs. C’est le cas de Starlink, avec les lanceurs Falcon fréquemment utilisés par la NASA et par le département de la Défense. Ces commandes publiques amortissent et rentabilisent leur coût financier.
La cartographie chinoise des acteurs est différente à bien des égards. Quelques structures privées sont implantées dans le domaine des télécommunications ou dans celui de l’observation, et depuis peu, des entreprises de fabrication de lanceurs ont émergé. Toutefois, le contrôle étatique étant inhérent au modèle chinois, l’économie et l’entrepreneuriat spatial en dehors du giron public restent soumis aux choix politiques.
INCERTAIN
La moitié des satellites opérationnels en orbite basse appartient à Starlink, société dont Elon Musk est actionnaire majoritaire. Dans l’espace, il contribue à conforter la place prépondérante des États-Unis mais il suit avant tout sa propre route, qui n’est pas toujours celle de la Maison-Blanche.
#3 La Chine comme les États-Unis veulent exploiter les ressources sur la Lune
FAUX
Lorsque la conquête lunaire fait débat, il est primordial de différencier les enjeux qui relèvent du vol habité de ceux qui relèvent du vol automatique. Dans l’optique d’exploiter les ressources lunaires, la présence humaine est un facteur de contraintes supplémentaires par les besoins en eau, en air, en nourriture… qu’elle génère. Cela suppose des infrastructures supplémentaires, et donc des coûts additionnels élevés alors que la robotique a fait des progrès majeurs.
L’exploitation des ressources comprend deux volets : l’utilisation sur place dite « ISRU » (In Situ Resource Utilization) et l’exploitation à des fins commerciales. L’ISRU est indispensable pour contribuer au fonctionnement des installations et à ce titre, la base sino-russe comme la base américaine ne peuvent pas s’en passer. En revanche, l’exploitation commerciale est une initiative purement américaine destinée à attirer le secteur privé mais qui, pour l’instant, est surtout soutenue par la NASA.
Le discours aux États-Unis consiste à positionner la Chine comme un compétiteur prédateur. Ce narratif, qui s’inspire de la concurrence sur Terre mais renvoie aussi à la course à la Lune avec l’URSS, sert à mobiliser les soutiens. Mais au-delà des mythes à faire vivre ou des défis technologiques, des questionnements politiques, voire éthiques, s’imposent lorsqu’on évoque les ressources lunaires et leur utilisation potentielle sur Terre. Quel serait l’intérêt de ramener une quantité forcément limitée de métaux rares dans une ère où leur consommation se compte en tonnes ? Par ailleurs, si l’on ajoute au coût d’exploitation, celui du retour, l’équilibre économique et la durabilité d’un tel modèle semblent incohérents.
INCERTAIN
Outre-Atlantique, la plus grande incertitude est avant tout d’ordre politique. Les projections du Président Trump en matière de conquête spatiale sont inconstantes. Le programme spatial Artemis de la NASA en est la preuve. Avec l’objectif d’amener un équipage sur la Lune d’ici 2027, il a été lancé sous son premier mandat, poursuivi sous Joe Biden, et maintenant remis en cause sous son second mandat.
À l’opposé, la Chine semble poursuivre un objectif clair : porter un citoyen chinois sur la Lune pour la première fois dans l’histoire nationale, apprendre à faire vivre des humains, puis mettre sur pied une base scientifique d’exploration. Rappelons-nous qu’en 1969, pendant que Neil Armstrong marchait sur la Lune, la Chine traversait la Révolution culturelle. En revanche, sur les questions des échéances, il est peu probable que les équipages accélèrent le rythme en réaction au retrait de Donald Trump. L’enjeu réputationnel est de taille, ils ne prendront pas le risque d’un échec.