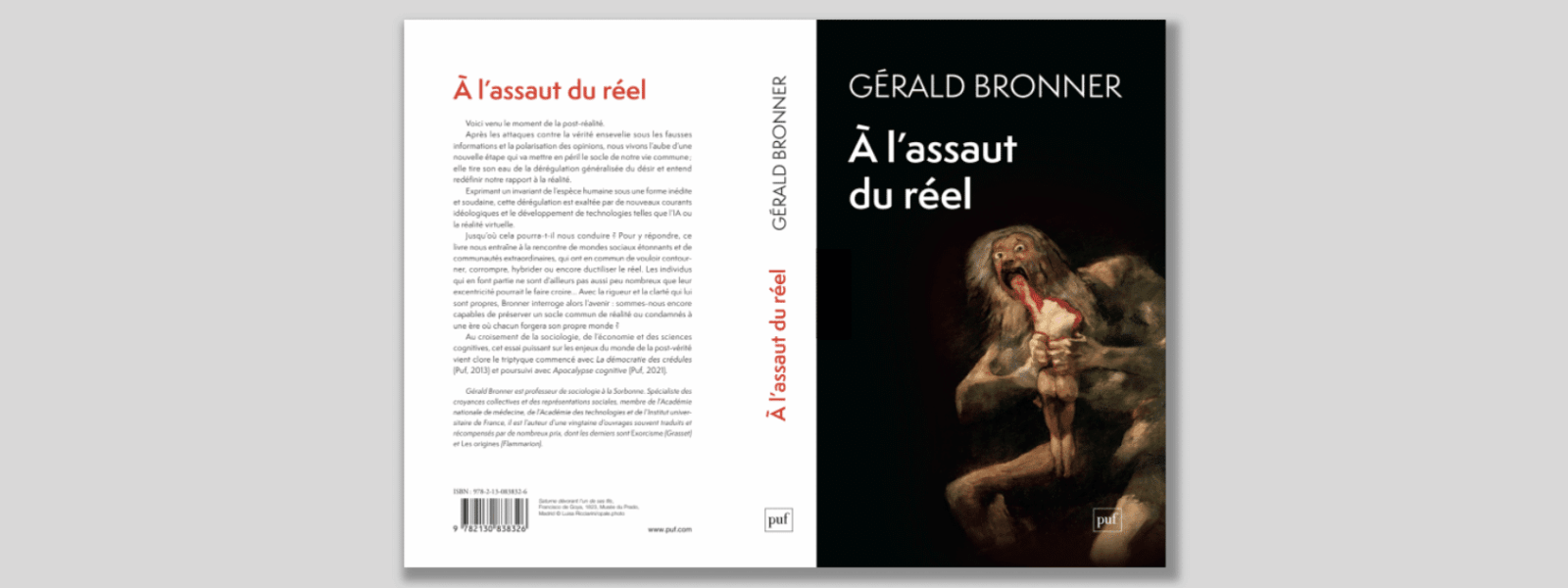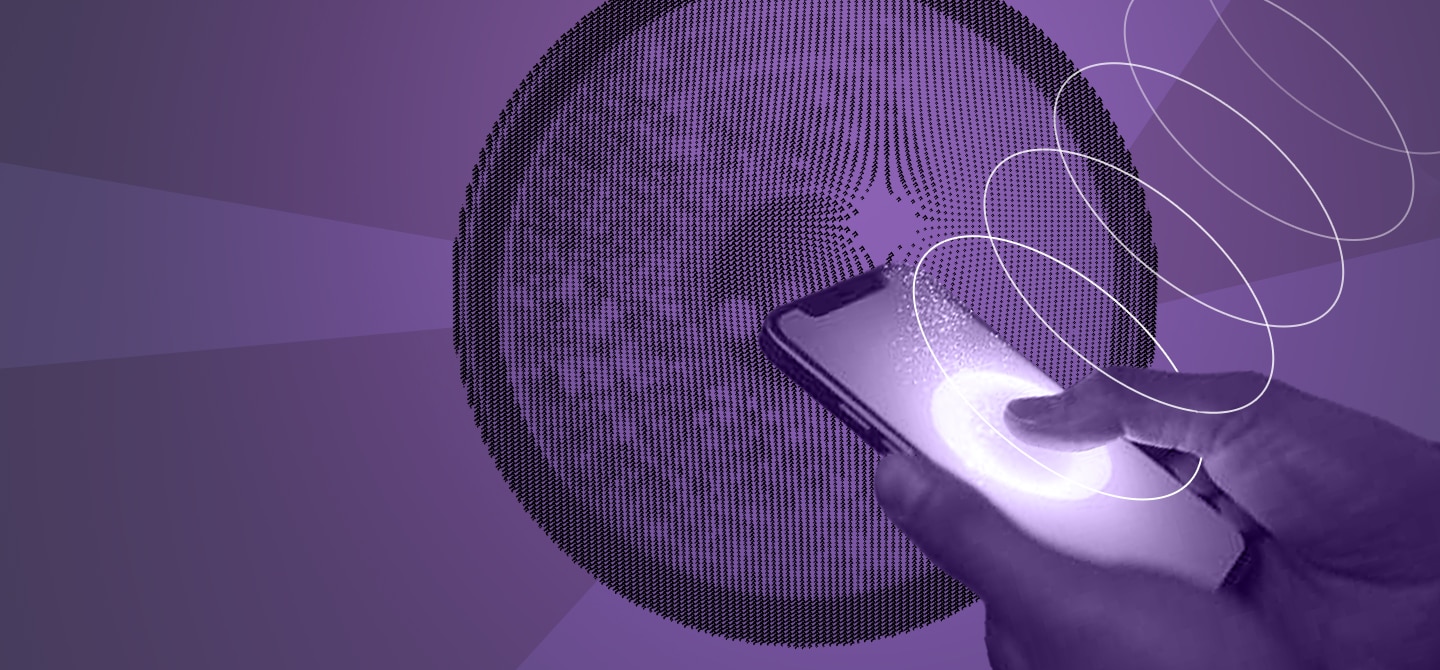Entre perception du présent et incertitudes collectives, comment « notre époque s’attaque au réel »
- Auparavant, le mythe du progrès dirigeait les regards vers le futur et le collectif, aujourd’hui, l’idéologie du présent oriente le regard sur soi.
- D’après un sondage Ipsos mené dans 50 pays différents, 62 % des citoyens sont d’accord avec l’idée que le présent est préférable à l’avenir.
- Aujourd’hui, l’impression de dépossession du monde provient d’une incapacité d’action dessus, comme réparer son téléphone ou sa voiture soi-même.
- La révolution technologique et l’essor du narratif interrogeant sans cesse le ressenti individuel provoquent des frustrations menant à l’alimentation d’un mal-être.
- Différentes communautés, comme les shifters, les therians, ou les hikikomoris viennent incarner une forme extrême de la fuite loin des autres et hors du monde.
Les attaques contre la science se multiplient. Or, ces groupes radicaux, qui se lancent ainsi à l’assaut des vérités communes, n’auraient pas d’audience s’ils n’étaient pas au diapason d’une tendance majeure de nos sociétés contemporaines : exiger du réel qu’il se plie à nos désirs, ou à nos ressentis. Une tendance que Gérald Bronner, sociologue sur les croyances et représentations sociales, nous propose de comprendre.
Dans votre dernier ouvrage, vous écrivez : « le présent cannibalise le réel » tout en faisant écho à la toile de Goya, « Saturne dévorant ses enfants » dès la première de couverture, que désirez-vous interroger par-là ?
Gérald Bronner. D’abord nos regards individuels — et donc, au collectif, l’agrégation de ces regards — se sont retournés vers l’intérieur de nous-mêmes. Ce faisant, ils se sont détournés de l’horizon lointain d’un espoir historique collectif. Un des indices de ce retournement, c’est la diminution de l’usage du terme de progrès, diminution que l’on observe dans toutes les formes de littérature et dans de nombreuses langues. L’application linguistique de Google, Ngram Viewer, montre un fléchissement dès les années 1960, suivi d’une baisse sans retour. Quelque chose d’invisible pour les hommes de l’époque se produit alors : une sortie du mythe du progrès, cette idéologie moderne qui voulait que l’avenir soit préférable au présent. Peu à peu, notre boussole personnelle s’est recentrée sur le présent et sur l’observation de nous-mêmes.
Aux grandes aventures collectives s’est substitué une autre aventure, tout aussi passionnante, mais qui a ses écueils : la découverte de soi, avec cette question obsédante : « qui suis-je ? » Et surtout : « qui aurais-je pu devenir ? » Cette deuxième question répond à un sentiment diffus de frustration : j’aurais pu devenir quelque chose de mieux, mais je n’ai pas vraiment optimisé mes potentialités. En ce sens, pourquoi ? Qu’est-ce qui m’en a empêché ? On observe donc, conjointement à l’affaissement du mythe du progrès, une obsession pour le développement personnel et la recherche du bonheur individuel. Cela s’observe dans les enquêtes menées par les sociologues et les sondeurs, mais aussi les slogans publicitaires ou la fiction. Cette recherche nous occupe de plus en plus, et à mesure qu’elle s’impose, la dimension temporelle de notre regard semble se réduire.
À l’exception d’un passé très proche, lorsqu’on demande aux gens à quel moment ils souhaiteraient vivre, ils répondent plutôt le présent
Plus personne ou presque ne veut vivre dans l’avenir, à peine 4 % de nos concitoyens. Et lorsqu’on interroge les habitants de 50 pays différents, comme l’a fait Ipsos, 62 % sont d’accord avec l’idée que « l’avenir peut se débrouiller tout seul, seul compte le présent ». Il y a certes des variations d’un pays à l’autre, mais presque partout, l’idée que l’avenir peut se débrouiller seul est majoritaire. Même dans les films, dans les fictions, l’incitation à la jouissance au présent est exposée comme une forme de sagesse. Elle affecte notre possibilité d’être des citoyens qui pensent à l’intérêt général et à l’intérêt collectif. Ce présent a dévitalisé le futur. Et la cancel culture ou culture du bannissement, ce regard d’indignation morale porté sur notre histoire, montre qu’il démonétise aussi le passé. À l’exception d’un passé très proche de nous : lorsqu’on demande aux gens à quel moment ils souhaiteraient vivre, ils répondent plutôt le présent et, curieusement, les années 1980. Le sentiment dominant est ce que j’appelle nowstalgie – une sorte de nostalgie du présent.
Cette « nowstalgie » est-elle la nostalgie d’un monde plus simple, par opposition au déferlement d’informations et au dérèglement du marché cognitif que vous avez étudié dans vos ouvrages précédents, La Démocratie des crédules (2012) et Apocalypse cognitive (2021) ?
Assurément, a posteriori, le monde d’hier nous paraissait plus contrôlable, plus maîtrisable intellectuellement. Il n’était pas multiface : deux blocs s’affrontaient, ce qui permettait une lecture morale plus simple. Le camp de la liberté, on pouvait le placer soit du côté de l’OTAN, soit du côté du pacte de Varsovie, selon sa sensibilité. La notion de souveraineté nationale était aussi beaucoup plus forte, bien sûr. L’individu avait l’impression que la décision politique était compréhensible et à portée de main, d’où une confiance beaucoup plus forte. Les propositions médiatiques, la masse d’informations déversée sur notre monde était bien moindre. Il y avait beaucoup moins de chaînes de télévision, de chaînes de radio, sans même parler de la dérégulation massive associée à l’essor d’Internet. Même si les technologies du quotidien sont beaucoup plus sûres aujourd’hui, nous ne pouvons plus directement intervenir sur ce monde technologique : si mon téléphone dysfonctionne, je suis obligé d’en changer ; je ne peux pas le réparer comme je changeais une ampoule ou, si j’étais un peu bricoleur, le moteur de ma voiture.

Tout cela donne une impression de dépossession du monde. Et cela excite une partie de l’âme démocratique. Tocqueville déjà notait la tendance des systèmes démocratiques à produire des individus frustrés. Cette mélancolie démocratique est exacerbée aujourd’hui par deux phénomènes. Le premier est la révolution technologique sur le marché de l’information et sur le marché de la production des objets cognitifs, comme les intelligences artificielles, qui perturbent intimement ce que nous sommes en tant qu’êtres humains et notre regard sur le monde. Le second phénomène tient à l’essor de ces grands courants narratifs, qui nous autorisent à regarder de façon obsessionnelle en dedans de nous-mêmes et à interroger sans cesse notre ressenti.
En quoi est-ce dangereux ? Tout simplement parce que l’étape suivante, c’est d’exiger que mon ressenti plie le réel. C’est-à-dire faire admettre aux autres que l’expression de mon ressenti soit une norme de vérité et de réalité. Cela affecte les frontières entre notre imaginaire et le monde tel qu’il est. C’est en cela que notre époque s’attaque au réel.
Une des forces de votre livre est d’articuler une vision globale, celle que vous venez d’exposer ici, à l’exploration des multiples groupes sociaux qui viennent l’incarner, parfois jusqu’à la caricature. Pouvez-vous nous l’expliquer ?
Il y a le visage de l’époque, et il y a sa grimace. Mais mon propos n’est pas d’alerter sur la folie du monde actuel en choisissant de n’y voir que sa grimace. Je ne pense pas que nous allons tous devenir des fictosexuels (c’est-à-dire n’éprouver de désir que pour des personnages fictifs) ou des thérians (les personnes qui s’identifient comme non-humaines ou pas entièrement humaines). Les exemples radicaux permettent d’affiner l’exploration ; ils permettent de tracer le périmètre de ce territoire qui s’exprime souvent sous des formes beaucoup plus anodines, même si elles sont dramatiques pour les individus, comme le reflux du désir.
Certains de ces groupes, par ailleurs, comptent des millions de personnes : ce sont des phénomènes sociaux qui requièrent notre attention – en tout cas la mienne, puisque je suis sociologue. Prenons les shifters, ou plutôt les shifteuses, car ce sont plutôt des filles : elles pratiquent le « reality shifting », une pratique mentale proche du rêve lucide, par laquelle certains individus disent arriver à se projeter mentalement dans des univers imaginés, alternatifs. L’explosion de cette pratique depuis le début des années 2020 est un fait social, que certains experts lient à l’expérience du confinement pendant la pandémie de covid, mais qui s’inscrit plus généralement dans cet « assaut du réel » que je décris dans mon livre.
Or, cet assaut prend des formes multiples, qui n’ont pas attendu la pandémie. Mais ces formes ont un point en commun : une difficulté grandissante avec l’altérité. Que l’on projette son égo partout dans l’univers, à la façon hyperbolique des transhumanistes les plus radicaux, où qu’on veuille absorber tout l’univers dans son propre égo par le ressenti qu’on impose aux autres, qu’est-ce qui disparaît ? C’est l’autre.
Parmi les multiples formes de cet « assaut du réel », certaines sont militantes, voire brutales, comme la suppression des données sur le changement climatique et les attaques contre la science menées par l’administration Trump. Mais d’autres, comme ces shifteuses, ne s’apparentent-elles pas plutôt à un désir, à un désintérêt pour le réel ?
Le désir cherche à s’imposer au réel, c’est le point commun de tous ces phénomènes. Mais ce désir peut refluer. C’est ce que pointait déjà Alain Ehrenberg dans son livre La Fatigue d’être soi (1998). Il montrait que, dans nos sociétés ayant supprimé de nombreux interdits, la dépression avait succédé à la névrose pour devenir le nouveau mal du siècle. Beaucoup de psychiatres s’accordent à dire qu’aujourd’hui, nous vivons des épidémies de dépression. Or, la dépression, ce n’est pas tant le fait d’être malheureux, que l’absence de désir et, incidemment, de plaisir : l’anhédonie. Ce reflux du désir est au cœur de l’expérience de certaines communautés évoquées dans mon livre, comme les hikikomoris, qu’on a vus apparaître dans le Japon des années 1980. Des jeunes gens – plutôt des garçons cette fois – qui, face aux injonctions qui leur étaient faites de réussir dans le système scolaire et confrontés à la première grande crise économique majeure que le Japon ait rencontré après la Deuxième Guerre mondiale, renoncent peu à peu à sortir de leur chambre. Ces communautés ont ensuite essaimé sous d’autres noms dans les autres pays développés. Qu’ont-ils en commun, ces hikikomoris ? Le désir reflue au point de vouloir contourner le réel, de vouloir passer toute sa vie dans sa propre chambre.
Cette dérive a un avantage extraordinaire pour ceux qui s’y abandonnent : elle permet de contrôler l’incertitude. Les hikikomoris ont une façon de ritualiser leur quotidien qui fait d’eux de petits tyrans domestiques : il faut manger à telle heure, etc. Toute leur existence se laisse lire comme une réduction de l’incertitude. Et qu’est-ce que l’incertitude ? C’est la claire conscience de l’ouverture des temps possibles. Si vous faites que demain ressemble à aujourd’hui qui ressemble à hier, le temps devient une ligne sans éventail d’incertitude et du champ des possibles. Votre vie devient un présent éternel.