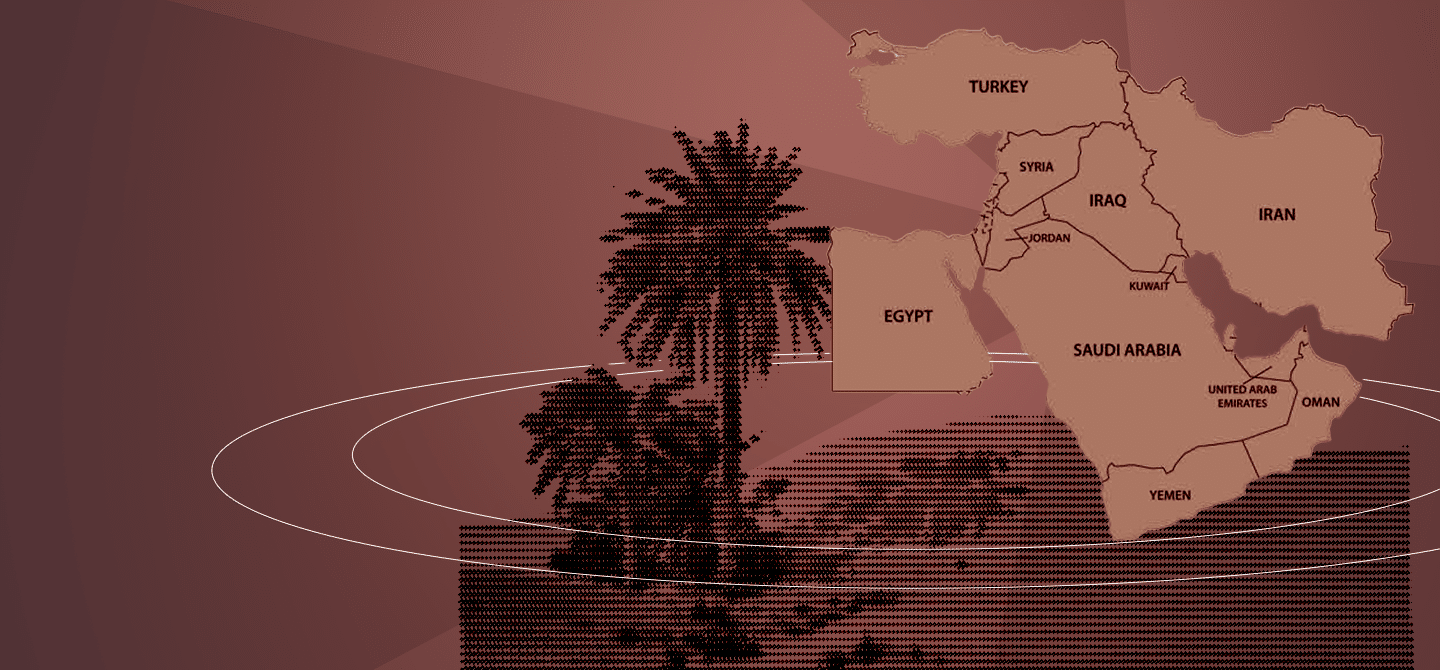Quelles exigences internationales pour faire face à l’innovation technologique chinoise ?
- Trois stratégies existent pour contrer l'essor technologique de la Chine : le techno-nationalisme, le techno-localisme et le protectionnisme.
- Le techno-nationalisme provoque des perturbations immédiates par des interdictions et le contrôle de l'exportation.
- Le techno-localisme exige une présence locale pour accéder au marché, ce qui crée des opportunités, mais aussi des risques concurrentiels.
- Le protectionnisme vise à protéger les industries nationales par l’intermédiaire de droits de douane, de subventions et de préférences en matière d'approvisionnement.
- La mondialisation axée sur le marché touche à sa fin, remplacée par un commerce influencé par la géopolitique et les règles de la concurrence.
Il y a deux décennies, la Chine était l’usine du monde, un endroit où les produits conçus en Occident étaient assemblés par une main-d’œuvre bon marché, puis réexpédiés vers les marchés riches. Aujourd’hui, les entreprises chinoises donnent le ton dans le domaine de l’intelligence artificielle, dominent les ventes de véhicules électriques et remettent en question la suprématie technologique de la Silicon Valley. Cette transformation a provoqué une onde de choc de Washington à Bruxelles et dans d’autres capitales occidentales, obligeant les décideurs politiques à établir des réponses de plus en plus sophistiquées à ce qu’ils considèrent comme une menace existentielle pour leur leadership économique.
Le résultat ? Un ensemble complexe de politiques que de nombreux dirigeants considèrent à tort comme un simple « découplage » avec la Chine. Or, la réalité est beaucoup plus nuancée, car les gouvernements occidentaux déploient trois stratégies distinctes. Comprendre ces approches est essentiel pour les entreprises qui cherchent à identifier à la fois les risques et les opportunités dans une économie mondiale de plus en plus fragmentée. Les enjeux sont considérables, car le développement technologique rapide de la Chine a créé des dépendances difficiles et onéreuses. De plus, ses 1,4 milliard de consommateurs représentent un marché trop important pour que la plupart des entreprises l’abandonnent.
Aujourd’hui, les préoccupations en matière de sécurité nationale conduisent à l’adoption de politiques qui pourraient remodeler fondamentalement le fonctionnement des entreprises mondiales, des chaînes d’approvisionnement jusqu’aux partenariats de recherche en passant par les stratégies d’accès au marché.
Techno-nationalisme : tracer des lignes claires dans les secteurs critiques
La réponse occidentale la plus brutale a été le techno-nationalisme, c’est-à-dire l’exclusion délibérée des entreprises chinoises des écosystèmes technologiques critiques pour des raisons de sécurité nationale. Cette approche représente un changement fondamental par rapport à la logique économique des intérêts commerciaux qui a guidé la mondialisation pendant des décennies. L’exemple le plus flagrant est la campagne menée contre Huawei, autrefois premier fabricant mondial de smartphones et leader dans le domaine des équipements de télécommunications 5G. Les restrictions imposées par l’administration Trump lors de son premier mandat ont été maintenues et renforcées sous la présidence de Joe Biden ont éloigné Huawei des services Google, des semi-conducteurs de pointe et des mises à jour logicielles essentielles. Le résultat a été dévastateur, car la part de marché mondial de Huawei dans le secteur des smartphones s’est effondrée, passant de 20 % à presque 2 % en seulement deux ans.
Le Bureau américain de l’industrie et de la sécurité tient désormais à jour une liste de plus de 600 entreprises chinoises interdites d’accès aux technologies américaines.
Cependant, Huawei n’était qu’un début. Le Bureau américain de l’industrie et de la sécurité tient désormais à jour une liste de plus de 600 entreprises chinoises interdites d’accès aux technologies américaines. Ces restrictions concernent aussi bien des cibles évidentes, comme le géant des télécommunications ZTE, que des entreprises moins connues dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la biotechnologie et de la fabrication de pointe. D’ailleurs, malgré son approche open source, l’entreprise chinoise DeepSeek a vu ses outils d’IA générative interdits dans les systèmes du gouvernement américain, les législateurs proposant même des restrictions plus larges. L’Europe a emboîté le pas, mais souvent avec des mesures moins radicales. Le Royaume-Uni a interdit Huawei de ses réseaux 5G d’ici 2027, tandis que l’Union européenne a donné aux États membres les outils nécessaires pour exclure les « fournisseurs à haut risque » des projets d’infrastructures critiques. Les Pays-Bas, qui abritent le fabricant d’équipements semi-conducteurs ASML, ont restreint les exportations de machines de lithographie avancées, essentielles à la production de puces informatiques de pointe.
Le secteur des semi-conducteurs est devenu un point particulièrement sensible. Les contrôles à l’exportation empêchent désormais les entreprises chinoises d’accéder non seulement aux puces avancées, mais aussi aux équipements nécessaires à leur fabrication. Ces restrictions ont contraint la Chine à investir des milliards dans ses capacités nationales en matière de semi-conducteurs. Pour les entreprises occidentales, les politiques techno-nationalistes créent des perturbations immédiates et souvent douloureuses. Les entreprises qui ont des partenaires, des fournisseurs ou des clients chinois dans des secteurs soumis à des restrictions sont confrontées à des séparations forcées et disposent de peu de temps pour s’adapter. La leçon à tirer pour les dirigeants est claire : attendre que les restrictions soient annoncées est souvent trop tard. Les entreprises avisées procèdent à des évaluations régulières des risques, développent des chaînes d’approvisionnement de secours et font pression pour obtenir des délais de mise en œuvre raisonnables par l’intermédiaire des associations industrielles.
Techno-localisme : garder la porte ouverte sous certaines conditions
Alors que le techno-nationalisme ferme complètement la porte, le techno-localisme la laisse ouverte, mais exige un prix. Ces entreprises chinoises peuvent participer aux marchés occidentaux, mais elles doivent établir une présence locale importante tout en transférant leur technologie comme condition d’admission. Cette approche reconnaît que l’exclusion totale de la technologie chinoise peut être économiquement préjudiciable, voire contre-productive. Elle cherche plutôt à tirer parti des avantages de l’innovation chinoise tout en conservant le contrôle national sur les technologies et les capacités de production essentielles. Ironiquement, cela reflète la stratégie adoptée par la Chine elle-même au cours des deux dernières décennies, lorsque les entreprises étrangères étaient soumises à des exigences similaires pour accéder au marché chinois.
L’exemple le plus marquant est la bataille en cours autour de TikTok. Plutôt que d’interdire simplement l’application, les législateurs américains ont exigé que l’entreprise ByteDance vende ses activités américaines à des propriétaires nationaux. La logique sous-jacente est que l’algorithme et les données des utilisateurs de TikTok représentent des actifs précieux qui devraient profiter aux intérêts américains plutôt qu’aux intérêts chinois. Des pressions similaires ont été exercées sur d’autres applications et services chinois qui traitent des informations sensibles sur les utilisateurs.
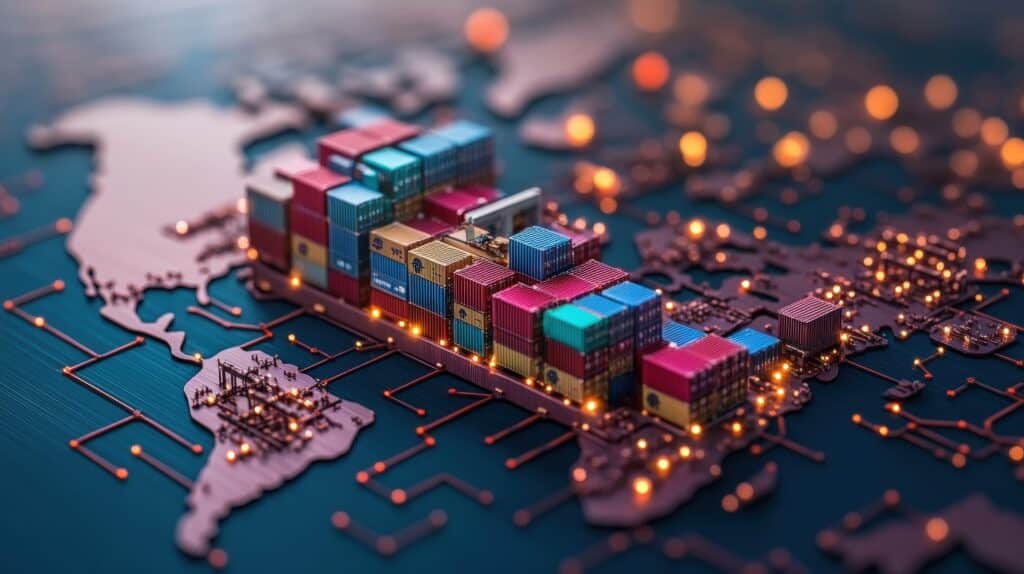
Dans le secteur des véhicules électriques, l’Union européenne a adopté le techno-localisme comme moyen de tirer parti de la technologie chinoise en matière de batteries tout en renforçant ses capacités industrielles nationales. Les géants chinois des batteries, tels que CATL et BYD, ont implanté des sites de production en Europe afin de bénéficier d’importantes aides au développement et de subventions. Ces accords permettent aux gouvernements européens d’exercer un certain contrôle sur les chaînes d’approvisionnement critiques tout en permettant aux entreprises chinoises de participer à la transition lucrative vers la mobilité électrique.
Cette approche s’étend aux exigences en matière de localisation des données, qui obligent les entreprises technologiques chinoises à stocker les données des utilisateurs européens à l’intérieur des frontières de l’UE, et aux mandats de coentreprise qui imposent de facto le partage des technologies comme condition d’entrée sur le marché. Certains accords vont plus loin, exigeant des accords de licence qui garantissent aux entreprises occidentales l’accès aux innovations chinoises.
Pour les entreprises, les politiques techno-localistes présentent à la fois des opportunités et des risques. À court terme, les entreprises occidentales peuvent accéder à la technologie chinoise de pointe, accroître leur part de marché et bénéficier d’avantages en termes de coûts grâce à ces accords. Cependant, le transfert forcé de technologie peut réduire la motivation des entreprises chinoises à innover dans le cadre de partenariats ouverts, ce qui pourrait laisser les partenaires occidentaux avec un accès à une technologie obsolète, les entreprises chinoises concentrant leurs derniers développements sur les marchés non réglementés.
La clé pour les dirigeants est de trouver un équilibre entre les gains immédiats et les risques concurrentiels à long terme. Les entreprises qui deviennent trop dépendantes des transferts de technologie forcés peuvent se retrouver désavantagées lorsque leurs partenaires chinois développent des stratégies alternatives ou concentrent leurs efforts d’innovation ailleurs.
Protectionnisme : préférence géographique plutôt que propriété
La troisième stratégie, le protectionnisme, adopte une approche totalement différente. Plutôt que de se concentrer sur la propriété des entreprises ou les questions de sécurité, elle vise à protéger les industries nationales par le biais de droits de douane, de subventions et de préférences en matière d’approvisionnement, quel que soit le lieu où se trouve le siège social d’une entreprise. Le droit de douane de 100 % imposé par l’administration Biden sur les véhicules électriques fabriqués en Chine est peut-être l’exemple le plus frappant de cette approche. Ce droit de douane double effectivement le prix des véhicules électriques chinois, les rendant non compétitifs par rapport aux alternatives nationales au détriment de leurs qualités technologiques. Des droits similaires ont été imposés sur les panneaux solaires, les semi-conducteurs, l’acier et l’aluminium chinois, créant des désavantages substantiels en termes de coûts pour les exportateurs chinois.
Ce protectionnisme moderne va au-delà des droits de douane. La loi sur la réduction de l’inflation prévoit jusqu’à 369 milliards de dollars d’incitations en faveur des énergies propres, avec des exigences en matière de contenu national qui favorisent les fabricants américains. La loi CHIPS, promulguée le 9 août 2022, alloue 52 milliards de dollars à la fabrication de semi-conducteurs, avec des restrictions empêchant les bénéficiaires d’étendre la production de puces avancées en Chine. L’Europe a réagi en adoptant son propre plan industriel Green Deal, qui prévoit des subventions substantielles pour la fabrication de technologies propres au sein de l’UE. Ces politiques visent à reconstruire la capacité industrielle nationale qui a été vidée de sa substance par des décennies de mondialisation. Les dispositions « Buy American » (achetez américain) dans les marchés publics fédéraux confèrent aux entreprises nationales des avantages significatifs en matière d’appels d’offres, tandis que les préférences au niveau des États étendent les politiques protectionnistes aux achats des gouvernements régionaux.
Les politiques protectionnistes s’avèrent souvent moins efficaces que prévu, car elles s’attaquent à la géographie plutôt qu’à la propriété ou au contrôle.
Cependant, les politiques protectionnistes s’avèrent souvent moins efficaces que prévu, car elles s’attaquent à la géographie plutôt qu’à la propriété ou au contrôle. Les entreprises chinoises ont fait preuve d’une remarquable capacité d’adaptation pour contourner les barrières commerciales grâce à des investissements directs, des stratégies de pays tiers et des accords de partenariat complexes. Le fabricant BYD, malgré les droits de douane élevés imposés aux véhicules construits en Chine, a conservé des contrats lucratifs avec les autorités de transport américaines grâce à son usine de fabrication en Californie. L’entreprise produit techniquement des véhicules « fabriqués aux États-Unis » tout en conservant la propriété et le contrôle chinois. De même, les fabricants chinois de panneaux solaires ont mis en place une importante capacité de production aux États-Unis, ce qui leur permet de bénéficier des subventions destinées à soutenir l’industrie américaine.
Les fabricants chinois acheminent également de plus en plus leurs produits via le Mexique, le Vietnam et d’autres pays afin d’éviter les droits de douane, tout en conservant le contrôle des technologies et des processus clés. Ces stratégies mettent en évidence un défi fondamental lié aux approches protectionnistes : dans une économie mondialisée, la nationalité de la production et la propriété peuvent être dissociées de manière à nuire à l’efficacité des politiques.
Naviguer dans le nouveau paysage
Le cadre à trois stratégies révèle pourquoi les discours simplistes sur le « découplage » passent à côté de l’essentiel. Les gouvernements occidentaux ne rejettent pas uniformément la technologie chinoise, mais déploient plutôt des outils sophistiqués pour remodeler la dynamique concurrentielle en leur faveur. Le défi pour les chefs d’entreprise consiste à comprendre quelle approche s’applique à leur secteur spécifique et à adapter leurs stratégies en conséquence.
Les entreprises opérant dans des secteurs jugés critiques pour la sécurité nationale (télécommunications, semi-conducteurs, intelligence artificielle) doivent s’attendre à des restrictions techno-nationalistes et planifier en conséquence. Celles qui opèrent dans des secteurs où le transfert de technologie est précieux peuvent trouver des opportunités dans les accords techno-localistes, mais elles doivent gérer avec prudence les risques concurrentiels à long terme. Dans les secteurs confrontés à des mesures protectionnistes, l’essentiel est de reconnaître que ces politiques créent souvent des ouvertures plutôt que des barrières, c’est-à-dire des opportunités de repositionnement stratégique plutôt que d’exclusion permanente.
La tendance générale est claire : l’ère de la mondialisation purement axée sur le marché touche à sa fin, remplacée par un système plus complexe où les considérations géopolitiques influencent de plus en plus les relations commerciales. Les entreprises qui s’adaptent rapidement à ces nouvelles règles d’engagement trouveront des opportunités, même dans un monde plus fragmenté. Celles qui s’accrochent à leurs anciennes hypothèses sur des marchés mondiaux sans friction pourraient se retrouver de plus en plus désavantagées.
Alors que les entreprises chinoises les plus compétentes continuent de s’adapter à chaque changement de politique, les entreprises occidentales sont confrontées à un choix difficile : faire évoluer leurs stratégies pour s’adapter à cette nouvelle réalité ou risquer d’être laissées pour compte dans un environnement concurrentiel en rapide évolution. Les entreprises qui prospéreront seront celles qui considèrent ces cadres politiques non pas comme des obstacles à surmonter, mais comme de nouvelles règles du marché.