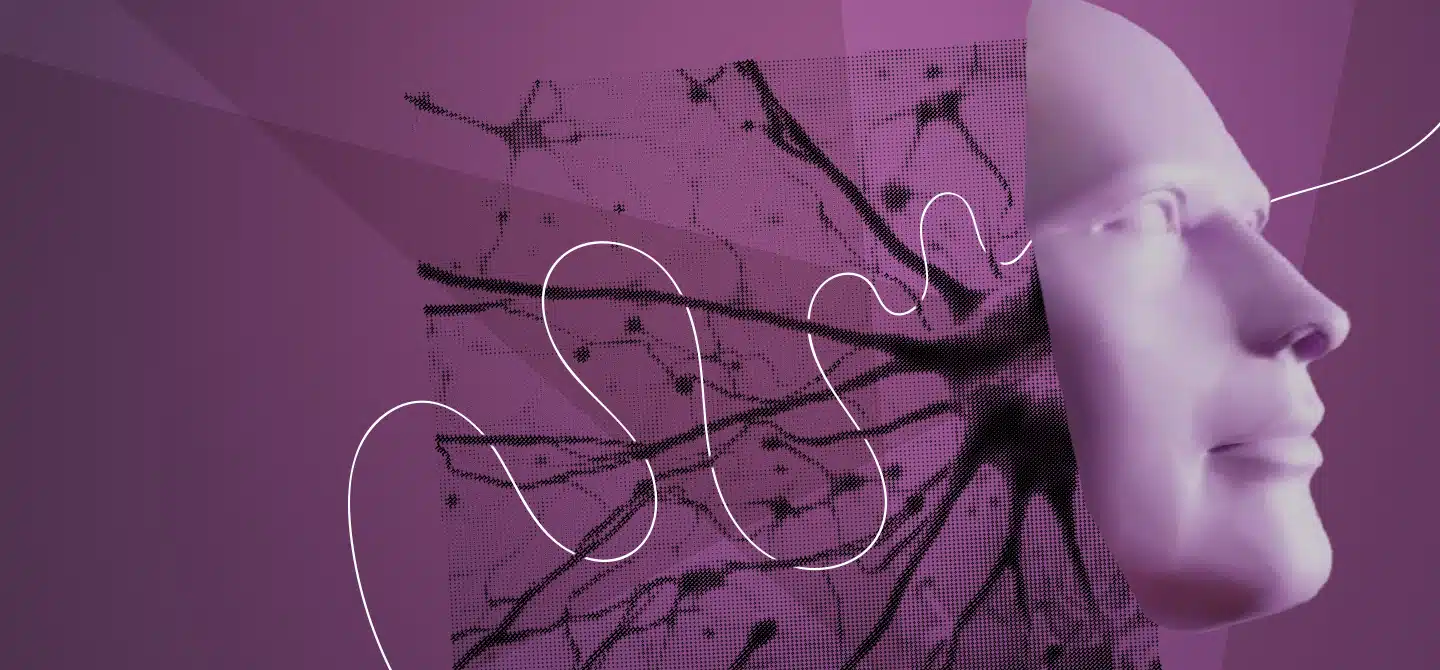Identifier la signature de la conscience est devenu le Graal des neurosciences. Mais peut-on réduire la conscience à ce qui s’observe en laboratoire ? Et quelle éthique appliquer à cette discipline nouvelle, qui suscite le double espoir d’avancées médicales importantes et de gains financiers conséquents ? Nous en discutons avec Laure Tabouy, neuroscientifique et éthicienne, qui poursuit un deuxième doctorat en éthique des neurosciences, du numérique, des neurotechnologies et de l’intelligence artificielle au sein du Centre Gilles Gaston Granger (CGGG UMR 7304) de l’Université Aix-Marseille, au cours duquel elle effectue une analyse critique de la neuroéthique qu’impose le développement des neurotechnologies, et de la convergence des neurosciences et de l’IA.
Quel type d’objet d’étude est la conscience ?
Laure Tabouy. La conscience est un objet d’étude parmi les plus complexes, faisant partie des sujets philosophiques et neuroscientifiques, car elle recouvre différentes dimensions imbriquées les unes dans les autres : conscience du monde extérieur et de soi, capacité à faire un retour sur ses propres pensées ou actions et de les analyser, lieu d’émergence de la volonté, faculté de jugement moral. Depuis Socrate, elle est l’un des objets d’étude majeurs des philosophes, et est devenue celui des neurosciences depuis les années 1960. La convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, de l’informatique et des sciences cognitives, depuis les années 2000, a donné l’espoir de parvenir à identifier, grâce à des technologies toujours plus sophistiquées, la signature physique de l’état de conscience, voire de la conscience réflexive. En parallèle de ces expérimentations portant sur l’activité cérébrale, diverses théories neuroscientifiques dites « de la conscience » ont ainsi fleuri au cours des dernières décennies.
En France, la « théorie de l’espace de travail global », énoncée à la fin des années 1980 par l’américain Bernard Baars et développée par les Français Stanislas Dehaene, Lionel Naccache et Jean-Pierre Changeux, semble emporter l’adhésion massive des neuroscientifiques. Pourriez-vous nous expliquer en quoi elle consiste ?
Il s’agit d’une théorie dite fonctionnelle, très intéressante sur le plan conceptuel, et qui n’est pas incohérente avec certaines observations faites en laboratoire. Elle ne décrit pas ce qu’est la conscience, mais ce qu’elle fait de façon perceptible. Selon elle, le fonctionnement cérébral s’apparenterait à un théâtre : les pensées conscientes occuperaient le devant de la scène, aussi appelées « espace de travail global », alors qu’en arrière-plan se dérouleraient en permanence des processus automatiques, localisés dans le cerveau et spécialisés, qui traiteraient les stimuli sensoriels. À un instant t, seuls les résultats de certains de ces processus seraient envoyés sous le feu des projecteurs, et ce faisant, deviendraient accessibles à l’ensemble des processus neuronaux automatiques agissant dans les coulisses.
Les tenants de cette théorie postulent que l’espace de travail global est formé de neurones à axones longs, capables de diffuser l’information à des aires cérébrales très distantes. L’émergence de la conscience se manifesterait donc selon eux par l’activation de ces vastes réseaux cérébraux.
D’autres théories existent-elles ?
Il en existe une trentaine ! Bien sûr, toutes n’ont pas le même écho au sein de la communauté scientifique – ni dans les médias et auprès des financeurs. L’une des grandes concurrentes de la théorie de l’espace de travail global est la « théorie de l’information intégrée », proposée par le neuroscientifique et psychiatre italien Giulio Tononi en 2004. Plutôt que de partir de l’activité cérébrale pour isoler la signature de la conscience, elle pose un cadre théorique global de ce qu’est la conscience, modèle mathématique à l’appui. Cette théorie la définit comme une propriété émergente de toute structure physique capable d’intégrer de l’information, et elle entend appliquer cette définition non seulement au cerveau, mais aussi à tout système traitant de l’information. Le degré de conscience d’un système dépendrait ainsi de la quantité d’informations qu’il est capable de traiter, et de sa capacité à les confronter les unes aux autres à différents niveaux, régionaux et globaux.
Là encore, ce n’est pas contradictoire avec ce que l’on peut observer au niveau local dans le cerveau. Mais cela amène les partisans de cette théorie à considérer comme « conscients » des systèmes artificiels comme des thermostats ou des photodiodes – une extension du concept de conscience qui, pour beaucoup de neuroscientifiques, soulève de sérieuses objections.
Cette théorie a fait autant parler d’elle par son caractère inédit, voire provocateur, que parce que 124 chercheurs l’ont qualifié de pseudoscience1 dans un preprint (N.D.L.R. : une version d’une publication scientifique qui précède son acceptation par le comité de lecture d’une revue scientifique) publié sur la plateforme PsyArXiv. Ce document reste cela dit assez léger sur le plan scientifique et est lui-même très controversé au sein de la communauté neuroscientifique.
Il n’y a donc pas de consensus théorique au sein des neurosciences sur ce qu’est la conscience ?
Non. Une étude2 récente de collaboration contradictoire a comparé la théorie de l’espace de travail global et celle de l’information intégrée selon un protocole établi par un consortium qui se présente comme neutre sur le plan théorique. Leurs résultats confirment certaines prédictions des deux théories, mais remettent également en question certains de leurs principes-clés. Au fond, ce n’est pas très étonnant. Les neurosciences restent une discipline académique assez jeune. Elles doivent encore trouver leur convergence théorique interne, et cette convergence s’opérera vraisemblablement par la combinaison de plusieurs théories.
Vous évoquiez une pluralité de dimensions imbriquées dans la conscience. Ces « théories de la conscience » englobent-elles toutes ces dimensions ?
Les neurosciences en vogue adoptent souvent une approche réductionniste, c’est-à-dire qu’elles envisagent leur objet d’étude (la conscience) comme la résultante de sous-systèmes (des processus cérébraux ou la structure organisationnelle de l’information, pour les deux théories citées). Le réductionnisme n’est pas un problème en soi : il permet de définir un cadre qui rend l’expérience possible. On comprend bien cela étant que cela pose déjà entre nous et la réalité un prisme auquel peuvent échapper certaines dimensions de la conscience.
Mais les théories neuroscientifiques les plus médiatiques – parmi lesquelles la théorie de l’espace de travail global, au plus haut point, et la théorie de l’information intégrée, dans une certaine mesure – s’appuient également sur un matérialisme radical : elles partent du principe que la conscience se réduit à des processus physiques. C’est un présupposé philosophique fort, qui peut – et doit – être interrogé. Il n’est pas lui-même le résultat d’un consensus scientifique et la philosophie, dont il est tiré, est riche en modèles alternatifs pour expliquer ce qu’est la conscience : idéalisme, certaines formes de pluralisme, dualisme notamment cartésien, spiritualisme… Rien ne permet en fait raisonnablement de trancher de manière définitive en faveur d’une conception matérialiste de la conscience.
Comment expliquez-vous cette option fondamentale pour un matérialisme radical ?
Elle me semble découler des conditions de naissance des neurosciences elles-mêmes. C’est l’apparition de technologies d’observation de l’activité cérébrale extrêmement performantes qui a motivé leur émergence. L’incroyable efficacité de ces dispositifs nous a en quelque sorte aveuglés : nous avons confondu ce que nous étions ou serions à l’avenir capables de voir – et qui de fait est extraordinairement riche – avec la réalité tout entière. La recherche de financements joue aussi un rôle dans cette posture : il est plus vendeur de dire que l’on va mettre la main sur la conscience que d’annoncer que l’on espère progresser dans l’observation d’une partie des phénomènes physiques liés à l’activité consciente du cerveau…
Au fond, en quoi cette option matérialiste pose-t-elle un problème éthique ?
Elle devient problématique quand on la considère comme l’unique condition d’accès à la vérité de ce qu’est la conscience. Dans ce cas, il s’agit d’une posture idéologique qui fausse profondément les débats éthiques, en créant un climat de réflexion biaisé. S’appuyant sur ce postulat matérialiste, certains commencent par exemple à évoquer un possible téléchargement de la conscience à l’avenir. Cette idéologie transhumaniste relève de la technoscientifique, et elle oriente déjà la recherche, les choix politiques et financiers dans une direction éthiquement très contestable. Des entreprises de neurotechnologie adoptent clairement ce parti pris en annonçant qu’elles peuvent « lire votre cerveau » ou « déchiffrer vos ondes cérébrales pour exploiter vos capacités insoupçonnées ».
La perspective d’une maîtrise de l’homme sur sa propre conscience exerce par ailleurs une telle fascination qu’elle invisibilise d’autres questions pourtant brûlantes. Jusqu’où sommes-nous prêts à aller dans la modification artificielle du cerveau humain ? Comment évaluer l’impact des dispositifs neurotechnologiques sur l’évolution de l’homme, et est-ce ce vers quoi nous souhaitons collectivement aller ? Et celle qui anime ma thèse : comment sortir la neuroéthique du cadenassage technosolutionniste politique et économique qu’impose le développement des neurotechnologies, et de la convergence neurosciences – IA ?
Il est crucial que l’éthique puisse se faire entendre, ce qui n’est pas réellement le cas aujourd’hui.
Une Recommandation3 du Conseil sur l’innovation responsable dans le domaine des neurotechnologies a pourtant été émise par l’OCDE en 2019, déclinée en France en une charte4 cosignée par de nombreux organismes de recherche. L’UNESCO prépare également une recommandation qui devrait voir le jour en novembre 2025. Il semble que l’éthique des neurosciences s’organise…
L’éthique des neurosciences est récente : on peut estimer qu’elle est née en tant que branche de l’éthique à part entière en 2002 seulement, lors de la conférence de San Francisco sur la « neuroéthique ». Les textes que vous évoquez ont été rédigés dans le contexte d’une effervescence géopolitique associée au lancement de gigantesques projets de recherche sur le cerveau, comme le Human Brain Project5 entrepris à l’initiative de la Commission européenne ou la Brain Initiative6 lancée par l’administration Obama. Il s’agit moins du fruit d’une vraie réflexion éthique, interrogeant les fondements et les conséquences des développements technologiques en cours, que d’une tentative d’accompagnement des dits développements, pour l’essentiel inféodée à une logique de marché.
Que faudrait-il pour qu’une vraie réflexion éthique puisse voir le jour ?
Des voix dissonantes existent, parmi les philosophes, les éthiciens, les neuroscientifiques eux-mêmes, mais elles sont aujourd’hui étouffées… Une vraie réflexion éthique doit s’appuyer sur une véritable controverse philosophique, anthropologique, et culturelle. Il faut garder à l’esprit que les théories matérialistes occidentales sont loin d’être universelles. Au-delà des courants philosophiques déjà cités, la quasi-totalité des spiritualités et religions ont une vision non matérialiste de la conscience. Cela doit nous inviter à un décentrement théorique. L’éthique doit aussi rester indépendante des intérêts financiers liés aux développements technologiques qu’elle interroge. Et enfin, il est nécessaire qu’elle garde en ligne de mire l’unique question, au fond, qui est la sienne : ces développements technologiques sont-ils réellement au service de l’homme, dans toutes leurs dimensions ?