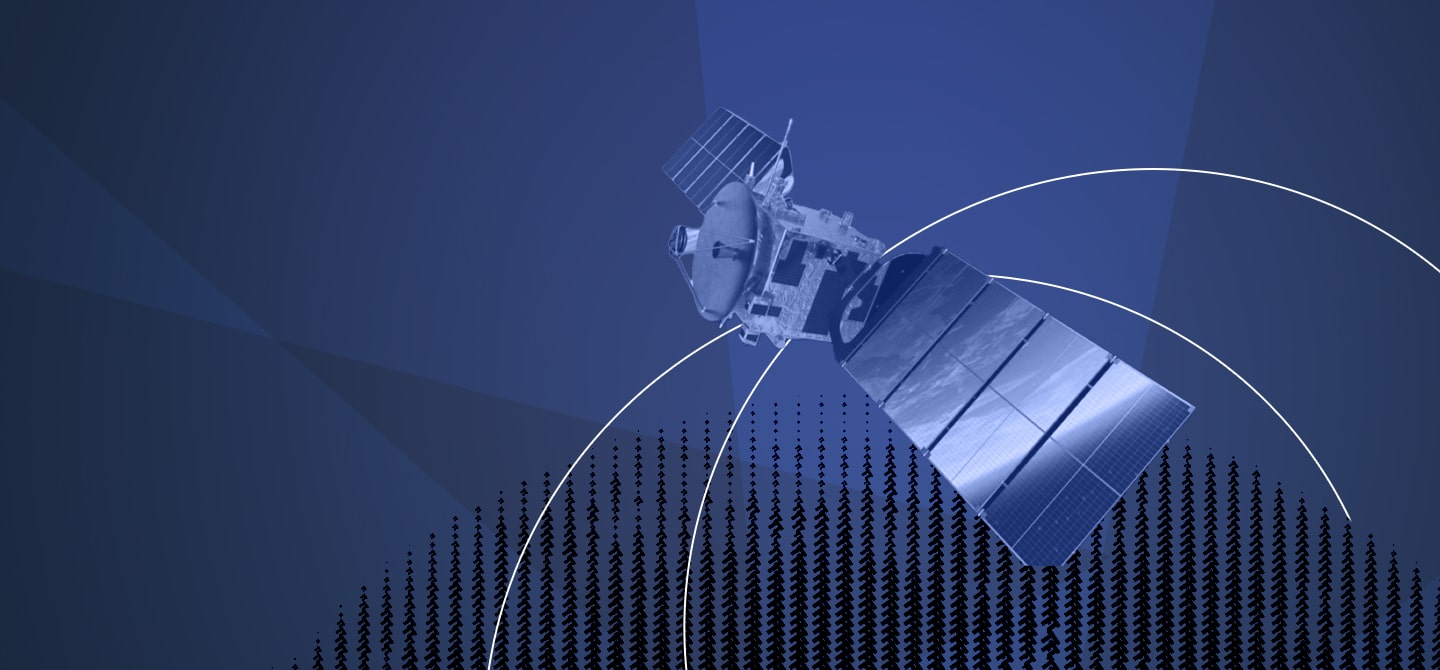Quel est l’impact du changement climatique sur les saisons ?
- Le dérèglement climatique et la hausse globale des températures ont bouleversé le rythme des saisons.
- En trente ans, la période de croissance de la végétation s’est allongée d’environ un mois.
- Certaines régions de la planète et certains types de végétation sont davantage touchés, comme l’hémisphère nord ou les prairies.
- Les évolutions du rythme saisonnier affectent tout notre écosystème : les plantes sont plus vulnérables aux sécheresses et aux maladies, et cela menace la biodiversité.
- Certaines espèces d’arbres ont déjà migré vers des latitudes plus élevées, à la recherche de conditions climatiques plus adaptées.
- Le futur des saisons est encore difficile à déterminer, puisqu’il dépend grandement des actions mises en place et de l’évolution du climat.
C’est avéré : le dérèglement climatique augmente les températures, la fréquence des sécheresses et les phénomènes météorologiques extrêmes. Mais quel est son effet sur les saisons ?
Observer les saisons et leur évolution est crucial. L’hiver, le printemps, l’été et l’automne illustrent le rythme de la végétation : le bourgeonnement, l’apparition des premières feuilles suivis de la floraison puis de la chute des feuilles. Elles contrôlent tout et fonctionnent en symbiose avec tous les éléments de notre écosystème.
Depuis treize ans, Jadu Dash étudie l’évolution de la végétation au fil du temps dans le monde, à travers des observations par satellite. Le professeur de télédétection en géographie et sciences de l’environnement à l’Université de Southampton a accès à une cinquantaine d’années de données satellitaires, lui permettant de déterminer les variations de croissance de la végétation selon les périodes. « Nous utilisons une technique qui consiste à examiner le degré de verdure de la végétation d’une zone spécifique, afin d’identifier le début et la fin de la saison de croissance », précise le chercheur.
Le printemps en avance, l’automne en retard
Selon ses études, le réchauffement climatique a bouleversé la durée des saisons. Le printemps arrive en avance, en moyenne de quinze jours, et l’automne arrive deux semaines plus tard. En clair, la saison de croissance de la végétation a été rallongée d’un mois, en moyenne, depuis cinq décennies. Ces effets ne sont pas les mêmes partout sur la planète. « Dans l’hémisphère nord, donc en Europe et en Amérique du Nord, nous observons un changement de saisonnalité beaucoup plus prononcé », indique Jadu Dash.
Cette évolution des saisons s’explique principalement par la hausse des températures. À titre d’exemple, en France, l’année 2022 s’est réchauffée de 2,7 °C par rapport aux années 1961 à 1990. Au printemps, une température élevée envoie un signal aux plantes qui déclenche l’éclosion des bourgeons et le déploiement des feuilles. Puis, en automne, la baisse des températures stoppe la végétation. Ainsi, selon les travaux du chercheur, la hausse des températures impacte largement la saison de croissance des végétaux.

L’allongement de la saison de croissance des plantes a de multiples conséquences sur notre écosystème. « La végétation reste plus longtemps, et elle est donc plus exposée aux gelées printanières, aux parasites, aux maladies, mais aussi aux sécheresses pendant l’été », relate Jadu Dash. Ses observations ont également démontré des décalages entre certains événements biologiques. Les insectes pollinisateurs dépendent, par exemple, des floraisons. Quand celles-ci se produisent plus tôt, au moment où ces animaux arrivent, il pourrait ne plus y avoir assez de fleurs pour qu’ils puissent se déplacer et transporter le pollen. De la même façon, les oiseaux migrateurs dépendent de la végétation, et savent où se nourrir. « S’ils s’attendent à trouver une certaine végétation à un endroit donné, mais qu’elle ne s’y trouve pas, parce qu’elle est finie ou en retard, cela pourrait impacter leur capacité de survie », ajoute le professeur.
Des plantes plus vulnérables
L’impact de cette évolution dans la saisonnalité varie selon les zones géographiques, mais aussi selon les types de végétation. Le professeur de télédétection a remarqué que les grandes forêts de Russie réagissent davantage aux changements de température que les forêts de conifères en Europe. Par ailleurs, les prairies, composées d’herbes aux racines peu profondes, sont très sensibles aux évolutions. « Le printemps arrive plus tôt, elles verdissent, perdent beaucoup d’eau et sont donc plus sensibles à la sécheresse pendant l’été que les arbres des forêts qui sont plus profondément enracinés », détaille Jadu Dash.
Lors de son état des lieux publié en octobre 2023, l’Institut national de l’information géographique forestière note une augmentation majeure de la mortalité des arbres, de l’ordre de 80 % entre 2013 et 2021. Est-ce le fruit du changement des saisons ? Pour le chercheur, il s’agirait d’une combinaison de facteurs. « Les épisodes de sécheresse se sont multipliés. Si ces dernières interviennent vers le pic de la saison de croissance, un stress hydrique important peut conduire à la mortalité des arbres. Nous constatons également que de nouvelles maladies, potentiellement liées à des changements dans la saisonnalité, affectent les forêts. Tout cela les rend plus vulnérables. »
Faut-il s’attendre à ce que les saisons continuent à évoluer dans le futur pour devenir totalement différentes de celles que nous connaissons aujourd’hui ? « Ce n’est pas tout à fait clair. Les prévisions climatiques pour l’avenir sont très incertaines, répond Jadu Dash, mais si nous passons un point de basculement, nous pourrions encore voir la période de végétation s’allonger. » À long terme, toute la composition végétale qui nous entoure est susceptible d’évoluer. Le scientifique observe déjà des espèces d’arbres migrer vers des latitudes plus élevées qui leur conviennent mieux. Le Royaume-Uni voit son activité viticole se développer considérablement, alors qu’elle était inexistante auparavant. « Les pratiques agricoles vont très certainement évoluer au fil du temps, dues à l’aptitude changeante des terres à accueillir différentes cultures », anticipe Jadu Dash. Pour le reste, les évolutions futures des saisons dépendent grandement de nos actions pour réduire notre impact sur l’environnement.
Sirine Azouaoui
Référence :
https://www.ign.fr/files/default/2023–10/memento_ign_2023_2.pdf