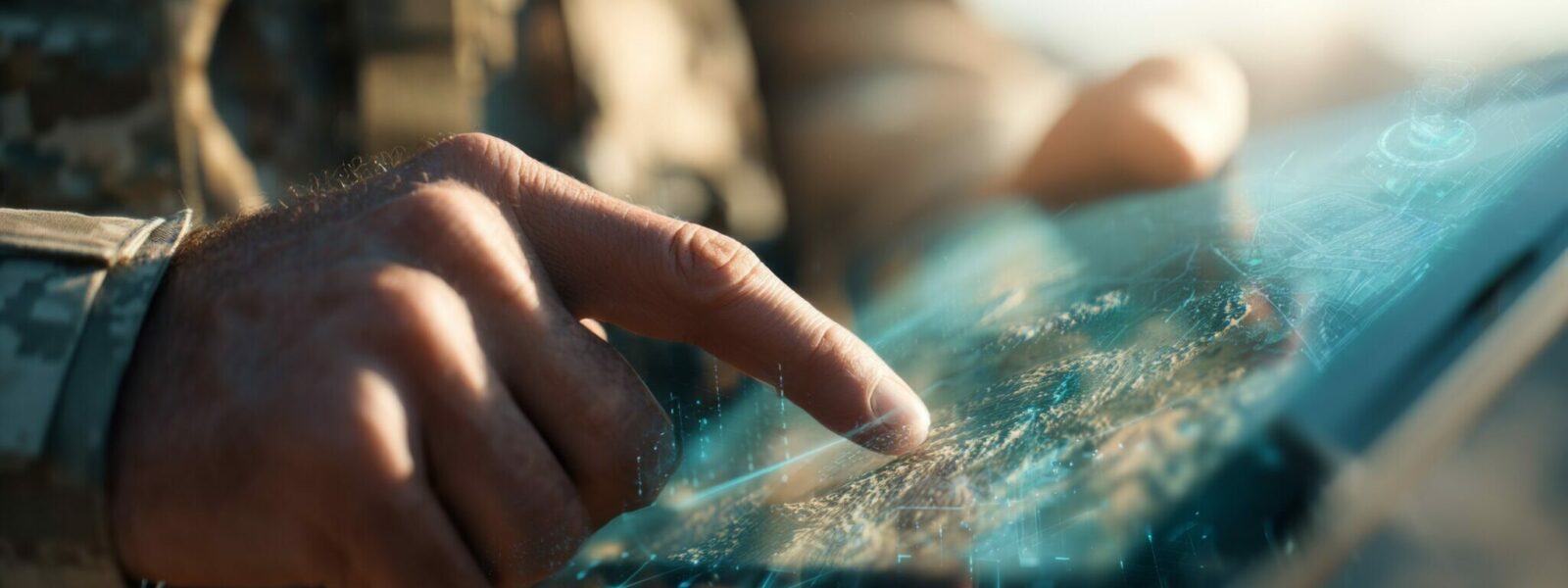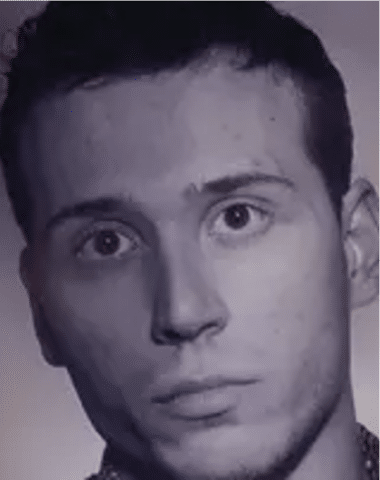Agilité stratégique : comment anticiper pour mieux décider dans un contexte de guerre hybride
- Des hauts fonctionnaires français se sont réunis en octobre 2025 pour discuter de l’amélioration des décisions stratégiques grâce aux sciences cognitives.
- Cette intervention a suscité un intérêt au-delà du monde militaire, notamment pour les administrations civiles, afin de répondre aux impacts de la crise climatique, aux tensions géopolitiques et aux disruptions technologiques.
- Depuis plusieurs années, la Direction générale de l'armement (DGA) a structuré une approche originale de l'anticipation par sa Red Team et par son programme Radar.
- Un des programmes expérimentaux sur l’innovation et les risques complexes, menés par l'Agence de l'innovation de défense (AID), analyse l'anticipation dans les systèmes technico-humains.
- La capacité d'anticipation est stratégique et devient un avantage compétitif majeur face à la puissance de feu et la supériorité numérique.
Face à l’accélération technologique et à la multiplication des crises, l’État français développe discrètement une nouvelle génération d’outils stratégiques. Entre intelligence artificielle, neurosciences, biotechnologies, sciences comportementales et anticipation, une révolution silencieuse transforme la manière dont les hauts fonctionnaires et militaires français préparent l’avenir.
Le 14 octobre 2025, une centaine de hauts fonctionnaires français se réunissaient à l’Institut national du service public pour une session inhabituelle. Au programme : comment les sciences cognitives peuvent transformer la prise de décision stratégique. Loin des amphithéâtres traditionnels, cette rencontre illustre un tournant dans la formation des élites administratives françaises. Car, dans un monde où l’Ukraine utilise des drones à bas prix contre des chars russes, où l’intelligence artificielle génère de la désinformation en quelques secondes et où les cyberattaques paralysent des infrastructures critiques en quelques heures, la supériorité technologique seule ne suffit plus.
L’enjeu ? Anticiper non seulement les innovations techniques, mais surtout leurs effets sur la décision humaine et la conduite des opérations. La technologie demeure un moyen et non une finalité : ce qui importe véritablement, c’est d’en appréhender l’influence sur notre perception temporelle, nos processus décisionnels en situation de pression et notre faculté d’adaptation au chaos.
Des « Red Teams » pour imaginer l’impensable
Depuis plusieurs années, la Direction générale de l’armement (DGA) a structuré une approche originale de l’anticipation. D’un côté, sa Red Team — composée d’auteurs de science-fiction, de scientifiques et d’officiers — imagine les ruptures futures et les scénarios de surprise stratégique. De l’autre, le programme Radar capte et analyse les signaux faibles : publications scientifiques émergentes, brevets disruptifs, innovations cognitives qui pourraient bouleverser l’équilibre stratégique.
Cette architecture reflète une philosophie : ne plus se contenter de prévoir, mais créer les conditions d’une véritable agilité stratégique. Quand la Red Team explore des futurs possibles — une guerre spatiale, l’effondrement d’une infrastructure numérique majeure, l’émergence d’une nouvelle forme de conflit hybride — Radar vérifie si les angles morts existent déjà dans les laboratoires ou sur les théâtres d’opérations.
Entre 2020 et 2023, l’Agence de l’innovation de défense (AID) a lancé plusieurs programmes expérimentaux sur l’innovation et les risques complexes dans des écoles d’ingénieurs du ministère des Armées. L’un d’eux, mené avec l’École polytechnique (IP Paris), a même conduit à l’envoi d’un expert à l’Université de Stanford pour étudier l’anticipation dans les systèmes technico-humains ; ces environnements où l’humain et la machine interagissent de manière si étroite qu’ils forment un système unique.

Parallèlement, des initiatives militaires plus confidentielles ont exploré la « cognition sous pression ». Le groupe Cognition et Mondes Virtuels, créé en 2022 au sein du Centre de doctrine et d’enseignement du commandement (CDEC), a étudié comment les militaires prennent leurs décisions dans des environnements saturés d’informations, parfois contradictoires. Leurs conclusions : dans un conflit moderne, la victoire appartient souvent à celui qui maintient sa clarté cognitive quand l’adversaire sombre dans la confusion.
Ces travaux, dont une partie reste classifiée, ont depuis irrigué des formations de l’École de Guerre et du Centre de l’enseignement militaire supérieur Terre (CEMST). Des officiers sélectionnés y apprennent à naviguer dans ce que les rapports du CEMST de 2023–2024 appellent la « superposition décisionnelle ». Autrement dit, cette situation où plusieurs options semblent simultanément possibles jusqu’à ce qu’une décision force le système à basculer dans une direction.
Un continuum stratégique unique
L’intervention d’octobre 2025 a suscité un intérêt inattendu au-delà du monde militaire. Plusieurs ministères — Économie, Culture, Écologie, Intérieur — ont sollicité des discussions approfondies pour intégrer ces approches dans leurs propres processus décisionnels. Une reconnaissance implicite : face aux crises climatiques, aux tensions géopolitiques et aux disruptions technologiques, les administrations civiles ont besoin des mêmes capacités d’anticipation que les armées.
Bercy réfléchit ainsi à mieux anticiper les chocs économiques et financiers. Le ministère de la Culture s’interroge sur la préservation du patrimoine face aux risques systémiques. Le ministère de la transition écologique souhaite mettre en place une « Green Team » sur le modèle de la Red Team de la DGA. Quant à l’Intérieur, la gestion des crises et des urgences requiert une compréhension fine des dynamiques cognitives collectives : comment une population réagit-elle face à une catastrophe ? Quels biais cognitifs amplifient la panique ou, au contraire, favorisent la résilience ? Ce qui émerge de ces initiatives, c’est un continuum stratégique rarement aussi intégré. De la prospective de la DGA aux salles de commandement tactiques, de l’innovation duale aux mémoires de l’École de Guerre, une même logique traverse l’écosystème français : anticiper, expérimenter, former.
Chaque signal technologique modifie la perception et la temporalité de l’opérateur ; chaque décision humaine reconfigure la dynamique du système. L’enjeu n’est plus de multiplier les capacités techniques — satellites, drones, systèmes d’armes — mais de maintenir la cohérence d’ensemble : la stabilité des boucles de commandement, la fluidité des flux d’information, la clarté des interfaces homme-machine.
Une révolution discrète, mais déterminante
Dans un contexte international tendu — de la guerre en Ukraine aux frictions en mer de Chine, de la course à l’IA au retour des logiques de blocs — cette capacité d’anticipation stratégique devient un avantage compétitif majeur. Alors que certains pays misent exclusivement sur la puissance de feu ou la supériorité numérique, la France parie sur l’intelligence de la décision.
Le travail reste en évolution. Une partie demeurera volontairement confidentielle, car l’anticipation ne fonctionne que si l’adversaire ne peut la prévoir. Mais la direction est claire : entre prospective et opération, entre laboratoire et théâtre, l’écosystème stratégique français confirme sa capacité à penser l’avenir autrement. Non pas en le prédisant, mais en s’y préparant avec créativité, réalisme et lucidité. Dans la guerre cognitive qui se dessine, cette lucidité pourrait faire toute la différence.