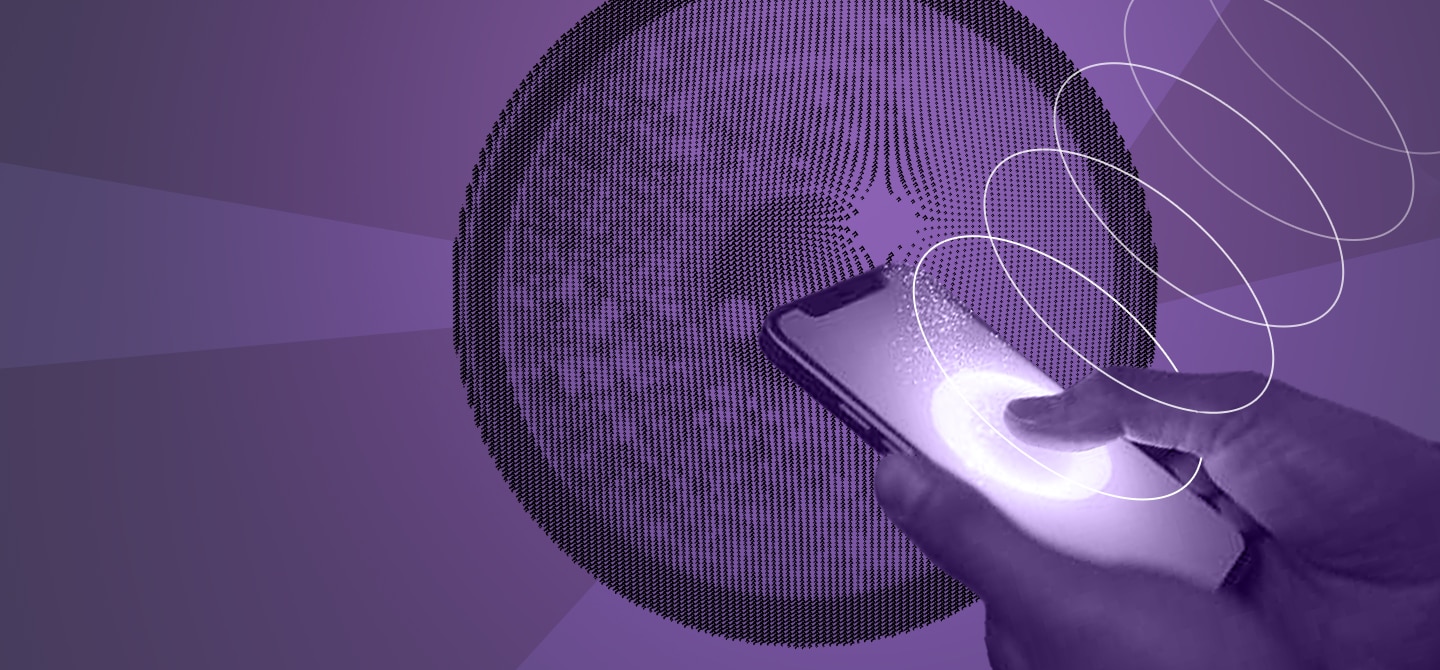Ingénieurs-philosophes : penseurs de l’avenir, hommes d’action
- Si la spéculation philosophique traditionnelle peine à trouver sa place aujourd’hui, une nouvelle figure émerge : l’ingénieur-philosophe.
- Observateur et acteur des évolutions technologiques qui transforment notre monde, il possède un sens aigu du bien commun et se sent porteur d’une responsabilité.
- L’ingénieur-philosophe vit à une époque hantée par les crises : il s’appuie donc sur les promesses trahies du passé pour éclairer les futures transformations.
- L’innovation s’arrange aujourd’hui avec la nature, au lieu de chercher à la dominer comme dans la philosophie classique.
- L’ingénieur-philosophe propose une vision insistant sur l’insertion de l’action humaine dans un milieu, ce qui est, au sens propre du terme, écologique.
Pascal et Leibniz incarnaient autrefois la figure du philosophe homme de sciences. A‑t-elle disparu ?
Le XXe siècle a connu une mutation considérable, avec une extension sans précédent des connaissances scientifiques et techniques, qui limite les prétentions de la philosophie traditionnelle à porter un regard sur tous les savoirs, comme le faisait encore Bergson. Les sciences s’autonomisent, et la spéculation philosophique peine à trouver sa place.
Mais, en contrepoint, on voit émerger une figure nouvelle : l’ingénieur-philosophe. Il ne personnifie pas une école à proprement parler, même si nombre de ses représentants sont issus d’une même alma mater, à savoir l’École polytechnique. Ce qu’ils ont en commun, et qui n’est pas sans lien avec le service de l’État associé à cette école, c’est un souci aigu du bien commun, assis sur la conscience d’une responsabilité. Membres d’une élite appelée à diriger la nation (ou, à tout le moins, de grandes organisations), ils se sentent redevables. Ce sont aussi des ingénieurs généralistes, qui embrassent un vaste champ de connaissances pratiques et théoriques, et qui observent de près les évolutions technologiques qui transforment notre monde : il est de leur devoir de les éclairer.
Les ingénieurs-philosophes sont des hommes d’action – loin de la figure de l’homme de cabinet, du rêveur, ou de l’universitaire.
À cet égard, une personnalité comme Thierry Gaudin est exemplaire. Né en 1940, c’est un observateur et un acteur de la révolution informatique qui a pris son essor avec sa génération. Il part d’une analyse serrée des transformations du système technique, et des interactions entre technique et société, pour penser les mutations contemporaines. À ses yeux, ces dernières ne sont pas un simple avatar de la révolution industrielle, mais doivent être comprises comme un véritable changement de civilisation. La saisie de cette rupture l’amène à tracer des perspectives, dans des ouvrages comme 2100, Récit du prochain siècle (1990) ou L’Avenir de l’Esprit (2021).
Les tout premiers « ingénieurs-philosophes », au XIXe siècle, sont portés par l’imaginaire du progrès, qui les amène à se projeter vers l’avenir. Leurs successeurs partagent-ils cette confiance ?
Ils vivent dans une époque hantée par les crises et qui a été rattrapée par l’imaginaire antique de la catastrophe : l’avenir se dérobe. Cela leur interdit de construire des systèmes – des mondes intellectuels clos, solides, vérifiés d’avance. Ils sont face à un avenir problématique, qu’ils cherchent à conceptualiser sans le réduire.
Une figure emblématique, ici, serait Jean-Pierre Dupuy. Penseur de la catastrophe, il ne se laisse pas fasciner par elle, et ne joue ni les devins, ni les collapsologues mais développe plutôt un « catastrophisme éclairé ». Annoncer l’inéluctabilité du pire est une façon d’empêcher sa réalisation. On retrouve ici une éthique de la responsabilité (ne pas éluder une possibilité même effrayante), et ce geste si particulier de l’ingénieur qui cherche moins à arraisonner le réel qu’à le modéliser, afin de le comprendre et de l’infléchir. L’enjeu n’est pas de dominer la réalité depuis l’empyrée des idées, mais d’avoir une certaine prise sur elles.

Une telle approche est loin des grands systèmes développés par les philosophies de l’histoire qui – songeons à Hegel ou à Marx – pensaient l’avenir à partir d’une rupture. Les ingénieurs-philosophes sont des penseurs de l’avenir, mais ils insistent sur la continuité. Ce qui n’exclut pas, bien au contraire, de penser le renouveau, mais ils ne dressent pas la figure eschatologique d’un monde idéal. Ils prennent plutôt en compte les promesses trahies du passé, et s’appliquent à éclairer et accompagner les transformations du monde.
Ces ingénieurs-philosophes sont des hommes d’action – loin de la figure de l’homme de cabinet, du rêveur, ou de l’universitaire. Ils s’arrachent à l’instant, à la carrière aussi, pour penser. Mais leur pensée se nourrit de l’épreuve du réel.
La philosophie moderne s’est concentrée sur le monde des Hommes. Avec Descartes, elle a fait de la nature un « objet » dont l’Homme pouvait, en quelque sorte, s’extraire. Ce geste intellectuel était aussi celui des ingénieurs, qui travaillaient activement à nous rendre « comme maîtres et possesseurs de la nature ». Les ingénieurs-philosophes ne sont-ils pas prisonniers de ce paradigme, aujourd’hui mis à mal par le rappel brutal de la puissance de la nature ?
Il est vrai que cette phase de la modernité, avec sa vision de l’Homme « comme maître et possesseur de la nature », semble derrière nous. L’humanité est doublement rappelée à sa condition naturelle. Par le lien renoué avec l’animalité d’abord, de Darwin à la primatologie contemporaine, et par la notion d’environnement ensuite, qui nous rattrape à grande vitesse. La philosophie moderne ne posait pas la question de l’environnement ; au contraire, elle s’est développée en l’éludant. Mais les ingénieurs-philosophes ne sont en rien coincés dans cette impasse.
Je prendrai ici comme exemple Olivier Rey, qui appartient à la génération suivante, née dans les années 1960. Ses travaux sont caractéristiques d’une critique de la modernité, qui fait notamment remarquer l’encastrement dans les nombres et pose la question de l’échelle humaine – des limites, et des disproportions entre les produits de la technique (villes, entreprises, systèmes) et notre aptitude à vivre en société. Il s’attaque enfin au transhumanisme, forme ultime de cette prétention moderne à dominer la nature.
Dans un essai comme Réparer l’eau, il explique que la science moderne s’est édifiée en répudiant les sensations, les impressions immédiates, au profit de la raison et des mesures. Notre rapport au monde en a été bouleversé : il a été « précisé à bien des égards, appauvri à d’autres ». Cette formule saisit précisément la pensée de l’ingénieur-philosophe, qui ne répudie pas la science, ni la technologie, mais s’interroge sur ses impasses, sur ce qui est perdu dans ce qui est gagné.
L’innovation prospère aujourd’hui dans les ruines du progrès : elle s’arrange avec la nature, au lieu de chercher à la dominer.
Une telle pensée s’inscrit dans la lignée des réflexions de Günther Anders sur le « décalage prométhéen », inséparables de l’avènement de l’âge atomique et de ses moyens de destruction massifs.
On revient aux questions de l’action, de la responsabilité : n’y a‑t-il pas ici un renoncement à agir ?
Non, ce n’est pas tant un renoncement qu’une tentative d’explorer d’autres voies, sans abandonner l’ambition d’agir, d’avoir une prise sur le monde. À double titre, comme modélisateurs et comme philosophes, les ingénieurs-philosophes sont marqués par l’imaginaire de la cité idéale – un geste qui habite la pensée européenne depuis les Grecs. Mais cette modélisation est impossible aujourd’hui, car pour modéliser, il faut isoler. Or dans le monde mondialisé, où tout est interconnecté, plus rien n’est isolable. Sans compter qu’on ne croit plus guère à l’avenir.
L’action, aux yeux de cette nouvelle génération d’ingénieurs-philosophes, change de sens : il ne s’agit plus d’agir sur, en exerçant un pouvoir souverain sur la nature ou sur les choses. Mais plutôt de fissurer l’existant, pour rouvrir des possibles – je reprends ici les mots de François Jullien. Fissurer est un geste plus modeste que transformer. L’innovation prospère aujourd’hui dans les ruines du progrès : elle s’arrange avec la nature, au lieu de chercher à la dominer.
Cette vision insistant sur l’insertion de l’action humaine dans un milieu est, au sens propre du terme, écologique. Mais aux deux pôles de l’écologie radicale, – l’un qui considère l’Homme comme une espèce invasive dont la nature se passerait bien, l’autre rejouant la farce tragique du totalitarisme, intrusive et pleine d’interdits – les ingénieurs-philosophes opposent une vision de l’action humaine marquée à la fois par des limites et une responsabilité. Une vision prudente, respectueuse, valorisant la compétence technique sans jamais l’isoler de ses effets.