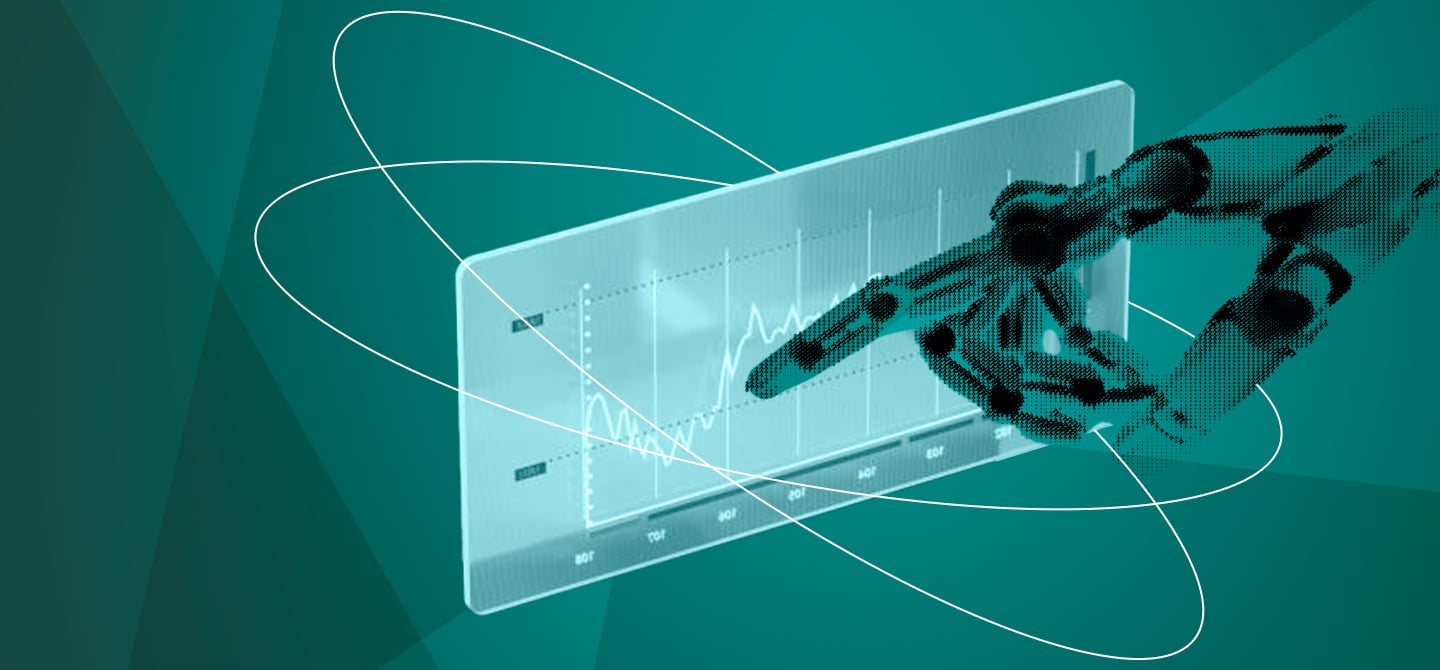En entrepreneuriat, les incubateurs sont des structures qui proposent des programmes d’accompagnement pour aider, accompagner et accélérer le développement de jeunes entreprises. S’ils sont importants pour l’insertion et la réinsertion sociale de personnes qui rencontrent des difficultés de vie – d’un handicap à une situation sociale compliquée – ils doivent aussi prendre en compte les besoins des bénéficiaires et s’adapter à eux. D’où l’idée d’un incubateur itinérant et mobile, qui se déplacerait et s’adapterait aux contraintes de ceux qui entreprennent dans des contextes difficiles.
L’émergence de projets entrepreneuriaux dans des contextes difficiles
Bastien a connu une enfance instable marquée par des violences familiales, des placements en foyers, et des comportements délinquants précoces. Suite à plusieurs fugues, il a vécu dans la rue, du trafic de drogues et de vols. Devenu père à 17 ans, il est emprisonné trois ans plus tard. À sa sortie de détention, il tente de se stabiliser, mais voit s’enchaîner conflits, ruptures, et retombées dans la délinquance : après une nouvelle incarcération, sa compagne le quitte, et quand sa condamnation se termine, il vit dans la rue et dort occasionnellement à l’hôtel. Pourtant, Bastien a un projet. Il souhaite ouvrir son restaurant grec avec un ami, Maxime, un autre jeune sans domicile, placé dès l’âge de six mois et ayant grandi dans différents foyers et familles d’accueil. Ce dernier, dont l’adolescence fut marquée par des fugues, des violences et des passages en structures pour jeunes délinquants, souhaite devenir son propre employeur. « Je me vois prendre un petit appartement, être mon propre patron. Si demain j’ai envie de travailler, alors je travaille. Si je n’ai pas envie de travailler, je ne vais pas travailler. Il n’y a pas quelqu’un qui va m’appeler et me demander où je suis, tout ça pour 1 200 euros à la fin du mois ». Il s’imagine créer sa propre entreprise avec sa petite amie, « faire ma vie normalement ».
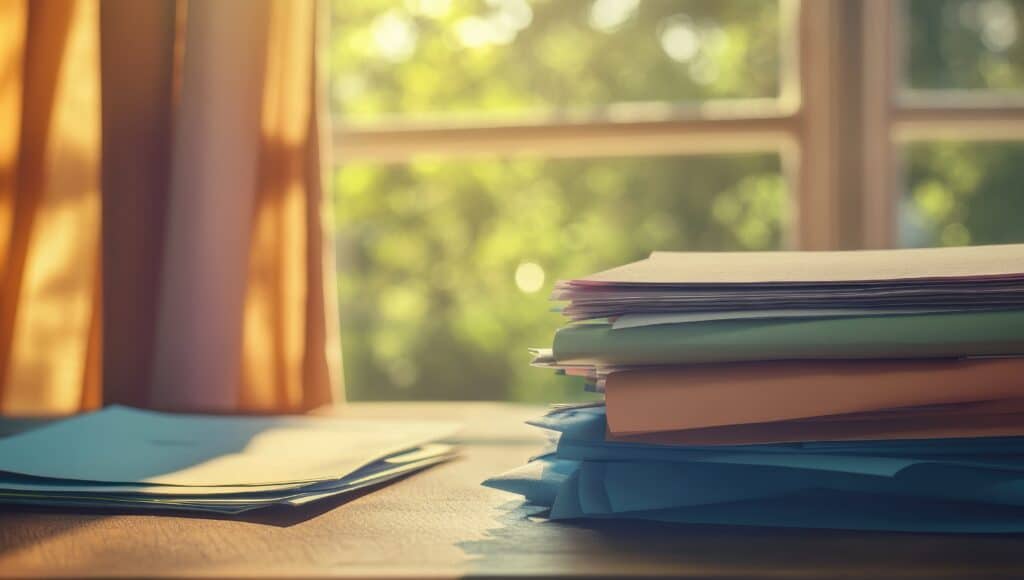
Le projet entrepreneurial émerge dans un contexte d’extrême précarité : parcours de rue, incarcérations, ruptures multiples avec les institutions éducatives, professionnelles et familiales. À défaut d’un accès aux parcours d’emploi classiques, l’entrepreneuriat devient une voie d’auto-insertion. Il est motivé par la quête d’autonomie comme tentative de réinvention de soi. Ce désir d’entreprendre est marqué par un manque de ressources. Ces jeunes sans domicile semblent très éloignés des conditions matérielles et sociales permettant de lancer un projet entrepreneurial dans un cadre classique : absence de capital financier, social et symbolique, instabilité résidentielle, judiciaire et affective. Ils s’inscrivent dans une logique d’entrepreneuriat de survie.
Alice et Gabriel sont des entrepreneurs en situation de handicap, réduisant au maximum leurs mouvements. Alice remarque que « le négatif évidemment, c’est les déplacements ». Pour elle, la bonne pratique c’est de « les limiter surtout ». Gabriel a toujours eu l’habitude de faire venir certains de ses prestataires, et Marwa rencontre quant à elle des difficultés à circuler avec son fauteuil électrique dans son incubateur. Enfin, Vincent est malvoyant et travaille principalement dans un incubateur : « Je ne sais jamais si je suis du côté gauche ou du côté droit, explique-t-il. J’ai du mal à prendre mes repères, notamment aussi par le tout technologique. »
La manière d’entreprendre est fortement marquée par une nécessité d’adaptation à des contraintes physiques ou logistiques. Le handicap ne constitue pas une impossibilité d’entreprendre, mais il structure fortement les choix organisationnels et spatiaux. À ce titre, des entrepreneurs développent des stratégies actives de contournement : les déplacements sont évités, réduits. Et malgré l’insertion dans des dispositifs de soutien à l’entrepreneuriat, les environnements ne sont pas pleinement inclusifs. En effet, l’accessibilité ne se limite pas à l’entrée dans un bâtiment, mais concerne la capacité à interagir pleinement avec l’espace de travail. L’environnement technologique est aussi un facteur d’exclusion fonctionnelle. Les incubateurs peuvent reproduire des formes d’exclusion par leur architecture ou leur conception numérique. L’entrepreneuriat est entravé par des environnements normalisés. Or, il devrait être sensible à la diversité des capacités. L’inclusion véritable suppose de penser l’environnement de travail comme un écosystème accessible physiquement, cognitivement, numériquement.
L’incubateur itinérant : adapter l’entreprenariat aux individus et à leurs besoins
C’est pourquoi l’innovation sociale se fonde sur la coordination d’acteurs engagés dans la résolution de problèmes sociaux ou économiques, avec pour objectif l’amélioration du bien-être des populations. Elle mobilise la créativité individuelle et collective, afin de concevoir des solutions nouvelles, efficaces et inclusives, en réponse à des besoins sociaux non-satisfaits et sous la forme de pratiques, d’approches, d’interventions ou de produits inédits. La création d’un incubateur itinérant constitue une innovation sociale ciblant des besoins spécifiques identifiés chez certaines populations, notamment les jeunes sans domicile et les personnes en situation de handicap. Ces populations sont confrontées à des expériences de stigmatisation, d’exclusion ou de précarité, et rencontrent des obstacles dans leur parcours vers l’autonomie, en particulier lorsqu’elles aspirent à s’inscrire dans une démarche entrepreneuriale. Outre les difficultés d’ordre matériel, telles que les problèmes de mobilité, d’accessibilité ou d’isolement géographique, elles font également face à des barrières symboliques comme la disqualification sociale ou la faiblesse du capital social et/ou économique. Pourtant, malgré ces contraintes, certaines personnes issues de ces populations manifestent un désir d’entreprendre, ou développent leur propre entreprise.
L’incubateur itinérant soutient des initiatives entrepreneuriales portées par des personnes pouvant être éloignées des circuits économiques, tout en suivant des conditions d’une logique de justice sociale.
Face à ces constats, un incubateur itinérant – c’est-à-dire un dispositif mobile, souple et adaptatif – apparaît comme une alternative pertinente, en ce qu’il permet de déplacer l’offre d’accompagnement vers les personnes elles-mêmes, en investissant leurs lieux de vie et d’ancrage. Qu’il intervienne dans la rue, au sein d’associations, de centres d’hébergement, ou à domicile, un tel incubateur offrirait une proximité à la fois géographique, sociale et symbolique, favorable à la création d’un lien de confiance. Il permettrait d’offrir, de manière décentralisée, des services de formation, de mentorat, d’aide à la formalisation de projets, d’accès au financement, en s’adaptant aux rythmes, aux contraintes et aux aspirations des bénéficiaires. Ce dispositif reposerait sur une équipe mobile, composée de professionnels de l’accompagnement entrepreneurial, formés aux enjeux de la précarité, de l’inclusion. Par leur présence sur le terrain, ces intervenants pourraient assurer une médiation active entre les personnes accompagnées et les écosystèmes entrepreneuriaux existants.
En ce sens, l’incubateur itinérant contribuerait non seulement à révéler et soutenir des initiatives entrepreneuriales portées par des personnes pouvant être éloignées des circuits économiques, mais aussi à redéfinir les conditions mêmes de l’accès à l’entrepreneuriat, en plaçant l’accompagnement au cœur d’une logique de justice sociale. En définitive, ce modèle d’incubation mobile participe ainsi à la démocratisation de l’entrepreneuriat, à la construction d’un entrepreneuriat accessible, équitable et enraciné dans les réalités vécues des personnes, en favorisant leur capacité d’agir.